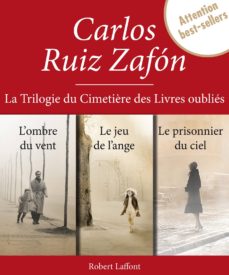|
| Luis de Góngora |
LES « REPENTIRS » D’UN POÈTE-TRADUCTEUR LES TROIS VERSIONS DE GIUSEPPE UNGARETTI DU SONNET DE GÓNGORA « MIENTRAS POR COMPETIR CON TU CABELLO »
Elvezio Canonica
Université de Bordeaux Montaigne
1611 No. 8 / 2014
1. Introduction
1. Introduction
Je me propose, dans ce qui suit, d'étudier un cas particulier de traduction littéraire, poétique en l’occurrence, dont les auteurs sont deux poètes appartenant à deux époques et à deux traditions littéraires différentes. Il s’agit d’analyser des traductions qu’un célèbre poète italien de la première moitié du XXe siècle, Giuseppe Ungaretti, a composé à partir des textes d’un des poètes espagnols les plus reconnus et représentatifs de l’époque baroque, le cordouan Luis de Góngora. Nos avons là, on le voit bien, plus qu’une simple traduction poétique, car celle-ci est le fruit du travail d’un poète, et non pas d’un traducteur professionnel, et en outre, cette traduction prend comme objet des textes d’un poète d’une époque bien lointaine et très marquée : le Siècle d’Or espagnol et, plus particulièrement, la période baroque. Confrontation donc de deux poétiques et de deux périodes historiques bien distinctes. J’aurais souhaité présenter les trois facettes de Góngora que le poète italien a choisi de traduire, et qui embrassent une longue période de son activité créatrice, puisque les premières datent de 1932 et les dernières de 1951. Mais cette étude plus globale aurait débordé le cadre de cet article. Je mi limiterai ici aux sonnets, et plus particulièrement à un sonnet célèbre, qu’Ungaretti a traduit trois fois sur une période d’une vingtaine d’année, ce qui va nous permettre d’entrer dans l’atelier du poète-traducteur. Je vais néanmoins indiquer d’abord les trois manières gongorines qu’ont intéressées le poète italien.
2. Ungaretti traducteur de Góngora
Il y a d’abord les sonnets : Ungaretti en a traduit en tout une vingtaine, parmi lesquels dix appartiennent au genre amoureux (selon la division de la poésie de Góngora établie par son premier éditeur, Juan López de Vicuña dans son édition qui porte le titre significatif de : Obras del Homero español, et qui sort en 1627, l’année de la mort du poète), quatre au genre funèbre, deux au sacré, six divers, parmi lesquels un burlesque et trois héroïques. Ces sonnets couvrent plusieurs décennies de la production gongorine, de 1582 à 1623. Mais l’intérêt pour le poète baroque espagnol ne se limite pas à ces courtes pièces, parfois de circonstance. Ungaretti n’hésite pas à s’attaquer au Góngora le plus obscur et redoutable, dont le style a donné le nom à un courant poétique, le « culteranismo », une étiquette à vrai dire forgée par ses adversaires pour le traiter d’hérétique, formée à partir de l’adjectif « luterano ». C’est le cas des deux octaves de la Fábula de Polifemo y Galatea, œuvre composée par Góngora vers 1613 ainsi que de deux fragments du long poème inachevé intitulé Soledades (composé vers 1614), dont Ungaretti traduit deux fragments de la Soledad segunda, l’ouverture de 26 vers, ainsi qu’un passage plus long (65 vv.) qui correspond aux vv. 823-886 du poème espagnol. Il s’agit également de se confronter à deux nouvelles formes poétiques, les « octavas reales » du Polifemo, une strophe d’origine italienne, et les « silvas » des Soledades, une forme métrique autochtone, qui présente une alternance libre entre endécasyllabes et heptasyllabes (des vers néanmoins issus de la poésie italiennes) avec des rimes aléatoires. Notons, cependant, qu’Ungaretti ne s’est intéressé qu’au Góngora « de arte mayor », en délaissant toute la grande partie de son œuvre écrite en octosyllabes (les romances) et autres vers de « arte menor ». Ceci tient sans doute au fait que les vers de «arte mayor » à l’époque de Góngora étaient d’origine italienne (l’hendécasyllabe, et l’heptasyllabe).
Nous rappelons ici brièvement la révolution poétique que ces deux œuvres (le Polifemo et les Soledades) ont représenté dans l’histoire de la poésie espagnole, en provoquant une division entre deux camps, celui de ses partisans, qui prônaient l’obscurité poétique et donc une conception élitiste de l’activité poétique, qui soit capable de redorer le blason de la langue castillane en la calquant le plus possible sur la langue latine à tous les niveaux (syntaxe, lexique, rhétorique, etc.) et celui des partisans d’une plus grande clarté (« llaneza »), qui puisaient leur style dans la langue populaire (les proverbes, le style familier, les jeux de mots, etc.), qu’on a appelé les « conceptistas », parmi lesquels il est d’usage de nommer des auteurs de la taille d’un Lope de Vega ou d’un Quevedo. En réalité, les différences entre les deux écoles sont moins importantes qu’on a bien voulu le faire croire, car des deux côtés on aspire à ennoblir la langue castillane par des rappels à l’antiquité latine ou grecque, dans un contexte d’affirmation du primat des langues vernaculaires issues du latin, dont le degré de proximité devenait le critère absolu. Nous assistons même, à cette époque, à de curieuses expériences poétiques, surtout en Espagne, qui consistaient à produire un poème qui soit lisible à la fois en espagnol et en latin, afin de fournir la preuve définitive de la primauté du castillan sur les autres langues romanes.(1) Mais, j’insiste, cette opposition est plus apparente que réelle, et peut-être faut-il encore en revenir à la sage formule de Benedetto Croce, le grand historien et philosophe napolitain de la première moitié du XXe, lorsqu’il qualifia cette rivalité comme une « riña entre parientes » (une dispute de famille).
Vers 1932-33, au moment de la publication de ses premières traductions des sonnets de Góngora, Ungaretti travaille à son deuxième recueil poétique, Il sentimento del tempo (1933), titre qui éclaire le choix de certains sonnets du poète espagnol. On le voit, c’est précisément ce motif topique du tempus fugit qui préoccupe Ungaretti et qu’il retrouve chez le poète cordouan. Lors d’une conférence prononcée à Barcelone en mars 1933, Ungaretti s’exclame : « Voici le Baroque : voici Góngora ! On dirait un siècle fait de tombes immortelles. L’homme n’est rien : de la poussière ! La tombe est tout ! Hosanna ! ».(2) Ungaretti pense peut-être au sonnet funèbre sur la tombe du Gréco qu’il a traduit, mais probablement aussi au célèbre « Mientras por competir con tu cabello », que nous allons analyser plus en détail par la suite.
3. Les autres traductions poétiques
Il faudra s’interroger, avant d’entrer dans le vif du sujet, sur les motivations qu’ont amené un poète italien à cheval entre le XIXe et le XXe siècle (1888-1970) à traduire un poète à cheval entre le XVIe et le XVIIe siècle (1561-1625). Nous devons, tout d’abord, observer que Góngora n’est pas le seul auteur de la période baroque traduit par Ungaretti : en effet, le poète italien a également traduit les 40 sonnets de Shakespeare, ainsi que deux tragédies de Racine, intégralement la Phèdre, et le troisième acte d’Andromaque. Il faut également insérer ces traductions d’auteurs baroques dans le travail de traducteur de poésie qu’Ungaretti n’a cessé de fournir tout au long de son activité créatrice et qui embrasse également des poètes d’autres époques: William Blake, Stéphane Mallarmé, Saint-John Perse. Quelques-unes de ses traductions seront réunies dans une première version du volume Traduzioni de 1936, un volume qui va s’enrichir dans les années successives avec d’autres textes. Sur l’ensemble du travail d’Ungaretti traducteur nous possédons un ouvrage critique d’Isabel Violante Picón, publié aux Presses Universitaires de la Sorbonne en 1998.(3)
Pour revenir aux auteurs baroques, on peut observer que Góngora est chronologiquement le premier que le poète italien traduit, dès 1931; le travail sur Shakespeare commence pendant la période brésilienne, de 1938 à 1942, période dans laquelle il continue et parfait ses traductions de Góngora. En ce qui concerne les traductions de Racine, elles sont plus tardives : la Fedra est de 1950, et le troisième acte d’Andromaque est de 1958. Il faut rappeler que la langue française fut la deuxième langue d’Ungaretti, car dès 1912 il s’établit à Paris, arrivant directement d’Alexandrie d’Egypte, ville où il était né de parents toscans (de Lucques) et où il a passé sa jeunesse. A Paris, à 24 ans il s’inscrit à La Sorbonne en lettres modernes où il soutiendra un mémoire sur Maurice de Guérin. On remarquera d’ailleurs une similitude de cet itinéraire avec celui du fondateur du « Futurisme », Marinetti, également né de parents italiens à Alexandrie et qui publiera à Paris en 1909 (en français) son manifeste pour une poésie futuriste, qui constitue le premier mouvement d’avant-garde européenne. Ungaretti publiera d’ailleurs en 1919 une plaquette en français, sous le titre de La guerre, soit la même année où parait son premier recueil en italien, Allegria di naufragi (Firenze), qui deviendra plus tard simplement L’Allegria (2ème éd. 1923). Engagé volontaire dans la Grande Guerre en 1914, Ungaretti reste à Paris après 1918 et travaille comme journaliste correspondant pour le « Popolo d’Italia », ainsi qu’à l’Ambassade d’Italie. Son adhésion au fascisme est assez précoce (1919), et la deuxième édition de l’Allegria sera précédée d’une préface de Benito Mussolini. Il arrive en Italie (pays qu’il ne connaissait pratiquement pas encore) en 1921, et il travaille au Ministère des Affaires Etrangères. Puis, en 1936, il accepte un poste de Professeur de Langue et Littérature Italiennes à l’Université de Sao Paulo, au Brésil. Marié à une française, il subit en terre brésilienne l’épreuve de la mort de son fils Antonietto, à peine âgé de neuf ans, qui fait suite à la mort de son frère Costantino en 1937. En 1942, il rentre en Italie et est nommé Professeur de Littérature italienne moderne et contemporaine à l’Université de Rome, charge qu’il maintiendra jusqu’en 1958. A partir de cette date il se consacre entièrement à son œuvre poétique, qu’il finit par réunir dans un seul volume : Vita di un uomo, publié en 1969, juste un an avant sa mort survenue à Milan à l’âge de 82 ans.
4. L’intérêt pour Góngora : une médiation française
L’intérêt pour Góngora chez Ungaretti passe par une médiation française, ce qui fut également le cas pour les poètes espagnols de la Génération de ’27, car Góngora, longtemps oublié par la critique espagnole, avait été redécouvert par les symbolistes français dès la fin du XIXe siècle. Verlaine en cite quelques vers, Barrès cite son épitaphe pour le Greco (un sonnet d’ailleurs traduit par Ungaretti), Rémy de Gourmont et Francis de Mirmandre publieront entre 1910 et 1920 quelques traductions de poèmes de Góngora ; enfin, en 1920 paraît un article de Zdislas Milner, publié dans L’Esprit Nouveau (une revue fondée par Apollinaire et à laquelle Ungaretti va collaborer), intitulé : « Góngora et Mallarmé : la connaissance de l’absolu par les mots »,(4) qui associe la poétique de Góngora à l’hermétisme des poètes symbolistes français. Cependant, ce n’est sans doute pas un hasard si le premier traducteur italien de Góngora soit précisément Ungaretti, un poète qui est considéré comme l’initiateur d’un des mouvements poétiques les plus importants de la poésie italienne du XXe siècle, appelé précisément l’ « ermetismo », une notion critique qui fut employée pour la première fois en 1936 dans un essai de Francesco Flora, dans un sens péjoratif pour qualifier une poésie obscure et secrète, élitiste.(5) Mais dès 1939, les jeunes poètes italiens de cette génération (Quasimodo, Gatto, Sinisgalli, Bigongiari, Luzi, Parronchi), à côté de la production poétique de leur époque, celle de Saba et de Montale, revendiquent précisément le premier recueil d’Ungaretti Allegria di naufragi de 1919 comme le modèle de la nouvelle poésie hermétique.
C’est dans ce contexte à forte connotation avant-gardiste que le poète baroque espagnol intéresse les poètes français, espagnols et italiens des années Vingt. A noter, cependant, que la redécouverte de Góngora par les poètes espagnols de la très célèbre génération de ’27, n’a nullement influencé le choix d’Ungaretti. Comme l’affirme l’hispaniste Vittorio Bodini, contemporain d’Ungaretti, et sans doute le meilleur connaisseur italien de la génération de ’27 espagnole de son époque, le Góngora de Ungaretti « n’est pas le Góngora historique, mais celui qui a été redécouvert et reconnu comme précurseur et maître des poètes parnassiens et symbolistes français ». (6) L’article de Milner est très important, car il montre l’analogie des poétiques de Góngora et de Mallarmé : chez le poète espagnol, l’écart entre le langage et l’objet est étiré au maximum, alors que c’est cela même qui navrait Mallarmé, lequel rêvait d’une réduction radicale de cette distance et prônait une sorte d’identification entre le mot et la chose. Mais, fait remarquer Milner, les deux extrêmes de rejoignent, car si « la langue s’écarte de l’usage commun » comme chez Góngora, elle permet la réactivation par les figures étymologiques d’une histoire de la langue dont les figures de style, massivement exploitées par le poète baroque, contribuent à rendre présent l’objet absent, car « les noms d’une chose par eux-mêmes ne sont pas évocateurs ».(7) En d’autres termes, Góngora parvient à construire une réalité autonome, par le biais d’une langue parallèle dans laquelle les figures de style « se superposent et naissent les unes des autres, la fiction issue de l’objet réel devenant réalité à son tour et invoquant des rapprochements nouveaux. Elles forment une séries de métamorphoses ».(8) C’est à juste titre qu’Isabel Violante Picon rapproche cette analyse de Milner (de 1920) à la notion de « métaphore au carré » appliquée à la poésie de Góngora par l’auteur cubain Severo Sarduy dans un article paru dans Tel Quel en 1966.(9) On va retrouver des échos de cette théorie de Milner chez Ungaretti jusque dans l’essai de 1951 qu’il consacre à Góngora et qu’il intitule : « Góngora al lume d’oggi » (G. à la lumière actuelle), lorsqu’il affirme que : « La nouveauté de Góngora était de sentir la valeur obsessionnelle des objets, d’affiner tous les artifices pour que dans les mots les objets retrouvent et attestent la vérité sensuelle de la réalité. [...] La qualité métaphorique intrinsèque aux mots est accentuée voir accusée avec beaucoup de grâce, en les pliant à de nouvelles métaphores, pour que le lecteur les ressente le plus possible comme des objets absents : des objets présents uniquement à l’esprit, dans le silence ».(10) Si, comme le fait remarquer Isabel Violante, la référence à Mallarmé est à peine voilée, notamment à sa fameuse fleur qui est « l’absente de tous les bouquets », il s’agit aussi de la reprise de certaines idées de l’ancien article de Milner (de 1920 !), notamment lorsque ce dernier affirmait que « le poète a à sa disposition deux moyens pour rendre l’objets visible et tangible, pour le faire s’imposer à l’imagination ou à l’esprit : il peut avoir recours à une figure de rhétorique, substituer au mot la périphrase [...] ou bien, tout en conservant le mot propre, il peut y joindre des adjectifs, des épithètes qui en fassent naître l’image ».(11)
5. Le pétrarquisme
Mais il y a aussi, et parallèlement au Góngora avant-gardiste, une autre motivation profonde qui explique le choix de ce poète et de l’intérêt pour la poésie baroque en général qu’Ungaretti manifeste par ces autres traductions : le pétrarquisme. En effet, Ungaretti s’est toujours considéré comme un lointain disciple de Pétrarque, et il aimait inscrire son œuvre poétique dans le courant européen du pétrarquisme, dont il brosse à grands traits l’itinéraire dans un article de 1943, consacré à Pétrarque et intitulé « Il poeta dell’oblio » (le poète de l’oubli), où il affirme que : « Non seulement Góngora et Racine, Camoëns et Shakespeare invitent à Pétrarque, mais aussi Goethe et Leopardi et Mallarmé ».(12) Il s’arrête plus particulièrement sur le cas de Góngora, en le considérant « indubitablement un poète de premier ordre » et pour marquer son adhésion au pétrarquisme il fait allusion à un vers de Pétrarque que Góngora avait laissé dans l’original italien comme dernier vers d’une chanson composée à l’occasion de l’expédition désastreuse qu’on nomme toujours (désormais ironiquement) de la « invencible armada », c’est-à-dire la bataille navale contre les anglais de 1588. Góngora reprend dans sa chanson le premier vers d’un sonnet du Canzoniere de Pétrarque (Rerum Vulgarium Fragmenta 136, 1) qui faisait référence à la corruption qui régnait à la cour papale avignonnaise : « Fiamma dal ciel su le tue treccie piova » (‘que la flamme du ciel pleuve sur tes tresses’). Cette référence montre, en passant, une bonne connaissance de l’œuvre de Góngora chez Ungaretti. Il s’agissait, chez Pétrarque, d’une personnification de la curie papale avignonnaise assimilée à la Babylone décrite comme la « grande prostituée » dans le livre de l’Apocalypse (XVII, 15), et qui apparaît aussi chez Dante (Purgatorio, XXXII, 149). Je rappelle d’ailleurs que ce procédé qui consiste à utiliser un vers de Pétrarque dans sa langue originale comme vers conclusif d’une composition poétique avait été déjà employé dans la poésie espagnole notamment chez Garcilaso de la Vega, dans son sonnet XXII.(13) En résumant, Ungaretti considère que Góngora, malgré son extravagance formelle, reste « ligio a Petrarca »(14) (soumis à Pétrarque) à partir du moment où il reste soumis à une réalité abstraite, mentale, une réalité de culture, « culterana ». Ce faisant, et c’est là le mérite le plus grand et aussi le plus paradoxal de Góngora aux yeux d’Ungaretti, il est parvenu au résultat opposé aux attentes moralisatrices de l’époque post-tridentine, en redonnant une valeur obsessionnelle et exclusive à la vérité des sens. Que cela soit passé par Pétrarque, voilà ce qu’Ungaretti qualifie de « miracle ».
6. La poétique de la traduction chez Ungaretti : attention à la lettre vs rigueur philologique
En 1951, Ungaretti dans un entretien publiée dans La Fiera letteraria avec les titre « La traduzione è sempre una poesia inferiore » affirme l’impossibilité de la traduction de la poésie, et préfère parler d’imitation, comme pour les poètes de la Renaissance et de l’Humanisme, une activité dont ils étaient d’ailleurs très fiers et qu’ils ne considéraient nullement comme une activité inférieure. Ungaretti, dans cet entretien, exprime aussi les motivations qui l’ont poussé à traduire d’autres poètes : « pour m’enrichir spirituellement, pour apprendre le métier et la langue d’un autre poète ; pour mieux ressentir un autre esprit, le sentir plus proche », tout en continuant d’affirmer que la traduction reste « une folie ». Et il s’en explique : « Je crois, dit-il, que dans le mot il y a une partie sensuelle et une partie, comment dire, logique […] Dante l’appelle la partie rationnelle. Dans l’acte de traduire il nous faut restituer avec la plus grande précision possible cette partie rationnelle : être le plus fidèle possible aux signifiés : on ne peut ni enlever ni ajouter un seul mot […] Mais, se ravise- t-il, au fond il est absurde de faire une distinction entre la partie sensuelle et la partie rationnelle : le mot est comme un être humain, fait d’une âme et d’un corps. Une table est toujours une table en français, en italien et en anglais. Mais le ton avec lequel ce mot est prononcé, comment le restituer ? C’est celle-ci la partie sensuelle et, franchement, il est inutile d’en parler».(15) C’est d’ailleurs dans cet esprit qu’il traduit (ou retraduit) les poètes baroques lors des années brésiliennes, une période très stérile sur le plan de la création poétique. Le poète lui-même le répètera dans ses lettres de cette époque : « je n’arrive pas à faire de la poésie. Je m’y suis mis tant de fois, au Brésil, je n’ai pas pu écrire un vers. Je ne sais pas pourquoi […] Alors, pour voir, je me suis mis à la traduction (quand je n’arrive pas à faire de la poésie, en somme, pour en faire quand même, je traduis, et j’apprends, et je me renouvelle), mais je n’arrivais pas à traduire. J’ai pris des sonnets de Shakespeare, ils sont difficiles, c’est entendu, mais en somme un sonnet…j’y ai peiné des semaines et des mois et je n’en suis pas venu à bout ».(16)
Face à cette rigueur affichée pour le « signifiant », la « partie rationnelle » du mot selon l’expression de Dante, on peut s’étonner du choix opéré par Ungaretti de travailler les textes de Góngora à partir d’une édition, celle que Pedro Escuer publie à Saragosse en 1643, qui n’est certainement pas la plus fiable. Il s’agissait probablement de la seule édition dont il disposait : peut-être n’a-t-il pas eu accès à la première édition moderne des œuvres poétiques de l’auteur cordouan, qui est de 1921(17) ni de la première édition moderne des œuvres complètes, qui est de 1932.(18) Ces deux éditions se basent sur le manuscrit Chacón, considéré comme le plus fiable, contrairement à celle de Saragosse. Le choix de cette édition aura des conséquences sur certaines interprétations des vers gongorins, qui apparaissent à Ungaretti comme très intriqués, voire insurmontables. Nous savons que dans une lettre à De Robertis de 1948, il parle du poète espagnol comme d’un écrivain « incorrect et obscur à cause de sa mauvaise grammaire».(19) Ce jugement sévère s’explique en grande partie par le choix du texte de base, celui de Saragosse. En cette même année de 1948, dans l’introduction à son volume de traductions Da Góngora a Mallarmé, Ungaretti semble s’être rendu compte que l’édition de Saragosse n’était pas la meilleure, voilà pourquoi il affirme qu’il n’a pas l’intention de donner une valeur critique à son recueil, et il met en note à la disposition des lecteurs (seulement pour leur confort, dit-il) quelques variantes d’une anthologie moderne, celle d’Henriquez Ureña,(20) tout en se fondant toujours sur le texte de Saragosse de 1643. On peut être surpris par ce manque de rigueur, surtout quand on connaît la complexité de la transmission des textes poétiques au Siècle d’Or. Il s’agit, encore une fois, de ne pas oublier que ces traductions sont l’œuvre d’un poète qui poursuit une démarche poétique et intuitive plutôt qu’une attitude de rigueur philologique.
7. Analyse des trois versions de « Mientras por competir con tu cabello »
Nous pouvons passer maintenant à la phase pratique de notre approche, à travers l’analyse de trois étapes de la traduction d’un sonnet de Góngora. Sur l’ensemble de ces traductions de Góngora, je crois que la meilleure étude reste encore celle de José Pascual Buxó, publiée en 1978 aux presses de la Universidad Nacional Autonoma de México.(21) J’ai choisi le célèbre sonnet « Mientras por competir con tu cabello », une œuvre de jeunesse de Góngora (1582) et probablement le premier texte du poète espagnol traduit par Ungaretti. En effet, c’est le seul sonnet traduit par le poète italien dont nous possédons trois versions, qui embrassent une période de presque vingt ans (1932-1948-1951).
7.1 Choix métriques, syntaxiques et rhétoriques
La première chose qui saute aux yeux est le fait que la première version n’est pas un sonnet à proprement parler, mais une variante (une sorte de « sonetto caudato », ce qui en espagnol sera le « soneto con estrambote », même si généralement les vers ajoutés sont au moins trois, alors qu’ici il n’y en a qu’un, le v. 15). Dans les deux autres versions, Ungaretti parvient à rester dans la limite imposée par cette strophe, les quatorze vers. Cela montre déjà une première difficulté, qu’il parvient à surmonter dans ses tentatives successives. La première version est aussi la seule à présenter un titre, absent dans l’original, et qui sera éliminé par la suite par le traducteur, sans doute ressenti comme redondant. Une deuxième observation d’ensemble montre qu’aucune des trois traductions ne respecte les rimes de l’original, rimes qui brillent par leur absence, sauf dans la première version, notamment dans les deux tercets, quoique de manière irrégulière (« dorata : mutata » ; « lucente : confusamente : niente »). Ceci est un cas assez unique dans les traductions des sonnets, car en général Ungaretti essaie de maintenir un schéma rimique, sinon complètement régulier, tout au moins approximatif, parfois en tirant parti des assonances ou autres figures phoniques, même si seul un sonnet sur vingt présente un schéma régulier de rimes consonantes. A cela s’ajoute le fait qu’Ungaretti n’a pas pu éviter deux rimes « sdrucciole » (proparoxytones) aux vv. 5-6, absentes dans l’original, et qui ne sont pas souvent utilisées dans la poésie italienne, sinon dans le genre burlesque ou satirique (je pense, par exemple, aux tercets des Satire de l’Arioste). Ungaretti choisit un des sonnets les plus structurés de Góngora, dans lequel le poète baroque utilise l’artifice du schéma « diseminativo-recolectivo », pour reprendre la terminologie de Dámaso Alonso,(22) c’est-à-dire une variante des classiques versus rapportati. Le tissu métaphorique de ce sonnet dissocie les quatre parties anatomiques de la femme (les figurés : « cabello » (A), « frente » (B), « labio » (C), « cuello » (D)) des quatre attributs qui lui sont rapportés (les figurants : « oro » (A’), « lirio » (B’), « clavel » (C’), « marfil » (D’)), pour les réunir dans le premier tercet, mais dans un ordre différent pour les figurés (« cuello » (D), « cabello » (A), « labio » (C), « frente » (B), v. 9) alors que pour les figurants est maintenu l’ordre d’apparition (« oro » (A’), « lirio » (B’), « clavel » (C’), « cristal » (D’), v. 11). On aura remarqué le changement du figurant D’, qui passe de « marfil » (l’ivoire) du v. 8 au « cristal » du v.11. Il s’agit, chez Góngora, de la recherche d’une variatio à l’intérieur d’un schéma assez répétitif. Le dernier vers, qui est toujours le plus important dans un sonnet, est aussi construit sur une série énumérative de noms qui évoquent la mort, dans un climax décroissant qui se termine par l’indéfini « nada ». Notons également, que les deux quatrains présentent une structure très régulière, avec la répétition anaphorique de l’adverbe temporel « mientras » qui se répète quatre fois. Il s’agit donc, comme on peut le voir, d’un sonnet où le corset formel est très étroit, absolument évident et recherché. Si nous considérons maintenant le travail du traducteur dans sa dimension diachronique, nous pouvons constater des changements qui vont tous dans un sens de plus grande fidélité envers cette structure formelle très rigide de l’original. Dans les trois versions est respectée l’anaphore constitutive des deux quatrains (« mientras » : « finché ») ; les quatre figurés sont également présents, quoique pas toujours au même vers que dans l’original (« frente », v. 4 : « fronte », v.3 ; « labio », v. 5 : « labbro », v. 6), alors que les figurants respectent leur place (« oro », v. 2 : « oro » v. 2 ; « lirio », v. 4 : « gigli », v. 4 ; « clavel », v. 6 : « garofano », v. 6 ; « marfil », v. 8 : « avorio », v. 8). La première reprise des figurés au v. 9 présente dans les trois versions italiennes la même inversion syntaxique du verbe à l’impératif, « goza », qui occupe la première place dans l’original et la dernière dans les trois versions (« godi ») ; ceci n’est pas la seule liberté que le traducteur s’accorde, car au lieu de reprendre les mêmes mots, il choisit des variations métonymiques, et sans respecter l’ordre d’apparition : «labio » devient « bocca » (‘bouche’) et occupe la première position, « cabello » devient « chioma » (‘chevelure’) et se maintient en deuxième position, alors que « collo » passe de la première à la troisième position. Ungaretti fait donc précéder les deux éléments figurés qui ont subi un changement dans l’axe syntagmatique (« bocca », « chioma ») aux deux qui ne constituent que des répétitions de termes déjà apparus. On remarque donc, à ce niveau de la dispositio, une volonté de variation aussi bien au niveau sémantique (les métonymies) que syntaxique (l’anastrophe qui déplace le verbe en fin de vers). Notons également l’introduction d’un adverbe de temps (« ora »), absent de l’original, et qui sera enlevé dans la troisième version de 1951. Qu’en est-il des figurants ? La situation est plus complexe, car Ungaretti opère des variations à la fois par rapport à l’original et par rapport à ses trois versions. Dans la version de 1932, nous assistons au changement sémantique remarquable de « clavel » par « fuoco » (qui accentue le plan métaphorique, celui de la passion, qui n’était pas présent de façon aussi explicite dans le « clavel » du texte original), outre les variations dans la dispositio : « oro, lirio » s’interchangent leurs places respectives (avec le passage du pluriel au singulier: « i gigli » : « il giglio ») ; dans la version de 1948, Ungaretti récupère le « garofano » (‘œillet’) mot gênant car composé de quatre syllabes, mais il est alors obligé à renoncer à un élément (le « lirio ») afin de garder l’adjectif (qui passe de « lucente » à « lucido ») ; finalement, dans la version de 1951, il parvient à récupérer les quatre figurants en renonçant à l’adjectif, mais en changeant encore une fois l’ordre d’apparition. Ceci est dû sûrement à des problèmes de rythme, car cette disposition finale lui permettait de construire un « endecasillabo a minore», avec un accent sur la quatrième syllabe (« garòfano »), une césure après la cinquième et un deuxième accent sur la huitième syllabe (« cristàllo »). Nous sommes néanmoins, comme l’a fait remarquer Contini, face à des « endecasillabi limite ».(23) Ceci est particulièrement vrai pour le dernier vers, qui a donné bien du fil à retordre au traducteur italien. Rappelons que dans la première version, il faisait office de « coda », mais il parvenait néanmoins à conserver les cinq éléments du texte original, dans le même ordre. Dans la deuxième version de 1948, ce vers devient le dernier du véritable sonnet, mais on remarque qu’un élément a disparu : l’ «ombra », ce qui oblige à lire ce vers avec une diérèse sur « nïente » afin d’obtenir les onze syllabes. La version finale reprend la version primitive, en réintroduisant le cinquième élément exclu (« ombra »), et en le maintenant à la même place, ce qui oblige à faire une synalèphe forcée entre « polvere » et « ombra », ce dernier mot commençant par une voyelle tonique, une condition qui d’habitude proscrit la synalèphe. On peut s’interroger, au vu des changements dans la dispositio opérés dans les vers précédents, pourquoi Ungaretti n’a-t-il pas opté, dans ce dernier vers, pour unir « fumo » avec « ombra », afin de réduire quelque peu la synalèphe forcée, puisqu’il s’agirait d’unir deux voyelles identiques. L’explication de ce choix est bien claire : c’est la gradatio de ce dernier vers qui importe le plus, ce qui rend absolument impossible de changer de place les éléments qui y sont énumérés : l’ombre est vraiment la dernière chose perceptible avant le « nada » final.
Il nous faudrait aussi revenir brièvement sur quelques points stratégiques qui ont posé problème à Ungaretti et qui sont dus, en partie, à l’édition qu’il maniait, et en partie à sa propre mauvaise compréhension du texte, du moins dans la première version. On aura remarqué qu’au v. 2, l’édition d’Escuer lit « al Sol », alors que la logique (ce que les autres éditions confirment) voudrait que ce soit « el Sol », en tant que sujet grammatical de la phrase (comme c’est le cas pour les autres figurants, p. ex. « el lirio »). Cette mauvaise lecture de l’édition ancienne choisie par Ungaretti l’oblige à reconstruire une lecture qui pose comme sujet « oro », lequel resplendit au soleil et devient un vain compétiteur des cheveux de la dame. Ce n’est pas bien grave, et au fond la version d’Ungaretti est tout aussi valable. En revanche, le masculin « negletto », qui apparaît dès la version de ’48 en remplacement du féminin « sdegnosa », suppose un changement notable de perspective. En effet, dans l’original le sujet est bien « la blanca frente » laquelle « mira [...] con menosprecio [...] el lirio bello ». Or, dans le passage au masculin « negletto », c’est le « giglio » qui devient le sujet, « négligé » par la « fronte bianca », ce qui est rendu encore plus clair dans la version de ’51, où cet adjectif apparaît entre deux virgules, pour marquer sa distance d’avec le nom auquel il se rapporte, « il giglio bello » qui n’arrive qu’à la fin du vers suivant. Dans ce cas on voit que la première version était plus fidèle à l’original que les deux autres. Peut-être cela peut-il s’expliquer par l’apparition au v. 7 de « desdén lozano», qui passe de « orgogliosa gaiezza » de la première version à « sdegnosa ... allegria » (’48) et « allegria / sdegnosa (’51). Or, « sdegnoso » est un adjectif qui traduit littéralement le substantif « desdén », et se situe à un même niveau dans le deux langues. Mais ce changement impliquait d’éviter la répétition avec le « sdegnosa » du v. 3 de la version de ’32, qui devient donc « negletto », ce qui implique ce changement de perspective que nous avons indiqué. Plus problématique, en revanche, est la compréhension du dernier tercet dans la première version, en particulier du v. 13, ce qui est la cause, je pense, de l’allongement inhabituel du sonnet d’un vers. Les versions postérieures montrent que le traducteur a compris le sens de ce vers, ce qui ouvre la voie à la possibilité d’une construction plus fidèle à l’original et au maintien du sonnet dans le cadre canonique des quatorze vers. Dans ce cas, les versions postérieures sont meilleures par rapport à la première : il y a donc un progrès certain. On peut également s’interroger, dans les deux quatrains, sur le choix que fait le traducteur par rapport au mode verbal : il remplace des formes du présent de l’indicatif (« relumbra », « mira », « siguen », « triunfa ») par des formes du présent du subjonctif (« sia splendore » / « vada splendendo » ; « veda » / « ammiri » ; « attragga »/ « inseguano » ; « vinca » / « luca »). Ce changement de mode introduit une virtualité qui n’existe pas dans l’indicatif du texte original. C’est comme si Ungaretti avait donné à son « finché » le sens final d’ « affinché », qui exige le subjonctif, alors que « finché » est normalement suivi de l’indicatif (comme dans le dicton : « finché c’è vita c’è speranza », ‘tant qu’il y a de la vie il y a de l’espoir’). Je trouve cette conjonction toujours suivie de l’indicatif chez Dante (« Fin che la casa amata il fa gioire », Purg. XVIII, 33 ; « fin che si mostra », Par. XXXI, 106 ; « fin ch’el pote », Inf. XVI 125). Je trouve, en revanche trois cas de « finché » suivi de subjonctif chez le Pétrarque lyrique des Rerum vulgarium fragmenta : « fin che si svella / da me l’alma » (RVF, 206, v. 35-36) ; « « fin che mi sani colei che ‘l morse » (RVF 29, 17) ; « fin che l’ultimo dì chiuda quest’occhi », RVF 30, 18 ; il existe néanmoins, dans ce Canzoniere un cas suivi de l’indicatif : « fin che mia dura sorte invidia n’ebbe », RVF 331, 38. Dans l’autre œuvre poétique écrite en toscan, les Trionfi, en revanche, cette conjonction est toujours suivie de l’indicatif: « fin che nel regno di sua madre venne » (Triumphus Cupidinis, IV, 96 ; « fin che Morte il suo assalto ebbe fornito » (Triumphus Mortis, I, 156). On le voit, Ungaretti s’inspire surtout du Pétrarque lyrique, celui du Canzoniere, en accord avec la ligne pétrarquiste dans laquelle il aimait se situer. Dans le cas présent, cependant, on peut s’interroger sur le bien-fondé de cette solution, car l’indicatif de l’original indique bien le moment présent, réel, celui du « carpe diem », alors que le subjonctif renvoie cette dimension dans le domaine du possible, ce qui semble contredire précisément cette insistance sur la jouissance effective et concrète des attraits de la jeunesse, que la belle doit mettre à profit pendant qu’il est encore temps de le faire, avant que l’or de ses cheveux ne se transforme en argent.
7.1 Choix métriques, syntaxiques et rhétoriques
Au niveau des choix lexicaux, on constate également une évolution vers une approximation progressive du niveau de langue de l’original. On constate en effet, que les principaux « cultismi » utilisés par Ungaretti font leur apparition dans les versions de ’48 et de ’51, alors que la première de ’32 présentait un niveau de langue plus proche de l’italien standard. C’est ainsi que l’ « oro cupo » devient « oro brunito », un adjectif rare en italien mais qui rejoint littéralement le « bruñido » de l’original, où ce mot était, en revanche, d’un registre plus familier (presque technique) ; il s’agit donc d’un « cultismo » qu’on pourrait qualifier de « gratuit » ou « forcé », car il n’en était pas un dans l’original ; l’adjectif « sdegnosa » passe à « negletto », d’usage nettement plus élevé et recherché (Dante, Paradiso, VI, 47, « del cirro / negletto », mais dans une acception un peu différente, car il sert à caractériser un personnage de l’Antiquité, Quinzio, qu’on avait surnommé ‘à la coiffure négligée’; XXVII, 143, Pétrarque, RVF, 270, 62 et Triumphus Famae, II, 141), le « precoce garofano » devient dans les versions successives le « primulo garofano », avec un adjectif de formation néologique (dérivé de l’adverbe latin primulum, ‘en premier’) qu’on pourrait également qualifier de « cultisme » forcé, car il traduit l’adjectif « temprano », d’un emploi tout à fait courant dans l’espagnol de l’époque; nous constatons aussi la récupération de « sdegnosa » (v. 7) qui vient remplacer l’ « orgogliosa » du v. 7 de la version de ’32, un adjectif qui est maintenu dans la version finale mais en position de rejet, dans l’enjambement « allegria / sdegnosa » (vv. 7-8), un enjambement qui souligne la rupture sémantique implicite dans ce syntagme. Cette partie du sonnet est d’ailleurs celle qui a subi la plus forte variation dans la dernière version, notamment par le choix du verbe « luca », (subjonctif de « lucere », ‘luire’) qui permet de récupérer, à travers un cultisme assez recherché, les adjectifs « lucente » ou « lucido » des deux versions primitives, sacrifiés, comme on l’a vu, afin de maintenir la stricte correspondance entre les quatre figurants du v. 11. Le verbe « lucere » est utilisé - à l’indicatif - seulement deux fois sur les vingt-neuf occurrences de ce mot dans le Canzoniere de Pétrarque, dont une en position de rime équivoque : « Quand’io son tutto vòlto in qualla parte, / ove ‘l bel viso di madonna luce / e m’è rimas anel pensier la luce », RVF, 18, 1-3 ; « o piacer onde l’ali al bel viso ergo, / che luce sovra quanti il sol ne scalda », RVF, 146, 7-8 ; il apparaît aussi une fois avec valeur verbale dans le Triumphus Famae III, 39), et il n’apparaît qu’une fois chez Dante (Purgatorio, V, 4-5 : « una gridò : « Ve’ che non par che luca / lo raggio da sinistra a quel di sotto « ) . Le dernier changement qui va dans ce sens est le passage de « viola appassita » (’32) à « viola tronca » (’48), écho littéral du « troncada » de l’original, pour terminer sur le syntagme « viola vizza » (’51), où l’adjectif « vizza » sort tout droit d’un vers de Dante (Purgatorio, XXV, 27 : « ciò che par duro ti parrebbe vizzo ») et est absent du lexique de Pétrarque. Remarquons, à ce propos, que ce dernier changement n’est pas dû à des questions de rythme, car « tronca » et « vizza » ont le même nombre de syllabes : c’est donc un choix délibéré de l’auteur pour conférer à sa traduction un ton plus en adéquation avec le « culteranismo » du poète espagnol. A noter un dernier « cultismo » introduit par Ungaretti, qui traduit littéralement (à partir de la version de ’48) « se vuelva » en « si volga », en gardant la même acception espagnole de « devenir, se transformer », qui en italien est exclusivement du domaine littéraire (on la retrouve encore chez Dante : « la tema si volge in disio », Inferno, III, 126). Pour finir, on aura remarqué le choix assez surprenant de l’indéfini « niente » à la place de son compétiteur « nulla », qui appartient à un niveau stylistique plus soutenu. Un comptage rapide permet de constater que dans l’œuvre poétique de Pétrarque (Canzoniere et Trionfi) on retrouve « niente » seulement quatre fois dans la première œuvre (il est absent de la seconde), contre les vingt-neuf occurrences de « nulla » ; chez Dante, « niente » n’apparaît que deux fois dans toute la Divine comédie, alors que « nulla » est utilisé quarante-quatre fois. Il est vrai que « niente » apparaît chez Pétrarque à des endroits stratégiques, notamment dans le sonnet 179, où il occupe la place de mot-rime dans l’avant-dernier vers du sonnet (« ogni altra aita, e ‘l fuggir val nïente » RVF 179, 13), alors que chez Ungarettti il occupe le dernier vers, pour respecter la gradatio du poème original qui terminait avec l’indéfini « nada »; dans un autre sonnet de Pétrarque, le 335, « nïente » occupe la première place du deuxième quatrain (« Nïente in lei terreno era o mortale », RVF 335, 5), un endroit également stratégique dans le sonnet de Góngora, où est placé un autre adverbe de temps, le « mientras » répété quatre fois et qu’Ungaretti respecte scrupuleusement dans sa traduction (« finché »), comme on l’a vu. Ungaretti a gardé cet indéfini dans les trois versions, malgré le déplacement progressif que nous avons constaté vers un ton plus élevé. Ceci est sans doute dû au fait que dans la première version, celle de 1932, cet adverbe participait d’un système rimique encore vaguement respecté dans les tercets (« lucente » : « confusamente » : « niente »). Or, malgré le fait que dans les versions successives ce système rimique disparaisse complètement, le maintien de cet adverbe, qui a toujours une valeur bisyllabique comme son compétiteur « nulla », peut être considéré comme la trace permanente et tenace d’une prédilection pour des textes de Pétrarque qui avaient marqué profondément Ungaretti : je pense tout particulièrement au sonnet 179, cité plus haut, qui appartient au genre de la tensò où Pétrarque répond en utilisant les mêmes rimes à un poème que lui avait adressé son ami Geri de’ Gianfigliazzi, dans lequel l’indéfini « niente » occupait donc la même place. C’est un sonnet qui insiste tout particulièrement sur le « sdegno » (le ‘dédain’) de la bien-aimée, qui se manifeste notamment par son regard, auquel l’amant doit faire face pour essayer de le tempérer. Mais même le sonnet 335 peut être mis en relation avec le texte de Góngora, car il s’agit d’une vision de la bien-aimée dans un au-delà postulé par le dernier vers du poète baroque espagnol : « Nïente in lei terreno era o mortale » (RVF, 335, 5). Nous retrouvons dans ce vers toute l’atmosphère du dernier vers de Góngora, qui a dû s’en inspirer, en transformant l’adjectifs « terreno » en substantif, qui devient le premier élément de sa gradatio (« tierra ») alors que l’autre adjectif « mortale » fait allusion au terme final de cette même gradatio, la « nada », métaphore ultime de la mort.
Conclusion : Góngora à la lumière de Pétrarque
Aux références à l’œuvre de Pétrarque que nous avons décelées par le biais du lexique commun, donc par voie indirecte, il faut ajouter celles qui sont explicitées par Ungaretti lui- même. Dans son essai « Góngora al lume d’oggi », Ungaretti revient longuement sur ce sonnet, et cite deux textes de Pétrarque qui contiennent les principales métaphores réutilisées par le poète baroque espagnol. Il s’agit du sonnet 157 « Quel sempre acerbo et onorato giorno », dans lequel Pétrarque évoque le jour de sa première rencontre avec Laura et en fait une description « in absentia » dans les deux tercets (« La testa or fino, e calda neve il volto, / ebeno i cigli, e gli occhi eran due stelle, / onde Amor l’arco non tendeva in fallo » RVF 157, 9-11). Il s’agit donc d’un texte qui appartient au cycle « in vitam », contrairement à l’autre texte cité par Ungaretti, le sonnet 292 « Gli occhi di ch’io parlai sì caldamente », composé « in mortem », c’est-à-dire après la mort de Laura. Dans ce sonnet, le poète toscan évoque dans le deuxième quatrain la figure de sa bien-aimée avec des métaphores qui ont servi de base à l’écriture de l’auteur espagnol : « Le crespe chiome d’or puro lucente / e ‘l lampeggiar de l’angelico riso / che solean fare in terra un paradiso / poca polvere son, che nulla sente » (RVF 292, 5-8). Nous retrouvons, dans ce dernier vers, deux autres éléments du dernier vers de Góngora : « polvere » (« polvo ») et « nulla » (« nada), qui viennent compléter les éléments empruntés au sonnet 335, comme nous venons de le voir. Or il est intéressant de constater que selon Ungaretti dans ces deux textes « Pétrarque évoque, splendide et douce de beauté, une défunte, et fait ressentir combien mélancolique est le souvenir, malgré le fait qu’il soit à l’origine de sa poésie ».(24) C’est une réflexion symptomatique de l’auteur du Sentimento del tempo, car pour lui il n’y a aucune différence entre le souvenir et la mort. Chez Pétrarque, il constate que les objets sont présents seulement dans l’esprit, dans le silence, alors que Góngora procède par des « éclats de trompettes », en faisant ressentir au plus près les sensations évoqués, la sensualité exacerbée et qui reste à peine effleurée chez Pétrarque. Après le dernier vers de Góngora, d’après Ungaretti, « dans le sang et dans les os de celui qui écoute restera une sensation, ineffaçable, de déchirement, de désastre, d’annihilation éprouvée jusqu’au bout ».(25) C’est sans doute cet effet de réel, ce contraste si saisissant entre la vie et la mort auquel l’auteur baroque parvient à nous faire participer, tout en restant « ligio a Petrarca », le motif prépondérant de l’intérêt porté à ce texte par Ungaretti, qui l’a occupé durant presque deux décennies et qui est le seul qu’il a traduit trois fois. C’est le « miracle » du pétrarquisme qui parvient à rester fidèle à soi-même malgré un changement de signe on ne peut plus radical.
Appendice: Les textes
NOTES
(1) Cf. les travaux de Erasmo Buceta, « De algunas composiciones hispano-latinas en el siglo XVII », Revista de Filología Española, XIX (1932), p. 388-414; du même auteur: “La tendencia a identificar el español con el latín”, dans: Homenaje a Ramón Menéndez Pidal, Madrid, Hernando, 1925, t. I, pp. 85-108.
(2) Je cite la traduction de Isabel Violante Picon, « Une œuvre originale de poésie » : Giuseppe Ungaretti traducteur, Paris, Presses de l’Université de Paris-Sorbonne, coll. Jalons, Paris, 1998, p. 121.
(3) Op. cit.
(4) Z. Milner, « Góngora et Mallarmé : la connaissance de l’absolu par les mots », L’Esprit Nouveau, 3 (1920).
(5) Cf. Francesco Flora, La poesia ermetica, 1936 (Bari, 1942, 2e éd.).
(6) Cf. Vittorio Bodini, « Spagnoli et italiani », Il Mondo (21 mars 1961). (Notre traduction.)
(7) Cf. Z. Milner, art. cit.
(8) Ibid.
(9) Severo Sarduy, « La métaphore au carré », Tel Quel, 25(1966), repris dans le volume Barroco, Paris, Gallimard, Folio, 1991, pp. 193-201. (Cit. dans Picon, p. 120, n. 8)
(10) Texte lu à l’Institut Espagnol de Rome le 9 mai 1951, publié dans la revue Aut Aut, (juillet 1951), pp. 291-308, et publié dans : G. Ungaretti, Vita d’un uomo. Saggi e interventi, éd. Mario Diacono et Luciano Rebay, Milan, Mondadori, I Meridiani, 1986, 4e éd., pp. 528-550. Nous citons la traduction de I. V. Picón, op. cit. p. 122.
(11) Cf. Z. Milner, art. cit. p. 290.
(12) Article publié dans la revue Primato en mai 1943.
(13) Sur ce sonnet, cf. les analyses de Nadine LY, « Quelle langue pour un poème ? », dans : Pays de la langue. Pays de la poésie, Actes du colloque de Pau (27-29 novembre 1996), ed. Annick Allaigre-Duny, Pau, 1998, pp. 199-213 ; du même auteur, cf. aussi « Mots et regards croisés : Garcilaso, sonnet 22, Pétrarque, chansons 23, 37, 70 et 72 et sonnet 38, Sannazaro et les autres... », dans : « Voix croisées, mots croisés », Cahiers du centre interdisciplinaire de méthodologie, Bordeaux, n. 10, 2008, pp. 51-63 ; nous avons également étudié ce sonnet de Garcilaso dans : E. Canonica « L’intégration du sonnet pétrarquiste dans la poésie espagnole du siècle d’Or : conquêt et dépassement du modèle », Constitution, circulation et dépassement de modèles politiques et culturels en péninsule Ibérique, Université Michel de Montaigne, Bordeaux , Ameriber (Erpi), éd. Ghislaine Fournès et Jean-Michel Desvois, Bordeaux, Presses Universitaires, Collection de la Maison des Pays Ibériques, 2009, pp. 403-423 (en particulier p. 413).
(14) Cf. « Góngora al lume d’oggi », art. cit. p. 529.
(15) Je traduis de La Fiera letteraria (dimanche 12 août 1951).
(16) Cf. G. Ungaretti- J. Amrouche, Propos improvisés, mise au point Ph. Jaccottet, Paris, Gallimard, 1972, pp. 119-120.
(17) C’est celle de R. Foulché-Delbosc, New-York, The Hispanic Society of America, 3 vols.
(18) C’est celle de Juan e Isabel Millé y Giménez, Madrid, Aguilar.
(19) Je traduis de : Ungaretti-De Robertis Carteggio 1931-1962, Milan, 1984, p. 115.
(20) Poemas y sonetos, Buenos Aires, Losada, 1940.
(21) Cf. José Pascual Buxó, Ungaretti y Góngora. Ensayo de literatura comparada, UNAM, México, 1978, 193 pp. (sur ce sonnet, cf. en particulier les pp. 75-97). Un article a été consacré à cette problématique par Dario Puccini dans les Actes du Colloque d’Urbino sur Ungaretti de 1979 : « Ungaretti traduttore di Góngora », dans: Atti del Convegno Internazionale su Giuseppe Ungaretti, a cura di C. Bo, M. Petrucciani, M. Bruscia, M.C.Angelini, E. Cardone, D. Rossi, Urbino, 1981, vol. I, pp. 513-527. Je renvoie également à un mémoire de licence soutenu en 1990 à l’Université de Fribourg (Suisse) par Sofia Armanini, Cultismi in cattiva grammatica. Ungaretti traduce Góngora (exemplaire dactylographié déposé à la Bibliothèque Cantonale et Universitaire de Fribourg).
(22) Dámaso Alonso, Poesía española. Ensayo de métodos y límites estilísticos, Madrid, Gredos, 1966, 5e éd., pp. 438-439. En allemand on parle de « Summationschema ».
(23) G. Contini, “Di un modo di tradurre”, in: Un anno di letteratura, Firenze, 1942, p. 134 (republié dans: Esercizi di lettura, Torino, Einaudi, 1982, pp. 372-379).
(24) Cf. « Góngora al lume d’oggi », p. 534 (traduction personnelle)
(25) Op. cit., p. 536 (traduction personnelle).