 |
| Édouard Louis © Jean-Luc Bertini |
Édouard Louis : « La littérature est un grand art de la cause » (Le grand entretien)
Johan Faerber
A
près le juste succès de son premier roman En finir avec Eddy Bellegueule, Édouard Louis est revenu en 2016 avec Histoire de la violence, âpre et magistral roman, qui évoque cette terrible nuit de Noël 2012 où il rencontre Reda avec qui la douceur des premiers instants va tourner à la violence la plus nue et la plus sombre. Diacritik avait rencontré Édouard Louis en janvier 2016 pour évoquer avec lui ce roman, nous republions cet entretien alors qu’Histoire de la violence sort en poche aujourd’hui, chez Points.
La première question que je voulais vous poser concerne l’expérience de dépossession qui me paraît être au cœur de votre roman : Histoire de la violencecommence au moment de la falsification de l’histoire, quand vous vous sentez dépossédé de votre expérience propre. Le roman se donnerait ainsi comme l’histoire de cette confiscation. À ce titre, il me semble que restituer une expérience, quelle qu’en soit sa nature, est au cœur de votre écriture même ?
Édouard Louis : C’est cette caractéristique essentielle et cette tragédie de nos vies que je voulais mettre en avant dans le livre : nos vies sont toujours racontées, et donc confisquées par les autres. Il n’y a pas d’existences ou d’expériences qui ne soient pas ensuite prises dans les narrations des autres, dans leurs discours et dans leurs mots. Qui n’a jamais été blessé en entendant dire des choses fausses sur elle ou sur lui, des choses qui ne correspondaient pas à ce qu’elle ou ce qu’il est, qui falsifiaient ce qu’elle ou il avait vécu ?
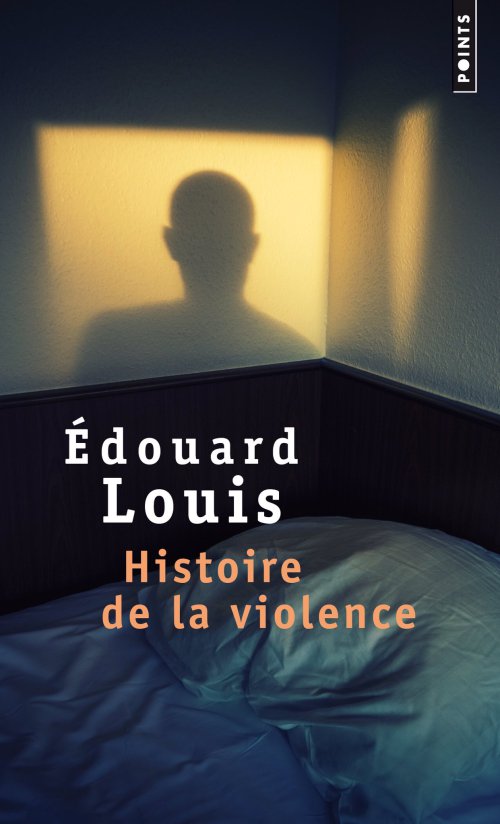
Histoire de la violence part d’un huis clos : je rencontre un garçon un soir place de la République, en bas de chez moi, Reda, il m’aborde. Il vient dans mon minuscule appartement – qui constitue justement la scène du huis clos – il se passe quelque chose de très fort entre lui et moi, comme le début d’une passion, il me parle beaucoup de son passé, de sa vie, on passe la nuit à deux, on parle, on rit, on fait l’amour, et à un moment donné, la nuit bascule, il devient violent, incontrôlable, il m’étrangle, il sort un revolver qu’il braque sur moi.
Or ce huis clos dans le livre est raconté par quelqu’un d’autre que moi. C’est ma sœur qui raconte ce qui s’est passé avec Reda, quelques semaines plus tard. Je suis chez elle – je retourne la voir après des mois d’absence et de séparation, dans le petit village du Nord où nous avons grandi ensemble, et alors que je me repose dans sa chambre, je l’entends dans la pièce d’à-côté restituer mon histoire à son mari. Donc le livre commence dans la confiscation et la dépossession puisqu’une histoire que j’ai moi-même vécue est racontée par quelqu’un d’autre que moi. Et ce qui se passe c’est que pendant tout le livre, quand ma sœur, Clara, revient sur la nuit que j’ai passée avec Reda, ce qu’elle dit ne correspond jamais vraiment à ce qui est arrivé cette nuit-là. Il y a toujours un écart entre ce que je suis, ce que j’ai vécu, et ce qu’elle dit que je suis et que j’ai vécu.
Il y a une rupture entre mon premier roman, En finir avec Eddy Bellegueule et celui-ci. Quand j’ai publié Eddy Bellegueule, je disais que c’était un livre sur le façon dont le langage des autres nous définit, par exemple avec l’injure : « Tu n’es qu’un pédé, tu n’es qu’une femme, sale juif, sale arabe », comment ces mots des autres construisent notre identité – souvent contre nous, en dépit de nous. Didier Eribon a écrit des pages sublimes sur l’injure dans Réflexions sur la question gay.
Dans Histoire de la violence, c’est autre chose qui se passe : ma sœur parle de moi, de ce que je suis, mais ses mots ne me constituent pas, ne correspondent pas à mon expérience, au contraire, il y a un décalage, une distance immense entre ce qu’elle dit de moi et ce que je suis réellement. Et la souffrance nait de là, de cet écart, de cet échec du langage.
À ce titre, à la lecture du roman, une phrase de Barthes m’est revenue à l’esprit selon laquelle en écrivant, on ramasse tout ce qui traîne dans la langue. Dans En finir avec Eddy Bellegueule et dans Histoire de la violence, se dit, me semble-t-il, un processus qui cherche à achever et à faire le deuil du langage des autres : comme si, en fait, l’écriture était un exercice de deuil mais qui se compensait à la fin du roman par l’espoir d’une renaissance. L’écriture paraît porter ici chez vous un double espoir : d’une part, se défaire du langage des autres et, d’autre part, tenter une réappropriation de son propre langage.
Toute la construction formelle d’Histoire de la violence porte la trace de cette dépossession, mais aussi, comme vous dites, de la réappropriation. Quand ma sœur parle à son mari de ce que j’ai vécu avec Reda, plus on approche de la fin du livre et plus je me défais de ce qu’elle dit. Je pense : « Ne l’écoute plus, ne l’écoute plus. » et j’interromps ses monologues pour tenter de dire moi même ce qui est arrivé. Dans une des premières versions d’Histoire de la violence d’ailleurs, la première phrase du livre était « Maintenant c’est moi qui parle ».
Je ne me reconnais pas dans le thème du deuil – au sens de faire son deuil – parce que pour moi il est trop marqué par la thérapie, la catharsis, tout ce champ lexical. On me demande souvent si, quand j’écris, c’est de la catharsis que je fais. Mais je ne pense jamais à ça. Quand j’écris, je n’essaye pas d’échapper à la souffrance, au contraire, je la cherche. Parce que je crois qu’il y a tant de violence dont on ne souffre pas. C’est terrible. Clara, la sœur dans Histoire de la violence, quand elle raconte le huis clos entre Reda et moi, elle parle aussi d’elle, de sa vie dans un petit village ouvrier du Nord, une vie très dure, pauvre, faite de beaucoup d’ennuis et de difficultés, elle décrit cette vie et, en même temps, elle n’arrête pas de dire qu’elle n’a pas à se plaindre, que sa vie pourrait être pire. La violence s’abat sur elle de manière tellement systématique, qu’à force elle dit qu’elle n’en souffre pas. La violence devient tellement évidente qu’elle ne l’appelle plus « la violence » mais « la vie ». Alors j’utilise l’écriture pour trouver, pour faire apparaitre cette souffrance que l’on peut finir par ne plus éprouver.
J’ai souvent dit que la grandeur du féminisme, d’auteures comme Violette Leduc et Simone de Beauvoir, par exemple, était de nous avoir appris à souffrir. Ces auteures ont fait apparaître le genre et la domination masculine alors qu’avant, ces réalités n’étaient pas forcément – je dis bien pas forcément – perçues, parce qu’elles étaient considérées comme naturelles, évidentes. Beauvoir et Leduc nous ont permis de percevoir une violence dont on ne souffrait pas toujours parce qu’elle se présentait avec l’apparence du toujours-ainsi, et cette souffrance qu’elles permettent, qu’elles rendent dicible peut constituer le point de départ de la révolte.
J’ai été très frappé par le caractère précisément très littéraire du roman. Histoire de la violence s’offre comme un très bel objet formel et j’aurai voulu savoir à quel moment vous avez décidé, dans l’écriture du livre, de déléguer votre parole et l’essentiel du récit à votre sœur ? Est-ce que ce dispositif formel vous a étéinspiré de Faulkner dont vous parlez par ailleurs dans de très belles pages d’interlude du roman où vous évoquez la fuite de Temple dans Sanctuaire ?
C’est un dispositif que j’ai mis beaucoup de temps à trouver. Au début, dans les premières versions du roman, je revenais sur ce qui s’était passé cette nuit-là, cette nuit du 24 décembre, et je restituais aussi ce que Reda m’avait dit de lui, de son passé, de son histoire, de l’arrivée de son père en France, et qui a vécu plusieurs années dans un foyer Sonacotra. Je voyais bien que ce n’était pas suffisant. Je ne pouvais pas faire comme si Reda était un sujet historiquement déterminé, historique, socialement déterminé et comme si moi j’étais une sorte de sujet pur, qui arrivait là comme ça, cette nuit-là, place de la République. Alors j’ai cherché un dispositif littéraire qui me permettrait de montrer que je suis tout autant un personnage de cette histoire que Reda, que moi aussi quand je le rencontre je porte avec moi un passé, une vie, une enfance qui me détermine. Paradoxalement, en revenant sur mon enfance dans le livre, à travers ma sœur qui l’évoque, je devenais moins le centre de cette histoire, je me dissolvais dans une histoire qui me dépassait.
La forme du livre est marquée par Faulkner oui – notamment parce que c’est une femme qui parle, comme souvent dans les romans de Faulkner – mais c’est surtout un thème faulknérien qui hante le livre : celui de l’impossibilité de fuir. « They endured », disait Faulkner à propos de ses personnages, « ils endurèrent » leur vie, plutôt que de la fuir. Qu’est ce qui fait qu’on a autant de mal à s’arracher à une situation, à une interaction. Dans Histoire de la violence, quand dans le huis clos Reda sort son revolver et qu’il me menace, jamais je ne pars, jamais je ne quitte l’espace de cette chambre de seize mètres carrés alors que je pense que j’aurais eu la possibilité objective de le faire. Je reste face à Reda, j’essaye de le raisonner, de le calmer, je lui dis Arrête, Arrête, je tente de régler la situation à l’intérieur de la situation plutôt que de fuir la situation, comme si, comme je l’ai écrit dans le livre, la situation nous enfermait dans le cadre qu’elle pose, comme si la violence géographique était première, de la même façon que Temple, le personnage de Faulkner dans Sanctuaireest dans une maison avec un groupe d’hommes fous et dangereux et qu’elle ne fuit jamais cette maison alors qu’elle a peur, qu’elle sait qu’ils vont lui faire du mal. Jean-Luc Lagarce disait « Celui qui n’a pas quitté son pays à trente ans ne le quittera jamais ». Qu’est ce qui fait que nous sommes pris dans des situations comme dans les griffes d’un animal ? Que la fuite est aussi difficile, alors qu’elle est souvent la seule solution ? Pourquoi est ce qu’il est aussi impossible de sortir d’un cadre ? C’est le thème le plus faulknérien du livre.
À vous entendre, on perçoit combien une telle décision formelle dans le roman inverse une idée reçue sur la forme en littérature, à savoir ce préjugé tenace selon lequel la forme condamne celui qui écrit à s’éloigner de la matière et mettrait un filtre entre nous et le monde. Au contraire, chez vous, trouver une forme revient à être au cœur de la matière.
Oui, la forme m’a permis de dire des réalités que je n’aurais pas pu dire autrement, par un simple récit, linéaire.
De fait, quand on ouvre Histoire de la violence, avec un titre foucaldien qui fait songer à Histoire de la sexualité ou Histoire de la folie à l’âge classique, on s’attend à lire un essai et non un récit. Mais, précisément, qu’est-ce qui fait qu’Histoire de la violence n’aurait pas pu être un essai ? Pourquoi cela devait-il être obligatoirement un récit ?
Je ne sais pas si c’était une obligation, mais il y avait des réalités que j’arrivais à mieux exprimer par la littérature. Par exemple, la peur. C’est un sentiment, un affect qui revient énormément dans Histoire de la violence. Après la nuit avec Reda, quand je marche dans la rue j’ai peur. Quand je suis face aux policiers, j’ai peur de ce qu’ils vont me dire, j’ai peur qu’ils m’annoncent que la procédure va durer encore et encore. Le père de Reda, quand il habite dans le foyer Sonacotra, a peur des sanctions qui pèsent sur lui tous les jours – parce que ces foyers sont régis par des règles absurdes, arbitraires et violentes.
Je suis toujours étonné, à la fois par l’importance de la peur dans le monde social, dans la vie des individus, et son manque de thématisation dans la littérature. Sartre, quand il parle de littérature, notamment dans son livre d’entretien avec John Gerassi, évoque souvent ce qu’il appelle « les contradictions ». Et pour lui, les contradictions, c’est quand, dans une société, il y a un écart immense entre le monde et la représentation qu’on donne du monde en littérature. Quand j’ai commencé à écrire Histoire de la violence, je trouvais que la peur était un des centres de cette contradiction, qu’il fallait écrire sur la peur étant donnée son importance dans la construction de la subjectivité.
Il y a un livre d’une sociologue américaine, Alice Goffman, publié en 2015 je crois, le livre s’appelle On The Run. Fugitive Life in an American City, qui présente une très belle analyse de ce qu’être Noir aux États-Unis veut dire. Elle dit que les Noirs américains vivent dans un état de fuite permanente. Ils fuient le pouvoir, ils fuient la police parce qu’ils peuvent se faire tirer dessus à n’importe quel moment, sans raison. À l’école, ils fuient les enseignants parce qu’ils sont plus facilement sanctionnés que les enfants blancs. Et justement, cette fuite comme mode de vie naît du fait que l’existence des Noirs est structurée par la peur, parce qu’ils sont exposés à la dégradation voire à la destruction de leur corps par le racisme, que le risque de la destruction pèse sur eux sans cesse. Et si on pense à Ginsberg qui se définissait comme un « scared gay child » pour l’éternité, parce qu’enfant il avait peur de l’injure homophobe qui s’abattait sur lui et qui dit que cette peur à donc été constitutive de sa personne, dès les premières années de sa vie, si on pense encore une fois à toutes les réflexions de Didier Eribon sur la subjectivité gay, sur l’insulte comme une condition de la vie homosexuelle, on voit bien que la vie homosexuelle est traversée par la peur. La vie d’une femme aussi : une femme qui se promène seule dans la rue a souvent peur, Virginie Despentes a écrit sur cette peur aux fondements de l’expérience des femmes. À travers la littérature, j’avais envie de dire cette peur mais en même temps, d’où le titre Histoire de la violence, j’avais envie de faire le diagnostic de cette peur, en faire l’histoire, essayer de trouver les causes réelles de cette peur.
Du coup, quand est-ce que le titre Histoire de la violence vous est venu ? Est-ce que ce titre a été un déclencheur ou est-il arrivé plutôt vers la fin de l’écriture ? A-t-il rassemblé les fils d’un projet qui vous est alors apparu ou s’est-il imposéd’emblée ?
C’est un titre qui s’est imposé assez vite à moi en fait. Justement, vous parliez de Foucault, la question d’Histoire de la folie ou de l’Histoire de la sexualité, enfin une des questions de ces livres, c’est : comment à un moment donné, une violence surgit, qui va créer une frontière entre la folie et la raison, entre la sexualité normale et la sexualité pathologique ? Foucault fait l’histoire de l’émergence d’une violence qui s’abat tout à coup, et, à une toute autre échelle, Histoire de la violence aussi. C’est l’histoire d’un surgissement. Qu’est ce qui fait que soudain, la nuit avec Reda bascule, d’où vient cette violence ?
C’est d’ailleurs presque l’histoire d’une passion, presque plus du côté de Passion simple d’Annie Ernaux que d’un quelconque récit de témoignage sur comment, malheureusement, la nuit a pu mal tourner.
Je lis et relis jusqu’à l’obsession les tragédies grecques de Sophocle ou Euripide, et c’est vrai qu’il y a un ressort tragique qui est là en permanence dans Histoire de la violence, c’est que la passion est toujours liée à la destruction, lors de cette nuit-là en tout cas. Je ne veux pas dire qu’en général l’amour est lié à la destruction, bien sûr. Mais dans le roman, plus Reda me désire et plus on s’enfonce dans la passion tous les deux, plus la violence devient un risque, puisque Reda est à la fois est animé par un désir homosexuel, et à la fois, il déteste ce désir, il hait son propre désir puisqu’il hait l’homosexualité – quand il sort son revolver et qu’il me menace il me dit : « Tu vas crever sale pédé, tu vas crever sale pédale ». Il est comme animé ou plutôt déchiré par cette schizophrénie sociale, alors plus il va loin dans la réalisation de la passion, et plus il se rapproche de la destruction – plus on se rapproche de la destruction.
Il y aurait donc une hybris ?
En un certain sens.
Histoire de la violence pourrait être le roman d’une passion, effectivement, parce qu’on voit le récit comme une main tendue vers Reda. Ainsi des trois plus beaux moments du roman, parmi tant d’autres pourtant : quand Reda défie l’enseignante en classe, quand le père arrive au foyer d’immigrés et enfin la scène de votre enterrement fantasmé proche du Barthes des Fragments d’un discours amoureux.J’ai le sentiment que ces trois poches de fiction, ces trois échappées fabulatrices au cœur du récit sont un moyen pour vous de dire au plus près et au plus juste ce qui peut aller vers Reda. Tout se passe comme s’il y avait une dimension conativede la fiction.
J’avais envie de parler dans Histoire de la violence de l’enfance de Reda ou de l’arrivée de son père en France, de tout ce que Reda m’avait dit de lui la nuit de notre rencontre. Le problème, c’était que je manquais de détails et d’éléments, parce qu’on a parlé sur un temps très concentré lui et moi, très court. Il y avait trop de choses que je ne savais pas.
Dans un premier temps, j’ai essayé de construire des personnages fictionnels. J’ai inventé, par exemple, le personnage du directeur du foyer Sonacotra pour décrire la vie du père de Reda. C’est très étrange mais j’avais une forme de sentiment d’inauthenticité, en créant des personnages de toute pièce. Et puis, j’ai mis en place une technique pour dépasser ce sentiment de gêne, un procédé littéraire où je présente un personnage à travers un autre. Je me suis dit : si je ne connais pas le directeur de ce foyer où le père de Reda a passé quelques années, je vais parler de quelqu’un que j’ai connu, moi, par exemple dans le village de mon enfance, et qui pourrait ressembler au directeur du foyer. Quand je parle de la jeunesse de Reda, de son rapport à l’école, comme je ne savais pas grand chose non plus, je relate la jeunesse d’un de mes cousins qui ressemblait à Reda, pour essayer de comprendre ce que Reda a vécu. Ca me permet de dépasser l’opposition entre le récit et la fiction, à la fois de construire des personnages que je n’ai jamais vu, tout en mobilisant une connaissance intime, plus vraie, à travers des personnes que j’ai croisées dans ma vie, dont j’ai pu toucher la peau, sentir l’haleine.
Je ne sais pas si c’est une main tendue vers Reda, ce livre, mais c’est évident, il y a ce sentiment troublant dans le livre, qui est ma ressemblance avec Reda. J’ai un ami, il y a quelques jours, qui a lu mon livre et qui m’a envoyé, comme ça, un message de quelques mots : « J’aurais pu être Reda. ». Sa phrase m’a bouleversé, parce que j’ai ressenti la même chose cette nuit-là, que cet ami formulait en quelques mots le projet de mon livre : à savoir que quand je le rencontre ce soir-là – ce qui n’enlève rien à ma détestation de lui – quand je le rencontre, Reda représente en quelque sorte la possibilité de ce que j’aurais pu être à un moment de ma vie et que je ne suis pas devenu.
La violence comme celle de Reda ne m’était pas inconnue quand j’étais enfant. J’ai un cousin qui est mort en prison dont je parle dans En finir avec Eddy Bellegueule. Mon grand-père est allé en prison. Les agressions sexuelles, il y en avait autour de moi dans le village de Picardie où j’ai grandi. La construction formelle d’Histoire de la violence évoque bien cette ressemblance troublante, puisque quand ma sœur raconte à son mari ce que fait Reda, qu’il me vole quelque chose, elle dit : « Édouard aussi volait quand il était enfant » (je volais du métal dans les décharges que je revendais à des ferrailleurs, comme les enfants du film Le Géant égoïste), quand elle dit que Reda devient très agressif, elle dit que mon frère aussi était souvent agressif. Histoire de la violence est construit dans un jeu de miroir : à chaque fois que je parle de Reda, je parle de moi, et quand je parle de moi, je parle de Reda, même si je suis devenu autre chose.
C’est d’ailleurs notamment là que se fait la bascule dans la polémique comme si essayer de comprendre quelqu’un, c’était désormais chercher implicitement à vouloir l’excuser.
Le problème avec le mot « excuses », c’est que souvent, il ne vise pas à dire quelque chose, mais à faire taire. Il y en a beaucoup, comme ça, dans le champ littéraire, des mots qui servent à faire taire. Prenez le mot misérabilisme, par exemple, qu’on assène tout le temps aux écrivains qui parlent de la misère, de la pauvreté, de l’exclusion. Est ce que le mot misérabilisme ne fait pas partie du champ lexical de l’exagération, qui, on le sait, a été dans l’histoire un des grands outils du silence et de la violence ? Est-ce que l’écrivaine Christa Wolf ne dit pas, dans son chef-d’œuvre Trame d’enfance, que quand pour la première fois les camps de concentration nazis ont été évoqués dans la presse allemande, on a rétorqué que ce qu’on entendait et lisait à propos de ces camps était exagéré, enflé, amplifié, pour ne plus en parler ? Est-ce que le sociologue Abdelmalek Sayad ne dit pas, dans La double absence, que lorsque les tortures commises pendant la guerre d’Algérie ont été dévoilées on a objecté l’exagération? Est-ce que le mot « misérabilisme » ne veut pas dire qu’on exagère la misère, son importance, et est ce qu’il n’est pas, par là, synonyme de « ne dis pas la vérité de la misère », synonyme de « ferme-la » ?
Je m’éloigne un peu de ce que vous demandiez, mais pas tant que ça, parce que je pense que c’est un sujet important, ces mots qui font taire. Pour revenir aux « excuses », si excuser renvoie à ex causa, hors de cause, si « excuser » veut dire mettre les gens hors de cause, montrer que les causes sont ailleurs que dans les individus, mais dans des forces historiques plus grandes qu’eux, alors je n’ai pas de problème avec ça oui, et j’excuse – ce qui n’enlève rien au caractère inadmissible de la violence. Geoffroy de Lagasnerie, dans son livre Juger, développe une très belle réflexion sur l’importance d’excuser, sur « ce beau mot d’excuse ».
En fait, je pense que la littérature a souvent été un grand art de la cause. Si vous pensez au personnage de Joe Christmas dans Lumière d’août, c’est un personnage qui commet un acte ultra-violent au début du livre – il tranche la tête de la femme avec laquelle il habite et ensuite de mettre le feu à la maison. Ensuite, dans tout le livre, Faulkner va revenir sur l’enfance de Christmas, la manière dont il a été traversé par l’exclusion, la violence, le racisme, comment il a été trimballé d’un orphelinat à un autre, comment il a souffert quand on a découvert qu’il avait du sang noir. Faulkner s’acharne à trouver les causes de la violence, et souvent je me dis que la politique devrait plus souvent s’inspirer de cette puissance de la littérature comme art de la cause.
Après les attentats du 13 novembre, Laurent Mauvignier donnait dans Le Mondeune définition du roman selon laquelle un récit, ce n’est pas un personnage principal avec, à ses côtés des personnages secondaires mais, au contraire, un personnage principal + un personnage principal + un personnage principal, et cela, x le nombre de personnages dans le livre.
Et, précisément, le fait de mettre dans Histoire de la violence à égalité la parole de Reda, celle du narrateur et celle de la sœur, n’est-ce pas s’ouvrir à une telle démocratie narrative, une démocratie du sens ?
Il y avait une sorte de volonté égalitariste quand j’ai écrit Histoire de la violence. Je me disais que si je racontais l’histoire de Reda, si ce n’était pas lui qui le faisait, alors quelqu’un devait raconter mon histoire – c’est finalement Clara qui s’en charge – je ne pouvais pas exactement le faire moi-même, je pensais que cette mise à égalité permettrait de mieux comprendre ce qui est arrivé dans l’espace de ce huis clos, d’être au plus proche de la vérité.
Reda et moi, nous sommes en même temps deux personnages principaux et deux personnages secondaires. Au fond, la scène dans laquelle a lieu l’action est aussi comme un personnage à part entière de l’histoire. Comme dans L’Étranger de Camus où l’éclat du soleil vient déterminer l’acte, le meurtre, le lieu a son importance, la scène dans laquelle l’acte émerge à une incidence sur les actions des personnages. Donc oui, je me reconnais bien dans la définition de Mauvignier.
Dans Histoire de la violence, j’ai l’impression qu’il y a un travail sur le monologue qui me semble très parent de ce que fait Laurent Mauvignier dans Ceux d’à côté,un roman paru en 2003 et qui raconte précisément un viol, par une série de monologues, en faisant parler le violeur là aussi de manière égale. Il y a une circulation très démocratique de la parole qui rejoint celle que vous mettez en jeu.
J’avais été bouleversé par Ce que j’appelle oubli. Je n’ai pas lu Ceux d’à côté. Dans les monologues, je pensais beaucoup, en vérité, à Juste la fin du monde de Jean-Luc Lagarce qui est une pièce de théâtre construite comme une succession de longs monologues.
C’est l’histoire d’un transfuge qui rentre chez lui, vous vous souvenez, et qui vient annoncer à sa famille qu’il va mourir, annoncer « sa mort prochaine et irrémédiable » comme il dit lui-même, à cette famille dont il a été séparé depuis des années et des années, parce qu’il est parti vivre loin d’eux, qu’il les a quitté pour se réinventer autrement. Il revient pour leur dire qu’il va mourir et, en fait, dans le livre de Lagarce, il n’arrive presque jamais à leur parler, il y a très peu de dialogues dans la pièce, à la place il y a cette succession de monologues, comme si leurs paroles ne se rencontraient jamais. Il y a une distance objective entre Lagarce et sa famille, en dépit de l’énergie qu’ils peuvent essayer de mettre pour entrer en contact. Et à la fin du livre, il repart sans avoir rien dit, sans avoir dit qu’il allait mourir.
Dans Histoire de la violence, quand je suis face à la police, quand je suis face aux médecins et qu’on ne parle pas du tout le même langage, j’ai cette même impression que je suis en train de monologuer et qu’eux aussi monologuent de leur côté et que nos paroles ne se rencontreront jamais, ne se trouveront jamais. La situation se reproduit quand au début du roman j’arrive chez Clara.
Je me souviens que toutes les fois où je suis rentré chez moi depuis que j’ai quitté le village de mon enfance, depuis cette fuite que je relate dans Eddy
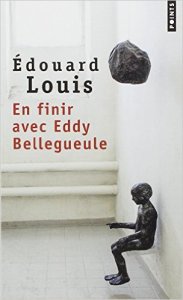
Bellegueule, même si j’avais envie de voir mes cousines ou mes tantes, et que je faisais des efforts, et qu’elles aussi étaient contentes de me voir et faisaient des efforts, il y avait une espèce de distance, une violence objective, malgré nous, la même que celle entre Didier Eribon et sa mère dans Retour à Reims.
Ma tante, dont j’ai été si proche quand j’étais petit, me disait, quand je revenais, et parce que je ne ressemblais plus à l’enfant qu’elle avait connu : « Mais pourquoi tu parles comme ça ? Pourquoi tu t’habilles comme ça ? Tu parles comme un bourgeois ! Tu t’habilles comme un ministre ! » alors que j’étais en jean et baskets. Et moi je ne comprenais pas non plus ce qu’elle disait, son langage, elle disait des phrases comme : « Ah les femmes aujourd’hui, c’est toutes des putes ! », et je lui répondais de ne pas dire des phrases comme ça devant moi, et je sentais la distance indépassable entre elle et moi.
Alors on faisait nos monologues, chacun dans notre coin, comme les personnages de Lagarce, comme dans Histoire de la violence.
C’est vrai qu’au cœur d’Histoire de la violence, il y a un véritable drame de la parole qui se joue : le narrateur me paraît toucher un point nul du langage, un point zéro au moment de la strangulation. Reda l’étrangle et le narrateur dit : « si le langage est le propre de l’homme alors pendant ces cinquante secondes où il me tuait je ne sais pas ce que j’étais ». À partir de là dans le récit, c’est comme si un point d’absolu avait été touché où, de là, le narrateur doit retrouver le langage en soi, repartir à la conquête de sa propre parole. Il est alors atteint de ce mal dont parlait Barthes : « J’ai une maladie : je vois le langage. » Le roman peut se lire alors comme l’apprentissage du retour d’une voix.
Il y a en effet un paradoxe qui est que, quand on vit une situation de violence très grande, on perd le langage et on est réduits à l’expérience, comme ce qui se passe lorsque Reda m’étrangle, et que je n’arrive pas à penser, que je ne pense plus rien, même pas « je ne veux pas mourir ». D’où cette phrase que vous citez : si le propre de l’être humain est le langage, qu’est ce que j’étais quand il me tuait. Et une fois l’expérience passée, c’est l’inverse, il ne reste plus que le langage. On n’a plus que ça, l’expérience est définitivement perdue, on essaye de la récupérer maladroitement avec le langage, qui aussitôt la falsifie. Charlotte Delbo, évidemment dans un contexte immensément plus violent, qui est celui des camps de concentration, évoque dans ses livres la perte de tout langage dans la violence, puis la difficulté qui en découle de dire cette violence avec le langage, a posteriori.
Je me rappelle que quand j’ai commencé à écrire Histoire de la violence, j’écrivais que quand Reda a sorti son revolver, j’avais tout fait pour m’enfuir. C’était dans les premières versions du manuscrit, et c’est ce que je répétais aux amis à qui je parlais. C’est une de ces phrases sédimentées qui m’est tout de suite venue en tête « J’ai tout fait pour partir, quand j’étais face à Reda ». Alors que ça n’a pas été le cas, que comme Temple dans Sanctuaire je n’ai pas fui. Cette phrase, « j’ai tout fait pour partir », c’était comme du langage qui venait parler à ma place, recouvrir mon expérience, parce que c’est ce qu’on entend toujours dans des cas comme celui-ci, et que je le répétais, même si c’était faux.

C’est la grande phrase de Michon : « Le langage ment. »
Exactement. Le langage nous ment en permanence. Ce que je disais beaucoup quand j’ai publié En finir avec Eddy Bellegueule. Quand je parlais de la problématique du nom, je disais : « les gens demandent toujours : « Comment tu t’appelles ? » » mais, en fait, c’est un mensonge, cette question est un mensonge, parce que ce n’est pas toi qui t’appelle, ce sont les autres qui nous appellent, qui nous somment, nos parents, la société, le monde, souvent envers et contre nous. Donc on devrait dire « comment on t’appelle ? ».
« Comment tu t’appelles ? » est une formulation mensongère. Le langage ment. C’est pour cela que dans les premières esquisses d’Histoire de la violence, je me suis surpris à écrire : j’ai tout fait pour m’enfuir, ce qu’on entend souvent après ce genre d’expérience, je me suis débattu, mais ce n’étaient que des mots que j’agrippais et dont il a fallu me défaire.
Pour revenir aux influences qui travaillent le livre, j’ai été frappé par les cadeaux dont vous parlez et qui vous ont été faits au réveillon que vous racontez, puisqu’on vous a notamment offert des livres de Claude Simon dont, àmon sens, votre récit porte la marque. Il y a, me semble-t-il, des accents simoniens dans les scènes dont on parlait déjà, celle de Reda défiant l’enseignante ou celle de l’enterrement fantasmé, entre autres dans la façon de dire « j’imagine » qui fait écho au « je pouvais voir » de Simon.Histoire de la violence serait, comme Le Vent, une tentative de restitution mais avec des manques d’une expérience, et non sa tentative d’épuisement.
Claude Simon hante Histoire de la violence, oui. Je suis fasciné par sa manière d’utiliser la forme littéraire pour atteindre le réel. On pose toujours la question en littérature de la forme, est ce que le formalisme permet de dire des choses ou empêche de dire des choses, empêche de dire le réel ?
Ce qui apparait avec Claude Simon, c’est que la question n’est pas celle de la forme ou pas mais des usages de la forme. Il y a des formes littéraires qui servent à dire des choses, d’autres qui l’empêchent, « forme » est un mot trop large, trop imprécis, qui recouvre des réalités qui n’ont rien à voir entre elles, et même parfois des réalités opposées.
Comment est ce qu’on peut parler par exemple de la « forme » chez Robbe-Grillet et chez Claude Simon quand chez le premier elle se donne pour but de ne pas parler du monde social alors que chez le deuxième elle sert à dire la domination, la guerre, l’amour, la destruction ?
Quels étaient les romans de Claude Simon que l’on vous avait offerts ce soir-là ?
J’en avais eu deux ; La Chevelure de Bérénice et L’Acacia. Et, en fait, toute la scène du rêve dans mon livre, quand après la nuit avec Reda je fantasme ma propre mort, mes amis arrivent au cimetière en taxi comme les deux femmes dans la scène d’ouverture de L’Acacia. Ils ouvrent une petite barrière verte comme les deux femmes de L’Acacia.
Pour rester sur la question des éventuelles filiations littéraires, je voudrais revenir à l’influence d’Annie Ernaux sur votre travail. Si on pouvait situer En finir avec Eddy Bellegueule dans son écho, encore que je crois qu’il est nécessaire de prendre des distances avec une telle affirmation, j’ai l’impression qu’avec Histoire de la violence s’amorce un net détachement, peut-être une rupture.
Est-ce que vous l’avez senti dans l’écriture ?
J’ai été très profondément marqué par la puissance et la beauté de l’œuvre d’Annie Ernaux. Quand j’écrivais Histoire de la violence, je ne me disais pas qu’il fallait prendre des distances avec son travail. Mais par rapport à mon premier roman, En finir avec Eddy Bellegueule, oui, j’avais envie de faire mieux que ce que j’avais fait, d’aller plus loin.
Un des thèmes communs aux deux livres, c’est la vérité. C’est d’avoir essayé, par les outils de la littérature, de retrouver la vérité d’une expérience vécue, que ce soit mon enfance dans les classes populaires du Nord dans Eddy Bellegueule ou le huis clos avec Reda dans Histoire de la violence.
Alors dans Eddy, pour retrouver cette vérité, je me suis concentré sur des faits, des scènes. Évidemment, je ré-interrogeais ces scènes de mon passé à la lumière de mon présent, je reproblématisais mon passé, par exemple quand je racontais qu’Eddy pleurait parce qu’on le traitait de pédé à l’école, je comprenais que ces larmes, contrairement à ce que j’avais pensé à ce moment-là, au moment où elles coulaient de mes yeux, n’étaient pas dues à une fragilité individuelle, à une tare dans ma personne ou à la simple méchanceté des enfants à l’école, mais qu’elles étaient produites par toute une histoire de l’homophobie qui me précédait, de la domination masculine, de la violence sociale, et que peut-être dans un autre contexte ces larmes n’auraient pas eu lieu, dans un autre pays, une autre époque où l’homosexualité n’aurait pas été un problème, et je comprenais alors en écrivant que mes larmes étaient plus vieilles que moi, que mes larmes étaient politiques.
C’est ça que je veux dire par ré-interroger le passé, essayer de retrouver la vérité d’une expérience que je n’avais pas éprouvée à l’instant où je la vivais.
Mais effectivement, dans Histoire de la violence il y a une dimension supplémentaire de la vérité, une dimension que j’ai voulu ajouter, c’est-à-dire pas seulement les faits – même réinterrogés – mais aussi, ce qui fait partie du système du vrai, toutes les vérités contre lesquelles on lutte. Ça, ce n’était pas présent dans Eddy Bellegueule.
Clara dans le roman, quand elle parle de moi à son mari, énonce beaucoup d’idées, des théories. Dans un passage du livre, elle dit plus ou moins: « Quand Édouard nous a avoué, à nous, sa famille, qu’il était homosexuel, il l’a fait non pas parce qu’il pensait qu’en le disant il se rapprocherait de nous, mais au contraire parce qu’il espérait que le dire créerait une distance entre nous. Il ne nous a pas avoué un secret pour qu’on se rapproche de lui – ce à quoi sert souvent la révélation d’un secret, à rapprocher les gens – mais parce qu’il espérait qu’on lui en voudrait de ce secret et que de cette manière-là, il pourrait dire : c’est leur faute à eux si on ne se parle pas, pas la mienne, tout est de leur faute si on ne se voit plus ».
On voit bien, à travers la manière dont j’ai écrit cette scène, que Clara à raison. Que c’est ce que j’ai pensé quand j’ai dit mon homosexualité à ma famille. Et pourtant, quand Clara dit ça et que je l’entends, dans le livre, je pense « Ce n’est pas vrai, elle ment ». Je résiste à la vérité, parce qu’elle est trop dure à admettre.
Ce qu’il y a de plus dans Histoire de la violence, par rapport à Eddy Bellegueule, c’est ça, c’est tout ce qui n’appartient pas au champ du vécu immédiat, toutes les vérités contre lesquelles on lutte dans l’existence, toutes les vérités qu’on connaît et qu’on ne veut pas savoir. C’est la grande théorie des Pensées de Pascal : nous connaissons tous la vérité sur nos vies, sur ce que nous sommes, et l’histoire de notre vie est l’histoire d’une lutte contre la vérité, parce que cette vérité est trop lourde, trop cruelle à accepter.

Je voudrais terminer sur un lien que j’ai perçu à ma lecture entre Histoire de la violence et l’œuvre de Duras, en particulier L’Amant. Il ne s’agit pas d’un rapprochement avec la voix durassienne mais plutôt d’une relation à tisser entre la démarche de Duras qui commente, du titre premier de L’Amant, une image absolue qui n’existe pas, où elle est jeune fille sur ce bac qui traverse le Mékong et d’autre part votre démarche qui consiste à commencer à raconter quand il ne subsiste plus d’image, quand il n’y a pas d’image de la situation à décrire.
Est-ce que vous pensez qu’écrire, ce serait révéler une image absolue ?
Il y a une image absolue dans Histoire de la violence, c’est celle où je croise Reda place de la République. Comme quand Duras rencontre celui qui va devenir son amant sur le bac, quelque chose se passe, deux histoires viennent s’entrechoquer, se percuter, et là quelque chose de nouveau se produit. C’est pour ça que cette image est belle et importante dans L’Amant, parce qu’elle dit comment deux vies, comment deux trajectoires déterminées qui se croisent peuvent produire, non pas de l’indéterminé, mais de l’événement, de l’inattendu ou même de l’inespéré.
Vous avez une lecture très politique de Duras.
Oui, mais surtout je crois que c’est la lecture qu’elle avait de sa propre œuvre. Marguerite Duras parlait toujours un langage politique, elle rappelait dans presque tous les entretiens qu’elle donnait ses années de militantisme au parti communiste, elle s’est battu pour les femmes, contre la guerre d’Algérie, elle disait de son style « je ne m’en occupe pas ». Et même si elle exagérait un peu en disant cela, qu’importe : l’essentiel, c’est que les questions que se posait Duras quand elle écrivait étaient reliées au monde, à la politique, pas seulement au champ littéraire, et c’est le champ littéraire qui a souvent, ensuite, essayé de la ramener au seul champ littéraire, de l’enfermer à l’intérieur de ce qu’elle fuyait, de la dépolitiser, de la réduire à « un style », alors que la matière de l’écriture de Duras, c’est l’insurrection. Il y a l’écriture aussi, bien évidemment, mais beaucoup d’autres choses.
Vous voyez, on en revient toujours au même : l’histoire de Duras, c’est l’histoire de quelqu’un qui n’a pas arrêté d’être racontée par les autres, et il y a une distance infinie entre ce qu’elle était et ce que le plus souvent on dit d’elle.
Édouard Louis, Histoire de la violence, Points, 240 p., 7 € 10 — Lire un extrait
En finir avec Eddy Bellegueule (Seuil, 2014), éditions Points, 203 p., 6 € 90


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire