Le dictionnaire de François Laroque qui se comporte en « amoureux fervent » plus qu’en « savant austère » de son auteur, pour le grand plaisir du lecteur, offre évidemment une entrée « Carné », où est fait le sort qu’elle mérite à la formidable interprétation de Pierre Brasseur en Frédéric Lemaître toute sa vie hanté par le personnage d’Othello auquel seule une bouffée tardive de jalousie en présence de Garance amoureuse de Baptiste permet enfin d’accéder à la démence du Maure assassin de l’innocente Desdémone. Et l’amoureux du Grand Will n’aurait garde non plus d’oublier d’autres comédiens de génie, Laurence Olivier en Hamlet et surtout Orson Welles, Falstaff prodigieux de Chimes at midnight (1966).
Mais à dire le vrai François Laroque n’oublie rien de ce qui concerne son héros, et pousse le scrupule, tout en adhérent pleinement à la biographie « autorisée » qui fait du barde pétri de culture latine un roturier fils d’un riche artisan gantier de Stratford-upon-Avon, jusqu’à laisser une place aux théories farfelues qui n’ont pas manqué d’attribuer ses pièces à nombre de gens titrés plus susceptibles d’avoir du génie que ce Monsieur Hochepoire comme disait Jarry. Le goût du complot est si bien partagé que Dominique Goy-Blanquet, éminente spécialiste du théâtre élisabéthain et quelques autres ont encore dû, tout récemment, faire pour la Nième fois justice de ces billevesées.
Le bonhomme reste pourtant suffisamment mystérieux pour nourrir les fantasmes. N’y a-t-il pas, dans sa vie, un trou de sept années entre le moment où il quitte sa province, sa femme et ses enfants (en 1585, il a 21 ans) et celui où il apparaît à Londres, en 1592 ? Dès lors, il ne quittera plus la lumière : membre et actionnaire de la troupe des Comédiens du Chambellan, puis auteur dont les pièces seront jouées au fameux Théâtre en rond au toit de chaume du Globe qui brûlera en 1613 et sera aussitôt reconstruit en dur, Shakespeare au cours de sa carrière a amassé une fortune. C’est cette année 1613 précisément, à quarante-neuf ans, qu’il prend sa retraite, pour rentrer à Stratford, où il mourra trois ans plus tard.
Les années inconnues de la formation au métier du théâtre ne sont du reste pas les seules à ne pas être documentées. On ne sait presque rien non plus de son enfance, et puis comment rendre compte d’une production aussi frénétique (38 pièces, deux longs poèmes narratifs, et les 154 sonnets dédiés à un Monsieur W. H. dont l’identité n’a pu être établie avec certitude) ? Shakespeare, c’est un monde foisonnant d’étrangetés, depuis les tragédies gore des débuts, qu’on peut ne pas aimer – c’est mon cas – jusqu’à cette Tempête testamentaire qui n’est pas l’œuvre ultime – c’est Cardenio, écrite en 1613 et perdue – mais qui, toute entière consacrée à la magie du théâtre et à la « mise en scène » machinée par Prospero, constitue pour certains – dont je suis – le chef-d’oeuvre des chefs-d’œuvre et peut-être la plus belle pièce baroque, de facture classique, qui soit au monde.
À propos de Tempête, j’ai un souvenir délicieux de certain séjour à Ajaccio, qui aurait été bien long si je n’étais tombé, dans une maison où il y avait peu de livres, sur le texte de la pièce en anglais dépourvu de notes. Comme je ne disposais pas de dictionnaire, j’ai lu, essayé de comprendre ce texte fantastique et inspiré et cru y parvenir. Le sentencieux magicien Prospero, qui transcende sa fonction de père noble et ses instincts de vengeance (thème shakespearien par excellence : ce théâtre est violemment pessimiste) par le plaisir presque naïf qu’il prend à ourdir le filet de sortilèges où se prendra l’affreux trio de ses ennemis (Antonio, Sébastien, Alonso), quel rôle ! Et la ravissante Miranda sa fille (elle est un peu gourde, il faut qu’elle soit ravissante, qui sait si son amour pour Ferdinand n’implique pas que son « caractère peut changer » comme l’espère Michaux de celui de Plume menacé de perdre un doigt) !
Mais rien n’égale en merveilleux le couple antagonique, et pourtant si Janus Bifrons, Ariel /Caliban ! On ne se lasse pas des chansons de l’Esprit de l’air, mais on communie avec Caliban dans une haine à la Spartacus à l’égard de son maître. Prospero a chargé ses deux créatures des chaînes de l’esclavage, on croit que la brute contrefaite est la plus méprisable, mais elle n’est pas assez bornée toutefois pour accepter son joug du cœur léger d’un Ariel sans cervelle.
Ce qui est fascinant dans Shakespeare, c’est l’insondable ambiguïté. Et je me rengorgeais de l’avoir mieux saisie, à l’état naissant en quelque sorte, par une immersion sans scaphandre dans le texte coton à souhait du vieil anglais retors qui, au mitan de l’horrible siècle des guerres de religion, quand le triomphe local des parpaillots mettait en charpie le catholicisme résiduel, était peut-être bien papiste, mais la chose est plus conjecturale qu’avérée. Pauvre de moi !
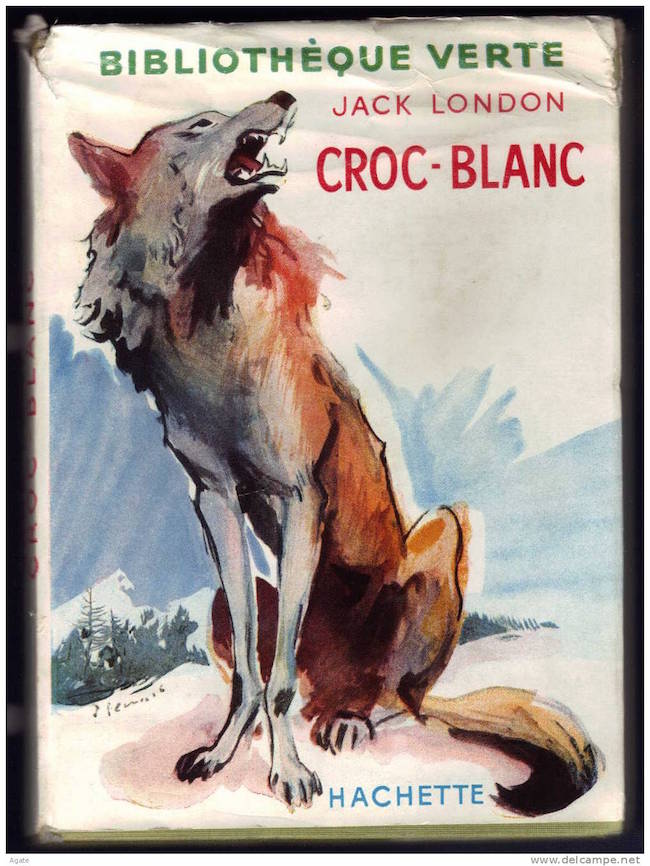




















 Alors voilà ! Ce devait être dans les années soixante de l’autre siècle. Un vieux monsieur tout penché, tout cassé, entrait en scène un gros in-folio coincé sous l’aileron, cabossé, usé, taché d’encres diverses l’in-folio. Le monsieur posait sur un coin de la chaire le cher exemplaire maintes fois peloté au cours de sa propre studieuse jeunesse, et il commençait à lire, après avoir remonté ses bésicles, la belle harangue que ce « tousseux » de « Maistre Janotus de Bragmardo », au chapitre XVIII du Gargantua, fit au géant « pour recouvrer […] les grosses cloches » de Notre-Dame, que le géant avait décrochées négligemment afin de doter sa jument de sonnailles à sa mesure.
Alors voilà ! Ce devait être dans les années soixante de l’autre siècle. Un vieux monsieur tout penché, tout cassé, entrait en scène un gros in-folio coincé sous l’aileron, cabossé, usé, taché d’encres diverses l’in-folio. Le monsieur posait sur un coin de la chaire le cher exemplaire maintes fois peloté au cours de sa propre studieuse jeunesse, et il commençait à lire, après avoir remonté ses bésicles, la belle harangue que ce « tousseux » de « Maistre Janotus de Bragmardo », au chapitre XVIII du Gargantua, fit au géant « pour recouvrer […] les grosses cloches » de Notre-Dame, que le géant avait décrochées négligemment afin de doter sa jument de sonnailles à sa mesure. Si immortelle, si souple et si large en ses avatars de lecture, cette œuvre, si chargée de personnages inoubliables (Panurge, le filou, le marlou, le pétochard ; Picrochole, le bilieux, le vaniteux, le jobard ; Frère Jean des Entommeures, aussi solide, aussi violent, aussi droit que son bâton de la Croix en cœur de cormier, assez sage cependant pour fonder Thélème, tout en restant assez aventureux pour se lancer au Quart Livre à la conquête de la Dive Bouteille et de son énigmatique « Trinch ! »), qu’on se demande comment dire encore aujourd’hui des choses neuves à propos d’icelle.
Si immortelle, si souple et si large en ses avatars de lecture, cette œuvre, si chargée de personnages inoubliables (Panurge, le filou, le marlou, le pétochard ; Picrochole, le bilieux, le vaniteux, le jobard ; Frère Jean des Entommeures, aussi solide, aussi violent, aussi droit que son bâton de la Croix en cœur de cormier, assez sage cependant pour fonder Thélème, tout en restant assez aventureux pour se lancer au Quart Livre à la conquête de la Dive Bouteille et de son énigmatique « Trinch ! »), qu’on se demande comment dire encore aujourd’hui des choses neuves à propos d’icelle.