
Le testament de Stephen Hawking
par Martino Lo Bue28 novembre 2023
8 mn
L’idée que les lois de la physique et que des grandeurs longtemps considérées comme universelles telles que le temps et l’espace puissent avoir une histoire, voire des origines, hante la physique, surtout depuis 1915, année de la publication de la théorie de la relativité générale d’Albert Einstein.
Thomas Hertog | L’origine du temps. La dernière théorie de Stephen Hawking. Odile Jacob, 431 p., 24,90 €
Au cours des douze ans qui suivirent, deux théoriciens s’acharnèrent à calculer les solutions de la théorie afin d’en déduire une description d’ensemble de l’univers. Le premier, le physicien soviétique Alexander Friedmann, publia en 1922 et 1924 des solutions aux équations d’Einstein calculées en supposant un univers avec une distribution uniforme de matière. L’un des résultats les plus marquants montrait que, en raison de la courbure de l’espace-temps induite par la présence de matière, l’univers se trouvait en évolution (expansion, contraction). En 1927, Georges Lemaître, père jésuite et professeur de physique à l’Université catholique de Louvain, publia dans les Annales de la Société scientifique de Bruxelles un article qui est aujourd’hui considéré comme l’origine de la théorie du Big Bang. Lemaître, en comparant les modèles d’espace-temps de Willem de Sitter (solutions en absence de matière) et d’Einstein, arriva de façon indépendante à une conclusion similaire à celle de Friedmann. Il écrit : « Lorsqu’on introduit des coordonnées et une division correspondante de l’espace et du temps respectant l’homogénéité de l’univers, on trouve que le champ n’est plus statique, on obtient un univers de même forme que celui d’Einstein, mais où le rayon de l’espace au lieu de demeurer invariable varie avec le temps suivant une loi particulière […] nous sommes ainsi conduits à étudier un univers d’Einstein où le rayon de l’espace (ou de l’univers) varie d’une façon quelconque ».
Si Einstein, de son côté, n’était pas très convaincu par l’idée d’un univers en expansion, d’autres physiciens en étaient carrément horrifiés. C’est ainsi que Hermann Bondi et Fred Hoyle développèrent des théories en essayant de concilier les équations de la relativité avec un univers stationnaire plus conforme à leurs attentes philosophiques. C’est dans la polémique qui s’ensuivit que Fred Hoyle utilisa pour la première fois l’expression « Big Bang » pour designer de façon ironique l’approche évolutive de Lemaître. Deux ans après l’article de Lemaître, l’astronome américain Edwin Hubble montrait que la vitesse d’éloignement des objets extragalactiques est proportionnelle à leur distance, confirmant ainsi les prévisions de Lemaître et de Friedmann. En 1931, un article au titre significatif, « The End of the World from the Standpoint of Mathematical Physics », signé Arthur Eddignton, est suivi, dans la revue Nature, d’une lettre intitulée « The Beginning of the World from the Point of View of Quantum Theory » par Georges Lemaître.
Le premier posait des questions aujourd’hui encore d’actualité. D’une part, il intégrait l’idée d’expansion de l’univers avec le deuxième principe de la thermodynamique, la seule loi fondamentale de la physique imposant une asymétrie entre passé et futur, ce qu’Eddignton a nommé le premier une « flèche du temps ». Il en déduisait que l’univers devrait évoluer vers un état d’entropie maximale, c’est-à-dire vers un minimum d’organisation. Il se posait ensuite la question de savoir pourquoi nous avons, en notre qualité d’entités biologiques très organisées, la possibilité d’être les témoins de cette chute vers un état de désorganisation. La réponse était : d’après les lois de la physique que nous connaissons, et comme nous considérons comme philosophiquement aberrante l’idée que ces lois puissent avoir eu un commencement quelque part dans le passé, un univers admettant l’existence d’êtres conscients, de physiciens par exemple, est une situation extrêmement improbable si l’on n’admet pas des conditions initiales ad hoc.
La réponse de l’abbé Georges Lemaître conteste le rejet par Eddington de l’idée d’un commencement de l’état de nature et de ses lois telles qu’on les connaît. Selon Lemaître, le temps thermodynamique du point de vue de la théorie quantique peut se figurer comme une quantité constante d’énergie se distribuant dynamiquement au sein d’un nombre croissant de quanta. De ce point de vue, on pourrait se représenter le tout début comme un atome originaire contenant toute la masse de l’univers. L’évolution à laquelle on assiste résulterait de la fragmentation progressive de ce quantum originaire dans une multiplicité de quanta. Lemaître en déduisait que « si l’idée est correcte, le début du monde a eu lieu juste avant le début de l’espace et du temps [1] ». On est en 1931 et une bonne partie des questions clé auxquelles la cosmologie tente encore aujourd’hui de répondre sont posées.
Premièrement, il s’agit d’extrapoler, depuis l’évolution de l’univers, le futur (la fin) et le passé (le début) du monde. Pour ce faire, il faut harmoniser ce que les équations de la relativité générale prévoient avec les observations de l’astrophysique. Ces dernières comprennent, entre autres : l’observation de la vitesse d’éloignement des objets extragalactiques, qu’on associe à la constante de Hubble ; l’observation de la chaleur résiduelle résultant de l’époque à laquelle l’univers était très chaud, le fond diffus cosmologique (FDC), ou rayonnement fossile, prévu par Lemaître et découvert en 1965, juste avant la mort de ce dernier.
Deuxièmement, comme indiqué par la réponse de Lemaître à Eddignton, le problème des origines ne peut que passer par une unification de la théorie de la gravitation d’Einstein et de la mécanique quantique. Là aussi, le concours est encore ouvert ; les deux approches les plus populaires aujourd’hui qui essaient d’y répondre sont la théorie des cordes et celle de la gravitation à boucles. Mais les jeux sont loin d’être faits.
Du point de vue de la théorie de la relativité générale, la description du début de l’univers ne manque pas de poser des problèmes car la géométrie de l’espace-temps en présence d’une masse énorme, celle de l’univers entier, concentrée dans un espace très petit, voire un point, semble extrêmement bizarre, singulière comme on dit en mathématique. Le mot « singulier » dans ce contexte signifie que certaines grandeurs deviennent infinies et il est donc très difficile de leur associer une représentation physique. L’interprétation de la singularité initiale est encore plus ardue vu la difficulté, même du point de vue d’une expérience de pensée, de se poser en observateur externe par rapport à un univers qui, générant par lui-même l’espace et le temps, ne se trouve nulle part.
En 1916, Einstein reçut une carte postale envoyée par Karl Schwarzschild depuis le front oriental, contenant la solution des équations de sa théorie de la gravitation en présence d’une masse sphérique, statique, d’une densité extrêmement élevée. C’est là que commence l’histoire de ces objets aux propriétés fort exotiques qui seront ensuite dénommés « trous noirs » par John Archibald Wheeler. Il s’agirait bien de corps célestes : des objets « petits » par rapport à l’univers. Ils seraient aussi observables. Finalement, les densités de masse inouïes qu’ils comporteraient induiraient des conditions de déformation de l’espace temps parfois semblables à celles qu’on suppose avoir eu lieu pendant le Big Bang. Les trous noirs, dont on a une preuve en termes d’observation depuis peu de temps, seraient donc à plusieurs égards des systèmes modèles pour tester les théories de gravitation quantiques ainsi que les théories cosmologiques. Il n’est donc pas étonnant de trouver, parmi les scientifiques qui ont formulé les plus ambitieuses théories cosmologiques, deux des chercheurs qui ont contribué le plus au développement de la théorie des trous noirs : Roger Penrose, Prix Nobel de physique en 2020, et Stephen Hawking.
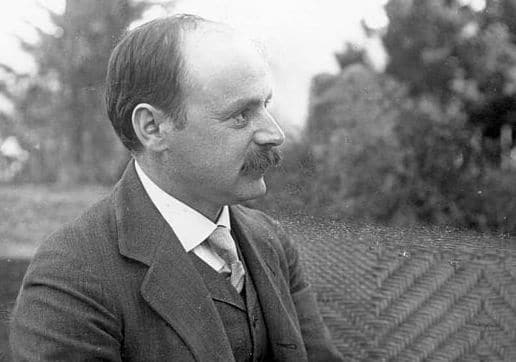
C’est bien à la dernière théorie de ce dernier que Thomas Hertog, son collaborateur depuis le début des années 2000, consacre son livre. L’ouvrage, mêlant des discussions scientifiques et des anecdotes biographiques sur Hawking, expose l’approche cosmologique que ce dernier a développée au cours des dernières années de sa vie. On trouvera des pages parfois très belles dédiées au problème de l’harmonisation des théories cosmologiques avec la structure du FDC, étudiée ces dernières années de façon de plus en plus détaillée. On y évoque l’hypothèse d’une dilatation initialement extrêmement rapide de l’univers, ce qu’on appelle une inflation. On y explique comment des fluctuations quantiques ayant lieu d’abord à une échelle microscopique pourraient avoir été amplifiées à l’échelle cosmique laissant leur trace dans le FDC. On y parle de constante cosmologique et de matière et d’énergie noires. Tous les sujets les plus intrigants de l’astrophysique contemporaine sont là, traités avec passion et clarté.
La dernière partie du livre attaque frontalement le problème, déjà clairement vu par Eddington en 1931, de la nature anthropique de l’univers. Il s’agit de répondre à la question de savoir pourquoi, avec une infinité d’évolutions cosmiques envisageables, on se trouve dans l’évolution, qui n’a pas l’air tout à fait « typique », où le développement de la vie est possible. La réponse de Hawking et de Hertog est, de quelque façon, « perspectiviste ». En décrivant l’évolution d’ensemble de la manière dont on décrit la trajectoire d’un objet quantique, on peut imaginer un univers évoluant au long de différentes histoires en même temps. Le fait d’observer cette possibilité particulière serait associé à la modalité par laquelle on interagit avec l’ensemble des histoires. On se trouverait dans un univers dont l’évolution dans le passé serait affectée par la manière dont on l’interroge dans le présent. Hawking et Hertog qualifient cette vision de « descendante » (top-down en anglais), se référant au fait qu’en physique le temps est communément indiqué par une flèche qui pointe vers le haut. Les soixante pages consacrées à cette théorie audacieuse constituent peut-être la partie la plus passionnante et la plus importante du livre de Hertog.

Comme Une brève histoire du temps de Hawking, ce texte possède toutes les qualités pour fasciner un large public et pour attirer des jeunes vers l’étude de la physique et de la cosmologie. Néanmoins, de même que certains médicaments contenant un fort principe actif, le livre de Hertog présente aussi quelques contre-indications pour éviter des effets indésirables. Dans un autre excellent livre traitant des mêmes sujets, Roger Penrose avait identifié trois mots clé qui décrivent bien la majorité des grandes théories cosmologiques dont les siennes : mode, croyance, imaginaire (voir Roger Penrose, La nouvelle physique de l’univers. Mode, croyance, imaginaire, Odile Jacob, 2018). Il s’agit peut-être seulement d’une question d’âge, mais chez Hertog cette distance salutaire qui caractérise Roger Penrose est totalement absente. Trop fréquemment, dans ses pages, l’enthousiasme fébrile du croyant l’emporte sur le recul qu’on attendrait de la part d’un scientifique, surtout quand il s’adresse à un public de non-spécialistes. Un compte rendu de l’édition en anglais, publié dans la revue Nature il y a quelque mois, reproche avec raison à Hertog un certain abus de l’argument d’autorité faisant valoir son très haut « pedigree ». On y parle de « brand of Hawking worship ».
L’élève de Stephen Hawking, professeur dans la même université que Lemaître, qui a rencontré les plus grands esprits de notre temps, semble par moments essayer de nous faire oublier que ses théories, bien que fascinantes, sont encore extrêmement controversées. Un exemple, au début du chapitre 7 : « Le lancement de la révolution darwinienne en cosmologie fut un acte hawkingien par essence ». Hertog confond trop souvent de nouvelles idées, courageuses, fascinantes et à la mode, avec des « révolutions » scientifiques. Ces dernières impliquent généralement la construction d’une hégémonie autour d’un nouveau paradigme dépassant les communautés académiques et disciplinaires et créant un nouveau sens commun, une nouvelle doxa. Ce n’est ni le cas de la théorie des cordes, ni celui de l’holographie quantique, ni celui de la théorie cosmologique descendante.
Ceux qui voudront, sans renoncer à l’indiscutable beauté de maintes pages du livre de Hertog, reparcourir les mêmes thématiques guidés par un regard très différent, celui d’un incroyant dont le recul s’accompagne d’une grande familiarité avec la philosophie et l’épistémologie, pourront se tourner vers les Anomalies cosmiques d’Aurélien Barrau. L’auteur, lui aussi chercheur reconnu dans le domaine de la cosmologie, se passionne surtout pour l’aspect ouvert, non linéaire, fait d’anomalies et d’erreurs, du processus d’avancement de la connaissance. Pour Barrau, « toutes les théories sont fausses » et c’est bien pour cela que la science ne cesse jamais d’avancer. Se focaliser sur les succès qui, selon Barrau, ne peuvent qu’être temporaires, fait perdre de vue que les échecs peuvent être productifs pour l’avancement de la connaissance. Selon Barrau, l’exposition de n’importe quelle théorie si l’on en efface les anomalies revient à une pratique, bien cernée par Georges Canguilhem dans Le normal et le pathologique, qui n’est pas dépourvue d’analogies avec des mécanismes sociaux répressifs. Un livre dont l’esprit pourrait enseigner aussi aux scientifiques, de plus en plus obsédés par une vision managériale de la recherche, à vivre les sciences comme work in progress.
[1] En décembre 2022 la VRT (Organisme de la radiodiffusion flamande) a retrouvé dans ses archives une interview qu’on croyait perdue de Georges Lemaître dans laquelle il parle, environ trente ans après, de sa théorie de l’évolution cosmique.








