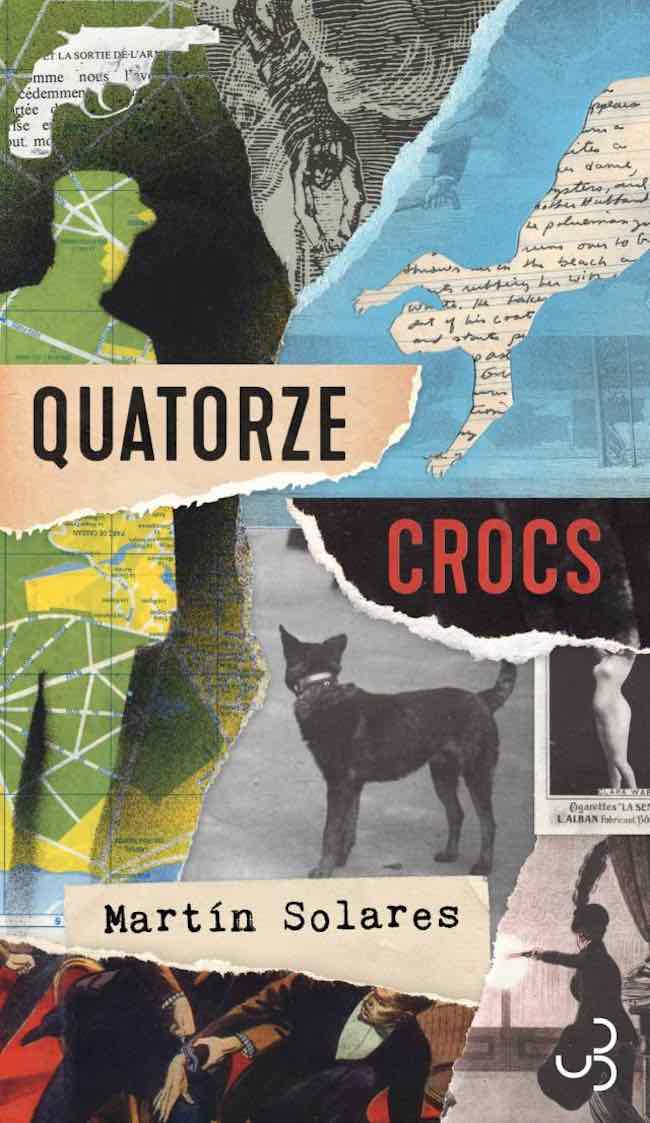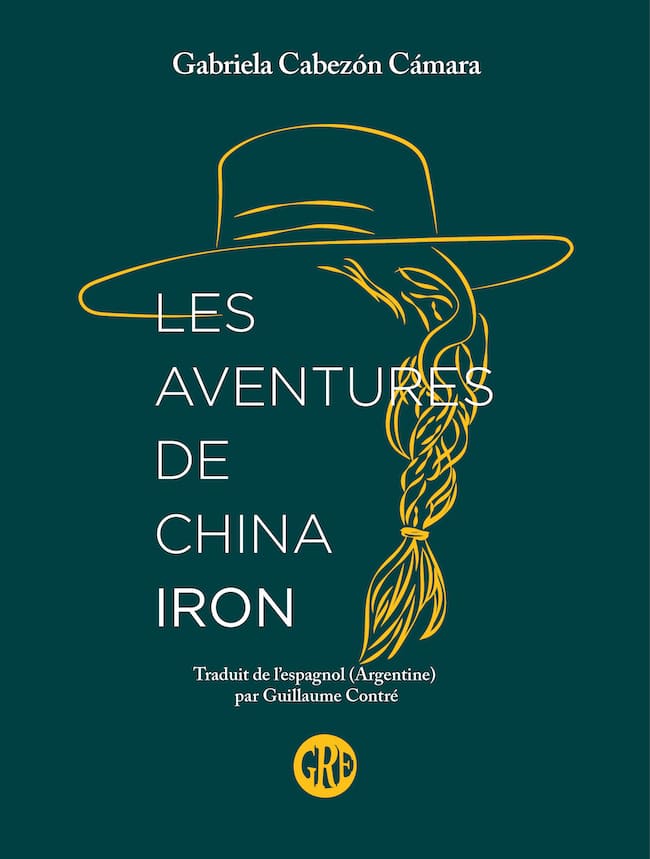Trieste, 1910. La jeune et belle Edda Marty, héroïne de ce roman de Giani Stuparich (1891-1961), entre dans la classe préparatoire à l’université d’un lycée de garçons. Elle est la seule fille. Qui est-elle ? Et comment les garçons vont-ils la recevoir ?
Giani Stuparich | Une année d’école. Trad. de l’italien par Carole Walter. Verdier poche, 94 p., 9,50 €
Giani Stuparich s’intéresse d’abord à la jeune fille, tandis que les jeunes gens sont à peine présentés, juste des voix comme surgies d’un brouhaha. Il y a Saletti, « jusqu’alors muet et solitaire, [qui devient] un audacieux causeur » ; « Thurez, qui depuis son banc du fond de la salle avait coutume de lancer des piques qui provoquaient les rires de toute la classe, arborait à présent presque toujours un air renfrogné, mélancolique et dur. Quant à Mitis, l’arrivée de Marty avait allumé en lui un inextinguible feu d’artifice cérébral ».
Ce ne seront pourtant pas ces trois-là qui se révèleront les protagonistes les plus importants de l’histoire, mais Antero et Pasini, qui, avec Mitis, sont les intellectuels de la bande, animés par leur goût de la littérature et leur revendication politique : le rattachement de Trieste à l’Italie, qui est le but de leur vie. Jusqu’en 1918, en effet, la ville fait partie de l’Empire austro-hongrois. Ensuite, elle est cédée à l’Italie. Le décor est planté, les personnages peuvent commencer à vivre leur « année d’école ».
La manière dont l’auteur (père istrien d’origine slave et autrichienne, mère juive) dépeint les jeunes gens, sans les juger ni les schématiser, contraints par leur milieu et leur éducation, son intérêt pour Freud et la psychanalyse, font penser à un autre écrivain triestin, Italo Svevo, son aîné (père juif allemand, mère italienne), dont le héros le plus célèbre est un anti-héros, touchant et convaincant par son humanité fragile, ses errements et sa faiblesse (La conscience de Zeno) ; ou à Luigi Pirandello, lui aussi imprégné des théories de Freud, mais italien et sicilien, pour qui la vérité était une illusion.
Mais c’est Edda Marty qui, par sa détermination à ne pas se laisser enfermer dans les rôles traditionnellement dévolus aux femmes, et sa lucidité quant à l’analyse de ses motivations intimes, constitue la grande modernité du livre.
Ce dont rêve la jeune fille dès quinze ans, c’est d’une ville comme Vienne, « où les femmes peuvent fumer, aller au café, rentrer tard le soir, traiter d’égal à égal avec les hommes et discuter avec eux ». Elle domine, non en icône mais en figure exceptionnelle, probablement tirée par Giani Stuparich de souvenirs de sa jeunesse, et peut-être inspirée par la fameuse Lou Andreas-Salomé : elle est sensible, ne cherche pas à nuire, peut tomber amoureuse, mais sait se ressaisir et retrouver sa liberté, sa ligne de conduite, être l’égale, la partenaire et non l’épouse et la mère de famille réduite à son foyer.
La façon dont elle échappe à ses remords, dont elle ne cède pas au sentiment de faute, de culpabilité, est magistrale : elle refuse de jouer le rôle menteur de l’amoureuse pour sauver de la mort un de ses soupirants mais pour autant, ne voulant pas l’abandonner, elle en endosse un autre, qui est celui de mère, dont la présence est bénéfique.
L’auteur ne cherche pas à démontrer quoi que ce soit, il décrit longuement les émois amoureux d’Edda et d’Antero, le garçon le plus proche de celui qu’il était à seize ans. Les jeunes gens d’abord se parlent et se promènent dans la nature, puis peu à peu ils se rapprochent physiquement, en viennent à s’embrasser de plus en plus passionnément sans toutefois aller plus loin, ce qui à notre époque apparaîtrait comme une étrangeté.
Là encore, on peut penser à un autre écrivain italien, plus tardif, dans le roman duquel une jeune fille audacieuse rend amoureux son entourage dans l’insouciance et la beauté des lieux, des personnages : Le jardin des Finzi-Contini, de Giorgio Bassani, paru en 1962, dont l’intrigue se situe à la fin des années 1930. Mais, alors que Micòl est emmenée en tant que juive dans un camp de la mort, Edda survit à la tuberculose poitrinaire qui la guettait et au mariage bourgeois avec Antero, que sa mère envahissante et captatrice aurait conduit à une faillite amère.
On sent pourtant, dès le début du livre, une angoisse, autour d’elle, que contredit l’auteur, et à laquelle il semble ne pas vouloir céder. Comme si son personnage tenait trop du miracle, qu’il n’était pas vivable, qu’on ne pouvait y croire vraiment. Si généreuse et en même temps si volontaire, si soucieuse d’inventer une manière d’être libre, inédite pour une femme, si perspicace, habile à se comprendre et à comprendre ce qui l’agite et qui agite ses partenaires.
On la voit, pour finir, évoquant à nouveau son double non fictif, la Lou de Nietzsche et de Rilke, debout sur un chariot parmi ses camarades, non pour les soumettre, mais pour sauver des eaux d’une pluie diluvienne leurs professeurs bloqués dans les murs du lycée :
« Comment, vous êtes là aussi ? s’étonna le professeur de grec quand, passé les premières frayeurs, il s’aperçut de la présence de Marty.
— Ici ? Mais professeur, je vais partout où il est possible de chahuter avec mes camarades, répondit-elle promptement. »
Non seulement la jeune fille ne cède pas aux injonctions de son époque, au destin qu’on prétend lui donner, mais elle parvient aussi à repousser la mort qui lui a enlevé sa sœur aînée bien-aimée, et cherche à l’enlever elle-même.
« Marty eut de graves crachements de sang et faillit mourir ; à peine remise, elle voulut embarquer pour un long voyage en Orient. » Comme une autre héroïne non fictive, Isabelle Eberhardt. Au fond, on ne sait pas ce que devient Marty, si elle gagne son pari et parvient à rester jusqu’au bout victorieuse ou, au contraire, si elle finit par renoncer et disparaître. Dans quelle tourmente, intime ou collective ?
La fin du livre est esquissée, l’auteur élague, suggère. Une œuvre ouverte qui parle encore à nos oreilles ; et qui résonne des bruits d’un temps qui s’annonçait tragique.
EN ATTENDANT NADEAU