LIVRES
LES 50 MEILLEURS
LIVRES DE 2020
Comme un feu d’artifice, voici les coups de cœur des journalistes des pages Livres pour l’année 2020. Une sélection de romans, de récits, de polars, d’essais et de bandes dessinées
Le Temps*Publié dimanche 13 décembre 2020 à 15:02
Modifié dimanche 13 décembre 2020 à 15:23
Un feu d’artifice de livres, c’est un peu ce que nous vous proposons cette semaine comme une gerbe de lumière dans ce mois de décembre qui en a bien besoin. A chaque contributeur des pages Livres, une quinzaine de personnes, journalistes mais aussi chercheurs, j’ai demandé d’imaginer les romans, les récits, les polars, les essais, les bande-dessinées qu’ils garderaient coûte que coûte avant de fermer la porte à 2020 et d’enjamber le seuil de 2021.
Chacun, chacune a reparcouru ses lectures et ses articles de l’année pour se souvenir des élans, de l’admiration et des émotions ressentis afin d'établir cette sélection, forcément très subjective. Voici les réponses: 50 coups de cœur, 50 lectures qui ont marqué cette année hors-norme. (Lisbeth Koutchoumoff Arman)
Romans, récits et cie
Une voie de résistance
Vanessa Springora a vécu, à l’âge de 13 ans, l’emprise amoureuse et sexuelle d’un homme, Gabriel Matzneff. Le Consentement est un livre lumineux et grave qui démonte avec calme cet abus de l’enfance. Nul acharnement sous la plume de Vanessa Springora, mais la voix tranquille et sûre d’une femme qui reprend sa vie et sa liberté. Si ce livre a tant marqué l’année 2020, c’est parce qu’il n’est pas seulement la remise en cause d’un abuseur et du système mondain qui l’a cautionné, mais qu’il indique, en littérature, une voie de résistance et de force. (Eléonore Sulser)
Vanessa Springora, «Le Consentement», Grasset, 210 pages
A travers les friches
Voyageur au long cours, Jean Rolin sait saisir la mondialité même quand son parcours se limite à suivre la Seine autour de Paris. A pied à travers les friches industrielles, les petites villes désertées, les campements roms dévastés et les forêts à l’abandon, le voyageur débusque les militants kurdes, les coiffeurs africains, la fête tibétaine. Mais il sait aussi entendre les oiseaux, guetter les poissons, suivre à la trace les artistes qui ont hanté les lieux, avec poésie, dérision et splendeur de l’écriture. (Isabelle Rüf)
Jean Rolin, «Le Pont de Bezons», P.O.L, 240 pages
Une nuit en cabane
Avec son comique pince-sans-rire, Laurence Boissier entreprend une randonnée dans les Alpes sur les pas d’un guide autoritaire et excentrique. Plus elle s’élève en altitude, plus elle creuse le temps géologique, livrant un portrait quasi cosmique de la Suisse. Laurence Boissier avait envie de déplier ces massifs rocheux, ce pays «fripé» comme une feuille de papier roulée en boule, pour y lire le secret des origines. Sous sa plume, les Alpes, comme les corps, comme les mots, redeviennent organiques. Entre un pique-nique et une nuit en cabane, la vraie profondeur est légère. (Julien Burri)
Laurence Boissier, «Histoire d’un soulèvement», art&fiction, 240 pages
Secret de famille
Marie-Hélène Lafon parle si bien des corps, ceux des femmes, ceux des hommes, elle en voit le dessin, elle en traduit le bleu et le velours des peaux, le poids. Ses romans sont ainsi lestés pour mieux suivre les volutes émotionnelles, invisibles de l’extérieur, qui labourent pourtant ses personnages. Histoire du fils suit une famille du Cantal et André en particulier, né d’un père inconnu (mais que le lecteur connaît). Le roman permet d’approcher une lumière chaude, de bougie, sur les tiraillements intimes qui tissent les vies. (L. K. A.)
Marie-Hélène Lafon, «Histoire du fils», Buchet-Chastel, 176 pages
Cueillir la vie
La lecture d’Affranchissements est ébouriffante, comme une brise soudaine. Par éclats de souvenirs, par associations d’idées et digressions multiples, Muriel Pic retrace l’existence de son grand-oncle Jim qui lui envoyait de Londres des timbres pour sa collection enfantine. Bossu, il a vécu en marge du jeu social. Jardinier, il admirait le surgissement des plantes au printemps. Puisant à l’énergie bondissante du poète William Carlos Williams, Muriel Pic raconte en fait le parcours d’un être qui a cheminé sans bruit vers l’affranchissement de soi et des conventions. (L. K. A.)
Muriel Pic, «Affranchissements», Seuil, 280 pages
En ermite parmi les livres
Un homme construit une cabane et lit des romans pour retrouver la femme qu’il aimait, suivre les traces qu’elle a laissées sur les pages. Si l’abri que Joseph cherche à aménager avec des rondins de bois, sur un lopin de terre agricole, se révèle précaire dans l’hiver qui s’annonce, les livres au contraire l’accueillent et constituent un véritable «toit» pour ses émotions et sa douleur. Nous habitons les livres et nous nous y croisons, les uns les autres, entre lecteurs, au-delà du temps. C’est ce que nous rappelle ce premier récit touchant et vibrant, qui déjoue les clichés. (J. B.)
Bernard Utz, «Un Toit», d’autre part, 115 pages
Adolescence enflammée
Emmanuelle Bayamack-Tam, alias Rebecca Lighieri, enflamme l’adolescence de Karel, Hendricka et Mohand, une fratrie livrée à la violence d’un père dans les quartiers nord de Marseille au début des années 1990. De son écriture directe, incroyablement libre, elle restitue l’énergie vitale de la jeunesse, la regarde se brûler, s’épanouir aussi. Elle parvient à capter à la fois les désarrois et les errances, mais aussi la souveraineté magique et insolente de ces corps et de ces esprits encore en train de grandir. Ce roman emporte avec la force du mélo ou du thriller, mais nourrit comme un grand livre. (E. Sr)
Rebecca Lighieri, «Il est des hommes qui se perdront toujours», P.O.L, 384 pages
La lumière de l’usine, la nuit
L’usine, ou plutôt ce qu’elle est devenue aujourd’hui, un centre de travail pour intérimaires, diffuse une lumière bleue dans le crépuscule, derrière les arbres sombres du Jura bernois. Les Nuits d’été met de la chair, c’est-à-dire des émotions, de l’enfance, de l’amour autour de thématiques peu fréquentes dans le roman d’aujourd’hui: la question des travailleurs frontaliers et celle du monde ouvrier. Thomas Flahaut réussit surtout à raconter une très belle histoire d’amour. (L. K. A.)
Thomas Flahaut, «Les Nuits d’été», L’Olivier, 224 pages
«Si par une nuit d’hiver…»
Si par une nuit d’hiver deux cent quarante-trois voyageurs... aurait pu être le titre, en hommage à Italo Calvino, du Goncourt 2020. Qu’Hervé Le Tellier lui ait donné pour titre L’Anomalie n’enlève rien au fait que, tout comme le livre d’Italo Calvino, son roman en contient de multiples autres. L’anomalie qui se produit sur un vol reliant la France aux Etats-Unis en mars 2021, où se trouvent 243 voyageurs et voyageuses, va provoquer une cascade d’histoires singulières, de bouleversements, de prières et de spéculations. Un roman-feuilleton, miroir du temps présent. (E. Sr)
Hervé Le Tellier, «L’Anomalie», Gallimard, 328 pages
Dans la tête de Corinna Bille
C’est un livre qui s’adresse au jeune public mais auquel on prend grand plaisir à tout âge. «Toute une vie à écrire» parcourt la vie de l’écrivaine Corinna Bille en s’attachant à comprendre comment naît l’envie et le besoin d’écrire. Sylvie Neeman (collaboratrice du Temps) signe les textes et Albertine les dessins. Le livre s’ouvre sur une Corinna Bille quinquagénaire qui se souvient et qui raconte, à la première personne. L’immersion est d’une infinie délicatesse et permet de percevoir ce qui nourrit une vocation d’écrivain. (L. K. A.)
Sylvie Neeman (texte), Albertine (illustrations), «Toute une vie à écrire», La Joie de lire, coll. La petite bibliothèque de S. Corinna Bille, 96 pages
La fille du titan
La «grande épaule» du titre est celle d’un titan qui s’évertue à redresser les bords du monde que sa fille ne cesse d’aplanir en sautant dessus. Pourquoi «portugaise»? Pour le découvrir, il faut plonger dans l’univers poétique, mythologique, fantastique, comique d’un ouvrage qui ne ressemble à rien de connu: une chasse, un cirque, un festival d’inventions lexicales, un dialogue en fanfare entre les notes en bas de page et un récit sans cesse mis en doute. Une expérience jubilatoire pour lecteurs curieux. (I. R.)
Pierre Lafargue, «La Grande Epaule portugaise», Vagabonde, 272 pages
Devenir poreux au monde
Un petit café en Grèce, une rue de Zanzibar ou des mots albanais entendus à Lausanne: Corinne Desarzens recueille les épiphanies vécues en explorant les langues. Elle offre au lecteur un carnet de voyage, autant qu’un carnet à dessins: un livre conçu comme un trousseau de clefs pour ouvrir toutes les portes et traverser les murs. Une façon poétique et philosophique d’être au monde et un éloge de la porosité; un acte de résistance aussi, alors que la mondialisation invisibilise les différences, les lamine sous l’anglais insipide du tourisme et de la publicité. (J. B.)
Corinne Desarzens, «La Lune bouge lentement mais elle traverse la ville», La Baconnière, 343 pages
Saveurs du pain perdu
Le poète belge Guy Goffette publie un nouveau recueil à la fois mélancolique et joyeux sur la vie, la mort, l’enfance et le pain perdu. Le temps enfui et rassis est apprêté par l’auteur qui sait lui rendre son immédiateté, ses saveurs et sa profondeur, sa douceur acidulée: Goffette restitue l’enfance des choses. S’il n’oublie pas que la mort se cache, comme une ombre, derrière chacun de nos gestes, le poète ne cède en rien à la noirceur pour autant et nous délivre un secret: le pain de la vie est encore meilleur les jours d’après, dans le souvenir. Tout reste à découvrir, toujours. (J. B.)
Guy Goffette, «Pain perdu», Gallimard, 145 pages
Les voies de la mémoire
Il faut préciser une chose d’emblée: Hanna Krall est une célébrité en Pologne aussi importante que Ryszard Kapuscinski (1932-2007). Ils sont considérés comme le père et la mère du reportage littéraire. Hanna Krall poursuit son œuvre: faire de la littérature en allant recueillir des témoignages sur la Pologne des années de guerre et en puisant à ses propres souvenirs d’enfant cachée. Elle tisse les voix entre elles en laissant les trous dans le tissu des mémoires. Avec, toujours, comme dans Les Vies de Maria, cette mise au jour de la proximité entre le bien et le mal. (L. K. A.)
Hanna Krall, «Les Vies de Maria», traduit du polonais par Margot Carlier, Noir sur Blanc, 160 pages
Conversation entre amis
Pourquoi la lecture des recueils de Kathleen Jamie enchante à ce point? Avant de choisir le récit libre, l’essay des anglophones, l’écrivaine écossaise s’est consacrée à la poésie. Pour décrire la nature, les animaux, les humains et leurs saisons, elle emploie ainsi la fulgurance de la poésie, ces images si précises, si inattendues qu’elles ouvrent les yeux des lecteurs sur des réalités insoupçonnées. Kathleen Jamie fait cela avec la décontraction d’une conversation entre intimes. Dans Strates, on la suit en Alaska, en Ecosse, à Pékin. On la suivrait partout.
(L. K. A.)
Kathleen Jamie, «Strates», traduit de l’anglais par Ghislain Bareau, La Baconnière, 232 pages
Les Mémoires de Sottsass
Fameux designer et architecte italien, Ettore Sottsass (1917-2007) était aussi écrivain. Il raconte des instants de sa vie amoureuse et la traversée de paysages, entre la Toscane, Bombay et Tokyo. Pour Sottsass, seul prime l’éphémère: le velouté de la nuit, la beauté et le désir des femmes qui partagent sa vie. C’est la gravité et la flamboyance de l’instant voué à disparaître comme une bulle de savon qu’il poursuit. Ces instants qui n’ont aucun sens et auxquels on ne comprend rien, mais dans lesquels notre existence se révèle et libère tout son parfum. (J. B.)
Ettore Sottsass, «Ecrit la nuit. Le livre interdit», traduit de l’italien par Béatrice Dunner, Herodios, 98 pages
Des détails ordinaires
Deux courts essais virevoltants où l’autrice britannique Deborah Levy célèbre les victoires et les émotions souterraines enfouies dans les détails a priori ordinaires du quotidien: un collier de perles éclaté sur la chaussée, la plomberie de son appartement, l’aménagement d’une chambre à soi. Revenant sur son enfance marquée par l’apartheid et la vie après le divorce, elle livre une réflexion malicieuse et universelle sur le prix de la liberté, les affres de la création, les mythes de la féminité et la beauté arrachée au chaos. (Salomé Kiner)
Deborah Levy, «Ce que je ne veux pas savoir», traduction Céline Leroy, Editions du Sous-Sol, 144 pages
Humanité déconnectée
Au décollage: 12 vols, 12 voyageurs, 12 rencontres, 12 destins reliés pour une course de relais autour du monde. A l’atterrissage: 12 instantanés pointillistes captés à la fois dans un avion, un aéroport, un taxi, un hôtel, un bar ou une maison. De sa tour de contrôle, avec une grande économie de mots, David Szalay guide et compresse ses histoires avec subtilité, prenant sur le vif d’infimes fragments d’existence. En moins de 200 pages, il offre une vision panoramique et universelle d’une globalisation en crise, d’un monde ultra-connecté mais d’une humanité déconnectée. (Jean-François Schwab)
David Szalay, «Turbulences», traduit de l’anglais par Etienne Gomez, Albin Michel, 198 pages
La hargne de l’Amérique blanche
C’est le récit autobiographique d’une très jeune mère célibataire, pleine de joie et d’énergie, bien décidée à s’en sortir malgré la couleur de sa peau, dans l’Amérique ségrégationniste d’après-guerre. Rita (Maya Angelou) affronte avec courage et détermination, ainsi qu’une légèreté propre à l’adolescence, la hargne de l’Amérique blanche à l’égard de ses semblables. Rassemblez-vous en mon nom est la suite de Je sais pourquoi chante l’oiseau en cage et témoigne des mêmes difficultés, mais aussi de la même intelligence vive et du même amour obstiné de la vie. (E. Sr)
Maya Angelou, «Rassemblez-vous en mon nom», trad. de l’anglais par Christiane Besse, Noir sur Blanc, coll. Notabilia, 272 p.
Fléau argentin
Mangeterre est encore une enfant le jour où sa mère meurt, assassinée par son mari. Recueillie sur sa tombe fraîche, la gamine découvre qu’en avalant une poignée de terre, elle accède aux derniers instants des victimes de féminicide et autres disparitions suspectes. Dans son quartier de la périphérie de Buenos Aires, la rumeur se propage et bientôt des centaines de parents désespérés viennent implorer son aide. Sur fond d’impunité, de corruption et de précarité sociale, le premier roman de Dolores Reyes s’empare du fléau national argentin – en 2018, 278 femmes ont été tuées – pour en faire un conte onirique et violent mais porté haut par la vitalité de sa narratrice, inoubliable de justesse. (S. K.)
Dolores Reyes, «Mangeterre», traduit de l’espagnol par Isabelle Gugnon, L’Observatoire, 206 pages
Comme des cicatrices
Journaliste et poète née à Sofia et qui vit aujourd’hui en Ecosse, Kapka Kassabova a longuement arpenté la triple frontière bulgaro-turco-grecque pour en tirer Lisière, Prix Nicolas Bouvier 2020, superbe exploration, aux confins de l’Europe, de la mémoire et de l’altérité. Dans ce torrent de récits collectifs ou intimes, on s’engage tour à tour sur la piste des grands mythes ancestraux, de chercheurs d’or, des guerres balkaniques, du Rideau de fer, des exils forcés et des destins de migrants. Plus qu’une enquête historique et géographique, Lisière scrute les cicatrices que les frontières impriment sur le corps de l’humanité. (S. K.)
Kapka Kassabova, «Lisière», traduit de l’anglais par Morgane Saysana, Marchialy, 488 pages
Lire aussi: «Lisière», une virée aux frontières du récit
Tyll, héros moderne
Pour plonger dans le monde de la guerre de Trente Ans (1618-1648), Daniel Kehlmann convoque la figure de Till l’Espiègle, le bouffon qui dit son fait aux puissants. S’il prend des libertés avec l’histoire, le récit trace des tableaux extraordinairement vivants de cette période troublée: misère, famines, massacres. A la suite de Tyll, héros moderne, précurseur des Lumières, on rencontre le monde paysan, celui des savants, des inquisiteurs, des militaires, des philosophes et des rois: un périple enthousiasmant. (I. R.)
Daniel Kehlmann, «Le Roman de Tyll Ulespiègle», trad. de l’allemand par Juliette Aubert, Actes Sud, 416 pages
Lire aussi: La guerre de Trente Ans sur les traces de Tyll le bouffon
Une enfance dans l’armoire
L’Enfant lézard de Vincenzo Todisco est certainement l’une des lectures marquantes de 2020. Le romancier place le lecteur dans la tête d’un enfant clandestin, caché par ses parents saisonniers, dans la Suisse des années 1960. Quand un voisin, ou pire, le patron des parents, sonne à l’appartement, le petit garçon se précipite dans la grande armoire. Il va grandir ainsi et graduellement s’ensauvager. Pour traduire la violence indicible de la situation, Vincenzo Todisco la pousse jusqu’à l’extrême, jusqu’au drame. (L. K. A.)
Lire aussi: Enfant caché, enfant lézard
Vincenzo Todisco, «L’Enfant lézard», traduit de l’allemand par Benjamin Pécoud, Zoé, 202 pages
Grippe mortelle
L’Occident est ravagé par une grippe mortelle, c’est l’exode général vers le sud. Détournant un vieux ferry, une petite troupe de fugitifs échoue sur une île déserte plutôt accueillante. Réunie par le hasard, la centaine d’individus va tenter de faire société, vite déchirée entre ceux qui veulent retrouver le monde ancien et ceux qui s’accommodent très bien d’une vie nouvelle. Entre la tentation de l’autocratie et le désir d’anarchie, une expérience humaine fascinante, finement relatée par un des naufragés. (I. R.)
Xabi Molia, «Des jours sauvages», Seuil/Fiction & Cie, 256 pages
Lire aussi: Xabi Molia imagine la naissance d’un nouveau monde
Betty, l’Amérindienne
Si Betty est l’un des meilleurs romans de littérature américaine traduit en français cette année, c’est plus encore un personnage principal des plus mémorables. En rendant hommage à sa mère, descendante de Cherokees, Tiffany McDaniel a donné naissance à une héroïne universelle, qui devrait se hisser au panthéon des petites filles et adolescentes les plus marquantes de la littérature américaine. Ce livre est un bijou de 700 pages par sa qualité d’écriture, serti de perles amérindiennes, de légendes, de fantaisie et de poésie, contrepoids consolateur au racisme et au sexisme. (J.-F. S.)
Tiffany McDaniel, «Betty», traduit de l’anglais par François Happe, Gallmeister, 720 pages
Lire aussi: «Betty», une ode à la puissance féminine
Anna Maria Ortese, beauté sombre
Anna Maria Ortese, c’est Elena Ferrante à la puissance dix: plus fort, plus profond, plus radical. Dans ce livre devenu introuvable en français, réédité en 2020, cette écrivaine italienne, disparue en 1998, évoque la Naples des années de l’immédiat après-guerre, sortie en ruine de vingt ans de dictature fasciste. Qu’il s’agisse de nouvelles ou de reportages littéraires quelque peu survoltés, Anna Maria Ortese se met au diapason de cette ville excessive. Elle décrit sa misère, mais aussi sa formidable vitalité, dans une langue courageuse et d’une sombre beauté. (Jean-Bernard Vuillème)
Anna Maria Ortese, «La mer ne baigne pas Naples», traduction de l’italien par Louis Bonalumi, Gallimard, 193 pages
Lire aussi: Naples dans les mailles de la littérature
Amoureux de la même fille
Trois sexagénaires se retrouvent sur l’île de Martha’s Vineyard au large de l’Etat du Massachusetts pour un week-end entre vieux amis d’université. Tous étaient amoureux de Jacy à l’époque et avaient passé un week-end à quatre sur cette même île avant que la jeune femme ne disparaisse pour toujours. Accident, enlèvement, meurtre? Qui des trois garçons avait sa préférence? Quarante-quatre ans plus tard, un obscur voisin et un flic retraité viennent brouiller les pistes. Quittant le registre de la fresque sociale, Richard Russo surprend avec un drame psychologique exhalant une grande nostalgie. (J.-F. S.)
Richard Russo, «Retour à Martha’s Vineyard», La Table Ronde, traduit de l’anglais par Jean Esch, 384 pages
Lire aussi: Sur les traces d’une jeunesse enfuie, le nouveau roman de Richard Russo
Impossible n’est pas italien
A son meilleur niveau, Erri De Luca oppose dans son dernier roman un magistrat instructeur pugnace et un prévenu coriace. Pour l’enquêteur, il est impossible que cet ex-militant d’extrême gauche soit étranger à la chute mortelle en montagne d’un randonneur solitaire. C’est que le suspect, qui se trouvait dans les parages, avait subi des années de prison sur dénonciation de la victime, un ex-camarade. Au-delà de la question de savoir qui dit vrai, De Luca emmène le lecteur dans une méditation romanesque rigoureuse et poétique sur la justice, la trahison, l’amitié et l’amour. (J.-B. V.)
Erri de Luca, «Impossible», traduit de l’italien par Danièle Valin, Gallimard, 172 pages
Lire aussi: Erri De Luca au sommet de son art
«Les Gens de Seldwyla» enfin au complet
Pour la première fois disponible en français dans son intégralité, soit les cinq courts romans et nouvelles parus en 1856 et les cinq suivants, publiés en 1874, Les Gens de Seldwyla fait la démonstration du puissant génie narratif de Gottfried Keller. Seldwyla est une ville imaginaire dans la Suisse réelle du XIXe siècle. Ne cédant en rien au romantisme ambiant de son époque, Keller établit ses histoires sur un fond de réalisme transcendé de tonalités fantastiques et ironiques. Si longtemps attendue, la traduction de Lionel Felchlin est à la hauteur de ce chef-d’œuvre. (J.-B. V.)
Gottfried Keller, «Les Gens de Seldwyla», traduit de l’allemand par Lionel Felchlin, Zoé, 646 pages
Lire aussi: Le monument littéraire de Gottfried Keller paraît in extenso en français
Une fuite éperdue
Roman exalté et envoûtant, La Fuite extraordinaire de Johannes Ott emmène ses lecteurs sur les routes médiévales d’Europe centrale, des terres boueuses de Slovénie aux flots tumultueux de la République de Venise. Son héros fuit sans répit ses propres démons, la peste qui serpente de village en village, une justice expéditive qui se nourrit de bûchers. Même lorsqu’elle glace le sang ou retourne les viscères, la prose poétique de Drago Jančar reste somptueuse. Elle brille aussi d’intelligence et d’humanité, dans le regard nuancé qu’elle pose sur les rapports de pouvoir. (Annick Morard)
Drago Jančar, «La Fuite extraordinaire de Johannes Ott», traduit du slovène par Andrée Lück-Gaye, Phébus, 340 pages
Lire aussi: «La Fuite extraordinaire de Johannes Ott», le chef-d’œuvre enfin traduit de Drago Jančar
Romans policiers
Chaudron berlinois
Dans Metropolis, achevé juste avant sa mort en 2018, le Britannique Philip Kerr revient sur les années de jeunesse de Bernie Gunther, son personnage fétiche. Précédemment affecté aux Mœurs, le jeune flic rejoint la police criminelle pour enquêter sur le meurtre de trois prostituées, frappées à la tête puis scalpées. Peu après, ce sont des blessés de 14-18 restés handicapés qui sont assassinés. Nous sommes à Berlin en 1928, l’alcool et la drogue peinent à cautériser les plaies de la guerre et de la misère, le présent est explosif, l’avenir des plus incertains. Un tomber de rideau magistral. (Mireille Descombes)
Philip Kerr, «Metropolis», traduit de l’anglais par Jean Esch, Seuil, 392 pages
L’élégance du suspense
Combien d’écrivains se sont-ils cassé les dents sur le registre, si complexe, du thriller psychologique? Qui maîtrise vraiment le suspense reposant sur des angoisses intérieures, et pas sur le bon vieux tueur du coin? Réponse: la Québécoise Andrée A. Michaud. Elle avait déjà ébouriffé les amateurs avec Bondrée – il y avait alors des cadavres, dans cette forêt maléfique des grands espaces canadiens: mais l’horreur était mentale… Paru cette année, Tempêtes renchérit dans la peur des recoins. Une femme visite la maison où est mort son oncle adoré, et tout est fétide. En même temps, un écrivain fameux se rend dans la même région boisée pour éclaircir la mort de son scribe de l’ombre. Des obsessions qui se croisent, un suspense captivant autant qu’élégant. (Nicolas Dufour)
André A. Michaud, «Tempêtes», Rivages Noir, 334 pages
2010, années terroristes
La Fabrique de la terreur est le dernier volet d’une passionnante trilogie, primée au festival Quais du polar 2019, que le Français Frédéric Paulin a consacrée à la montée du terrorisme. L’auteur nous emmène du Printemps arabe de 2011 en Tunisie aux attentats de Paris en 2015. On y retrouve le sagace Tedj Benlazar, l’agent de la DGSE qui, désormais retraité, cède sa place sur le terrain à sa fille Vanessa, journaliste d’investigation. Mêlant avec talent réalité et fiction et sachant évoquer le pire sans s’y complaire, Frédéric Paulin nous offre des clés pour relire autrement des événements encore très proches. (M. D.)
Frédéric Paulin, «La Fabrique de la terreur», Agullo, 350 pages
Lire également: Frédéric Paulin: «J’écris pour dire que le monde va mal»
Le dernier Viking
Nuuk, Groenland, 2014. On découvre dans la glace le corps parfaitement conservé de ce qui pourrait être «le dernier des Vikings». Le lendemain, le cadavre s’est volatilisé et le policier chargé de monter la garde est retrouvé mort, éviscéré comme un phoque. Journaliste danois installé à Nuuk pour fuir son passé, Matthew Cave voit son scoop lui échapper. Pour s’occuper, il va se pencher sur une série d’anciens meurtres similaires restés impunis. Il bénéficiera de l’aide d’une jeune Groenlandaise fière et rebelle, Tupaarnaq. C’est elle, la «fille sans peau» qui donne son titre au roman. (M. D.)
Mads Peder Nordbo, «La Fille sans peau», traduit du danois par Terje Sinding, Actes Sud, 380 pages
Genève, un roman noir
Voilà un livre qui défie les catégories et les genres. Il relève aussi bien du roman noir que de la fresque sociale et propose, comme toujours chez le Genevois, une manière de «s’aventurer dans l’envers du décor». La Soustraction des possibles est aussi, d’abord, un magnifique travail d’écriture où Joseph Incardona se plaît à remettre en jeu son statut d’écrivain. Le récit se situe à la fin des années 1980 à Genève. Il tourne autour de la rencontre entre une financière prometteuse et un prof de tennis gigolo. Mais l’amour ne leur suffit pas. Ils veulent plus, beaucoup plus. (M. D.)
Joseph Incardona, «La Soustraction des possibles», Finitude, 390 pages
Lire aussi: Joseph Incardona: «Nous vivons dans un monde excessif»
Les brumes de Parme
Valerio Varesi retrouve ici la saison froide qui lui est chère. Envahi par le doute, son commissaire, Soneri, part sur les traces d’une femme d’origine roumaine dont le corps a été retrouvé carbonisé près d’un carambolage. D’une grande beauté, elle avait été la maîtresse de plusieurs hommes de la bonne société parmesane. Une manipulatrice? Une victime? Soneri va devoir trancher. Or, encens et poussière n’est toutefois pas que le roman d’une enquête. C’est le portrait d’une ville où l’auteur s’attarde avec tendresse sur les petites gens et ceux qui sont différents. (M. D.)
Valerio Varesi, «Or, encens et poussière», traduit de l’italien par Florence Rigollet, Agullo, 298 pages
Lire aussi: Valerio Varesi renoue avec Parme en hiver
Plus féroces que les bêtes
Pas besoin d’être fanatique des grands espaces pour apprécier ce roman qui envoûte par son atmosphère autant qu’il passionne par son intrigue. Il y est question de loups qui hurlent au loin, de pêche à la mouche dans des rivières à truites et de la disparition d’une jeune guide aux cheveux roux surnommée «la Vénus de Botticelli Creek». Le shérif Martha Ettinger et son complice Sean Stranahan vont avoir fort à faire pour séparer les bonnes pistes des fausses dans un univers où les hommes sont parfois plus féroces que les bêtes. (M. D.)
Keith McCafferty, «La Vénus de Botticelli Creek», traduit de l’anglais par Janique Jouin-de Laurens, Gallmeister, 432 pages
Idées
Les lois du numérique
Ne vous laissez pas décourager par le poids de ces 800 pages: elles constituent ce qu’il y a de mieux sur le monde numérique à ce jour. Dans un langage limpide, Shoshana Zuboff, professeure retraitée de Harvard, explique les lois de fonctionnement de la société numérique, ces lois qui n’apparaissent pas à nous autres utilisateurs, mais dont dépend la vie même du système. Très vite, vous comprendrez ce qu’est le «capitalisme de surveillance», le «surplus comportemental» ou le «marché des comportements futurs». Et vous ne verrez plus jamais vos petits smartphones du même œil. (Mark Hunyadi)
Shoshana Zuboff, «L’âge du capitalisme de surveillance. Le combat pour un avenir humain face aux nouvelles frontières du pouvoir», traduit de l’anglais par Bee Formentelli et Anne-Sylvie Homassel, Zulma, 844 pages
Décharge à ciel ouvert
De 1948 à 2001, l’île de Staten Island à New York a hébergé Freshkills, une gigantesque décharge à ciel ouvert qui empoisonnait la vie des habitants. Le site est en cours de réhabilitation pour être transformé en parc. Que reste-t-il des ordures sous les vertes pelouses, se demande Lucie Taïeb. Son récit sert de cadre à une réflexion sur notre rapport aux déchets, absents mais omniprésents. Un travail passionnant et très actuel, nourri par l’histoire, la géographie, l’anthropologie et l’urbanisme. (I. R.)
Lucie Taïeb, «Freshkills. Recycler la terre», La Contre Allée, 160 pages
L’illusion de la paix
Il y a un siècle, l’humanité sortait de l’une des pires pandémies de son histoire. Il y a un siècle, les Européens tentaient d’imaginer ce que pourrait être la paix après le carnage qu’ils s'étaient infligé. Ils se voyaient encore maîtres du globe alors qu’ils venaient de le laisser à deux puissances que tout opposait, les Etats-Unis et la Russie soviétique. Les années 1919 à 1921 ne sont pas les moments d’apaisement espérés. La guerre prend de nouveaux visages et le monde se voile d’illusions. En un tome, Jean-Yves Le Naour arpente cette période avec la fluidité d’un roman et l’érudition mordante d’un grand historien. (Romain Meyer)
Jean-Yves Le Naour, «1919-1921. Sortir de la guerre», Perrin, 544 pages
Nazisme et management
On aimerait le repousser dans des temps lointains, mais le nazisme n’est pas archaïque: c’est ce que la lecture de l’historien Johann Chapoutot, spécialisé dans l’histoire culturelle du nazisme, démontre brillamment. Faire rimer nazisme avec autoritarisme est une idée reçue: le système a été remarquable de modernité dans l’organisation des tâches. Les hauts dignitaires nazis ont réussi à convaincre des milliers de travailleurs et de soldats allemands qu’ils étaient «libres d’obéir». Une formule paradoxale qui donne son titre à cet essai brillant qui renverse un grand nombre de stéréotypes que nous avons sur cette période. (Christine Matthey)
Johann Chapoutot, «Libres d’obéir. Le management, du nazisme à aujourd’hui», Gallimard, 176 pages
Lire également: Johann Chapoutot: «Les nazis ont été des penseurs du management»
Humains et animaux
Agé aujourd’hui de 91 ans, le philosophe écossais Alasdair MacIntyre, connu pour son œuvre de philosophie morale et politique, a deux choses essentielles à nous dire: que la condition humaine est une condition animale, et que cette animalité rend l’homme vulnérable, donc dépendant des autres. A l’ère de l’individualisme triomphant, renforcé par l’emprise des technologies sur nos sociétés, il fallait ce regard d’un philosophe assis sur les épaules d’Aristote pour nous rappeler que nous ne naissons pas homme, mais le devenons, par et avec les autres. (M. Hu.)
Alasdair MacIntyre, «L’Homme, cet animal rationnel dépendant. Les vertus de la vulnérabilité», trad. de Gabriel Raphaël Veyret, Paris, Tallandier, 2020, 256 p.
L'Europe mais laquelle?
Européen convaincu, mais Européen déçu. L’Europe que Jean-Marc Ferry a sous les yeux l’accable, sur fond de son triple échec: celui de l’union monétaire, celui de l’union économique, celui de l’union politique. Son encre ressemble à une salve de boulets rouges. Mais Ferry est sans doute le meilleur philosophe de l’Europe: il ne peut donc pas en désespérer. A quoi devrait ressembler une vraie Europe, conforme à son projet? Il en décrit le scénario économique, politique, philosophique. Ce livre majeur se lit comme un diagnostic et une thérapeutique, pour que l’Europe soit à la hauteur de sa propre idée. (M. Hu.)
Jean-Marc Ferry, «Comment peut-on être Européen? Eléments pour une philosophie de l’Europe», Calmann-Lévy, 270 p.
Epoque de crise
«Foule sentimentale, il faut voir comme on nous parle»: sur un air d’Alain Souchon, plongez-vous dans ce bref essai qui date du monde d’avant mais qui pourtant répond si bien aux questions de notre époque de «crise». Eric Chauvier appelle à un exercice, ardu, d’hygiène lexicale: clarifier l’usage des mots pour éviter la «prostration du langage». Réfléchir, chaque jour, comme une discipline de vie, à la manière dont s’instille le poison lent d’une communication négative, créé par la rhétorique de l’urgence. (Ch. M.)
Eric Chauvier, «La crise commence où finit le langage», Allia, 64 pages
Lire aussi: Eric Chauvier, expert en territoires perdus
Les limites du système
«Nous devons trouver de nouvelles formes de coopération»: c’est le cri du cœur de Fabian Scheidler. Son imposant essai vient mettre à mal ce qu’il dénonce comme le «mythe de la modernité». Ce n’est pas le Moyen Age qui est une sombre période, comme on nous l’enseigne à l’école, mais le début des temps modernes. Le dramaturge et journaliste allemand s’attache à démystifier l’histoire du progrès, compris comme une machine de croissance. Qu’il nous appelle à ralentir, en abandonnant la volonté de domination de la nature. Une réflexion d’actualité sur les limites du système. (Ch. M.)
Fabian Scheidler, «La Fin de la mégamachine. Sur les traces d’une civilisation en voie d’effondrement», Seuil, coll. Anthropocène, 624 pages.
Bande dessinée
Le poète aux mille masques
Le visage du Christ au bout du voyage. Mais sous le pinceau de Frédéric Pajak, sa figure est celle d’un Mohican. Comment mieux signifier l’extraordinaire entreprise de l’écrivain et dessinateur franco-suisse? Depuis dix ans, chaque tome du Manifeste incertain sonde le mystère d’un artiste irréductible. Il consacre le dernier à Fernando Pessoa, ce poète aux mille et un masques. Fidèle à sa ligne de fuite, Pajak creuse l’énigme et digresse sur sa vie. Jusqu’à cette butée: un Christ indien, qui échappe à toute assignation. Pajak rend grâce à ses ombres, en paladin inclassable. Sa quête est le trésor de ses lecteurs. (Alexandre Demidoff)
Frédéric Pajak, «Manifeste incertain 9. Avec Pessoa», Noir sur Blanc, 350 pages
Lire aussi: Frédéric Pajak: «Avec Pessoa, je parle aussi de ma génération, de nos blessures»
Lire également: Pajak au soir d’un long voyage
Tif et Tondu contre-attaquent
Héros historiques du Journal de Spirou, Tif le chauve et Tondu le barbu s’étaient éclipsés depuis des décennies. Sur un scénario de son frère Robber, Blutch relance les deux détectives dans une aventure hard boiled articulant la disparition de leur amie Kiki et la présentation d’un robot de combat aux représentants de la pègre mondiale. Les teintes grège et bleuâtre des cases traduisent l’ambiance parisienne au temps des cabines téléphoniques. Nourri de références cinématographiques, le trait virtuose de Blutch fait merveille dans cette résurrection inespérée. (Antoine Duplan)
Blutch (dessin), Robber (scénario), «Mais où est Kiki?», Dupuis, 78 pages
Lire également: Tif et Tondu reviennent de loin
Larcenet contre ses démons
Certains flippés avalent les tranquillisants par pleines poignées. Larcenet, du moins l’avatar difforme qui porte son nom, les consomme à même l’armoire à pharmacie comme s’il éclusait un tonnelet de bière. Souffrant de troubles maniaco-dépressifs, le dessinateur fait de cette noirceur le thème de Thérapie de groupe. Rappelant que le bouillonnement d’idées est une cause d’impuissance créatrice, il multiplie les fausses pistes dans un déchaînement sidérant de pastiches, de dérives absurdes et d’introspection à l’encre noire de la mélancolie. (A. Du.)
Manu Larcenet, «Thérapie de groupe – 1. L’Etoile qui danse», Dargaud, 56 pages
Grandir avec Esther
C’était hier, Esther avait 10 ans. Elle en a 14 aujourd’hui et Riad Sattouf continue d’entretenir avec elle le dialogue qui nourrit Les Cahiers, témoignage unique d’un esprit qui s’ouvre au monde, guette les accélérations de l’histoire («gilets jaunes», incendie de Notre-Dame) et se confronte aux babouineries acnéiques des garçons. Esther grandit, nous grandissons avec elle et grandit l’admiration que suscite le travail de Riad Sattouf, sachant exprimer les remous de l’adolescence dans un trait d’une lisibilité universelle. (A. Du.)
Riad Sattouf, «Les Cahiers d’Esther – Histoires de mes 14 ans», Allary, 54 pages
Le chagrin des Belges
Vers 1950, dans le port d’Anvers, un Marsupilami parvient à s’échapper des mains des trafiquants qui l’ont capturé en Palombie. Arrivé dans la banlieue de Bruxelles, «la bête» est adoptée par le jeune François Van Den Bosche. Saint François juvénile du faubourg, le garçon accueille dans la masure maternelle toute la misère du monde animal. «Bâtard» d’un soldat allemand, François endure le mal des écoliers que police l’instituteur Monsieur Boniface, avatar de Franquin, créateur de l’animal légendaire. Œuvre célinienne en hommage au bédéiste Maurice Tillieux, fable initiatique contre la maltraitance animale et la duplicité des adultes, ce chef-d’œuvre graphique est indéniablement une des plus belles bandes dessinées de 2020. (Michel Porret)
Zidrou et Frank Pé, La Bête, tome 1, Dupuis, 155 pages
* Les journalistes:
- Julien Burri
- Alexandre Demidoff
- Mireille Descombes
- Nicolas Dufour
- Antoine Duplan
- Mark Hunyadi
- Salomé Kiner
- Lisbeth Koutchoumoff
- Christine Matthey
- Romain Meyer
- Annick Morard
- Michel Porret
- Isabelle Rüf
- Jean-François Schwab
- Eléonore Sulser
- Jean-Bernard Vuillème































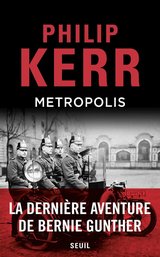





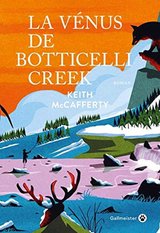














Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire