
In « Paul Louis Rossi », éd. Herscher, coll. Carnet recomposé © Paul Louis Rossi
Une moisson éclectique
par Marie Étienne7 juin 2023
9 mn
Esquif Poésie (12)
Les publications de poésie ne sont malheureusement pas toujours recensées autant qu’elles le mériteraient. En voici quelques-unes, qui ont tout particulièrement retenu notre attention.
Emily Dickinson, Where rode the bird. Trad. de l’anglais (États-Unis) par Nicolas Millet. Atmen, 2 vol., 80 p. et 76 p., 7,20 € chacun
Juliette Fontaine, La déployée suivi de Des pas sur Moà-Neige. Atmen, 64 p., 12 €
Les éditions Atmen proposent avec modestie des livres de petites dimensions (14/10) fabriqués artisanalement : le montage, le façonnage, la reliure (pages cousues) sont faits main. « La question est d’abord, précise leur responsable Nicolas Millet, celle du livre : de l’expression matérielle adéquate/juste de la dimension spirituelle du poème – étant entendu, qu’au fond, elles ne se dissocient pas. »

Elles présentent deux publications. La première est un classique : Where rode the bird (Là où chevauchait l’oiseau), d’Emily Dickinson, en deux volumes, dans une traduction inédite (Nicolas Millet) et surtout avec la reproduction du manuscrit où les mots sont à peine visibles, comme en partie perdus, effacés par le temps, et c’est très émouvant.
« Fasse que la première de mes connaissances soit toi
Avec du matin la Lumière qui réchauffe –
Et la première de mes Frayeurs, de peur que des inconnus
T’engloutissent dans la nuit. »
La seconde est due à une artiste contemporaine, autrice, artiste plasticienne et commissaire d’expositions indépendante, Juliette Fontaine : La déployée suivi de Des pas sur Moà-Neige.
« elle est là
quand les jardiniers ouvrent la porte
elle dort dans le seuil. »
Gilles Jallet, Les Utopiques, I. La rumeur libre, 192 p., 18 €
Dans un très beau préambule, l’auteur propose une lecture de son livre et même un aperçu d’une poétique. Pourquoi ce titre ? « Les Utopiques, comme il existe Les Pythiques (Pindare), Les Bucoliques et Les Géorgiques (Virgile), Les Tragiques (Agrippa d’Aubigné), et la comparaison s’arrête là. »
Le ton est donné, Gilles Jallet vise haut. Mais il poursuit aussitôt, contredisant l’ambition du projet : « Sous ce titre, j’ai rassemblé un corpus de fragments poétiques […] qui m’auront conduit progressivement à l’impossibilité d’écrire ou d’achever quelque chose comme un poème ».
Le poème achevé est-il pour autant satisfaisant ? Ne peut-il pas au contraire être considéré comme figé par un académisme qui ne tient pas compte des états antérieurs ? Si l’on prend l’exemple de Mallarmé, « le corpus d’archives a remplacé le poème unique », et les chercheurs, peut-être même les lecteurs, s’intéressent davantage aux états successifs, comme si, au fond, l’état définitif n’existait pas. Une réflexion passionnante et très contemporaine que Gilles Jallet ne peut qu’esquisser ici, mais qui, manifestement, lui tient à cœur.

Les Utopiques, pour lui, sont des poèmes qui « ont été construits en l’absence de tout fondement solide, et ne se soutiennent que par eux-mêmes, comme des constructions de tours dans l’espace ». Image magnifique, qui fait penser aux Tours de Trébizonde de Jean Tardieu, peut-être aux constructions de Piranèse, compliquées, torturées, suspendues dans l’espace. On y sent une tristesse, certainement un désarroi ; qui sait, un désespoir : « On y chercherait en vain le rêve du lieu où habiter, d’une maison qui penche ».
Et il conclut : « Je ne puis m’empêcher ici de penser à tous les anges pauvres de Paul Klee. Même celui qui parvient au zénith de sa plénitude est encore un ange pauvre. »
Les poèmes du recueil sont portés par la conviction que la poésie est grande et primordiale, à la manière d’un Mallarmé, mais aussi qu’elle s’écrit au bord d’un gouffre : celui de son échec.
« La lumière donne
l’ombre
comme soleil neige
Sur la pierre
épiée une hostie
de sang bleu
À la voix simple
s’oppose
le mélange des voix
Qui soufflent
sur des braises encore
grises et vides. »
Rigueur de la forme, affirmée par des strophes régulières qui commencent souvent par des vers répétés d’un poème à un autre, préciosité des termes, exigence des références, concourent à donner de Gilles Jallet l’image d’un poète qui oscille entre philosophie et pratique de la poésie, entre ivresse des hauteurs et terreur de la chute. Ajoutons qu’il dirige, accompagné par le poète et homme de théâtre Xavier Maurel, la revue Monologue.
Séverine Daucourt, Les éperdu(e)s. Petit précis de psychiatrie poétique. Lanskine, 92 p.,15 €
Le livre est composé d’une alternance de phrases qui commencent par un « Quand » mais ne s’achèvent pas, et de textes tirés d’une prose médicale qui éclairent leur contexte. Ce qui donne un récit haletant, dont l’autrice, ou la narratrice, apparaît à la fois démunie et hors d’elle – en rage et en dehors, aux yeux des autres, de sa raison.
Elle adapte son langage à tout ce qui l’agite. Le désarroi : « Quand je parle à une blouse verte qui ne semble pas connaître ma langue, comme si j’étais désaccordée… » ; le sentiment de solitude : « Quand je me rends compte, bien après mon arrivée, que personne ne m’a jamais demandé comment je vais… » ; et d’insécurité : « Quand rien ne me protège et que j’acquiers la conviction intime que l’hôpital n’est pas un lieu sûr » ; la perte des repères et l’impression de fantastique : « Quand je me suis dit que mon visage avait fondu », « Quand je deviens un fantôme ».
Or, ce qui frappe, qui saisit, qui bouleverse, en lisant cette prose sur-tendue comme un cri qu’on expulse, c’est bien la clairvoyance, la lucidité quasi impitoyable d’une personne échappée de son suicide, qui juge et voit sévèrement le monde qui la soigne : « Quand je dois me déshabiller et traverser nue une chambre de huit malades… » et les proches qui l’entourent : « Quand ma cousine me fait la leçon au bout du fil parce que j’aurais pu gâcher son mariage en mourant trois jours avant… »
Les situations tragiques, humiliantes et absurdes en milieu médical, dont le projet paraît, plutôt que de soigner, de punir avant tout, sont narrées vivement, comme des récits hâtifs envoyés au lecteur, qui blêmit puis respire, soulagé, en même temps que la patiente lorsque la situation s’apaise, ou qui souffre avec elle lorsqu’elle est anxiogène : « Quand ils m’ont tellement enfoncée, ouvertement détestée que s’ils me relâchent, ils auront gain de cause : une fois dehors, je déserte définitivement, me jette sous les premiers rails. »

Après la tentative de suicide, l’hôpital d’urgence, c’est l’hôpital psychiatrique. Avec sa cohorte de cabossés qui n’a rien d’avenant, d’accueillant. Avec l’incapacité des soignants à identifier la patiente : « autiste, dépressive, bipolaire, borderline, petite pute, post-traumatisée, hypocrite, hystérique, sanguinaire, poète ? ».
Puis c’est la tentative de sortir pour s’en sortir, sinon « je vais vraiment devenir folle ».
Et enfin, enfin, le retour à domicile, à l’existence normale ou qui se voudrait telle mais qui met bien du temps à surmonter le mal de vivre. « Quand je me dis : et si ma faiblesse était ma force ? » Qui y parvient grâce au divan de la psychanalyse et à la poésie.
Vers la mi-temps du livre, la narratrice bascule : suffisamment « guérie » et devenue poète, elle inverse les rôles et s’occupe à son tour de ceux qui sont atteints dans leur psychisme. À quoi lui sert, dans ce contexte, la poésie, activité en marge, que l’on sait inutile ? À rendre « non pas compréhensible mais lisible » la maladie. Elle, la narratrice, et eux-elles, les exclu-e-s car malades, les en dehors du corps social et en contestation, sont frères et sœurs, se tiennent la main. Ensemble, ils portent un œil critique sur ce qui les entoure. « Tout le monde rêve d’avoir des troubles mentaux, sauf ceux qui en ont » ; « Quand être malade, soudain, devient aussi naturel que les catastrophes » ; « Quand je passe plus de temps à rédiger des comptes-rendus qu’à écouter ceux qui ont besoin d’être entendus ».
La voix de Séverine Daucourt est à entendre absolument : bouleversante, tragique, humoristique parfois, elle n’est jamais pesante, dynamique au contraire, portée par un élan qui ressemble à la joie, qui est peut-être, tout simplement, le goût, l’amour des autres, l’obstination : ne pas couler, rester à flot, « partir en quête d’un soi non colonisable ».
Marc Blanchet, Suites et fins. Le Cormier, 112 p., 16 €
Marc Blanchet a publié des livres de poésie, de prose, des essais sur des peintres (Gérard Titus-Carmel, Jean-Gilles Badaire), sur des écrivains (Samuel Beckett, Lokenath Bhattacharya), et des ouvrages qui consacrent son travail d’écrivain et de photographe.
Les poèmes de ce volume sont brefs, calés en haut des pages. Dans la première série, Frères, ils évoquent une enfance malheureuse, une fratrie écrasante.
« Des années à me soustraire,
être moins que le dernier.
À rester au secret de la mère,
ne pas gêner
les ascensions en cours.
S’avouer pure perte,
Se cacher derrière la forêt.
Ailleurs qu’en la table garnie. »
Le ton : il oscille entre l’effacement de soi, enfermé dans une « cage/où la parole s’étrangle » et une violence intérieure qui « rêve de mettre le feu/à une vie d’archive ».

Demeure sombre dans les deux ensembles suivants, Forteresse et Roses.
« Sachant plutôt mordre
que se dresser, ramper
que découvrir sa marche, il est
son propre animal de compagnie. »
On peut le constater : absence de compassion vis-à-vis de soi et peut-être des autres, hostilité de l’extérieur, souvent flou, comme vu à travers des lunettes de myope, ainsi qu’en témoignent les photos, visibles sur internet.
Dans En attendant Nadeau, Jean-Patrice Courtois analysait, en juillet 2021, Le Pays, paru à La Lettre volée, accompagné de photographies. « Le ton du livre, en effet, exclut la plainte et ne se signale que dans le “gris dire du gris”, qu’accompagne de temps à autre une couleur disparaissant sitôt apparue. Le poète et le photographe se tiennent la main. »
Une voix solitaire, qui a une force et une tessiture unique.
Christiane Veschambre, Julien le rêveur. Isabelle Sauvage, 92 p., 15 €
Il y a longtemps que nous suivons et aimons les livres de Christiane Veschambre, tantôt poésie, tantôt prose, tantôt les deux à la fois. Julien le rêveur fait partie de cette dernière catégorie. Il est rédigé en prose avec des mots, des formulations de poète, il raconte une histoire magnifique, bien que son autrice se dise peu encline à « écrire pour raconter des histoires ».
Et de fait, elle ne raconte celle-ci que partiellement, comme si, au fond, l’intérêt qu’elle y prenait était ailleurs, pas vraiment transmissible, ou tu, non révélé.
En quelques mots, voici l’intrigue : Julien est un inadapté, un sans talent d’aucune sorte, que l’employé de Pôle emploi essaie en vain de sortir du chômage : « Que savez-vous faire ? Rien, pensait Julien en regardant la cravate rose fuchsia à motifs vert amande… ». Un jour, l’employé apprend que les nuits de Julien sont habitées de rêves, cependant que les siennes sont vides : « Il s’endormait le soir avec l’espoir d’être traversé par la vie imprévisible des rêves, même les douloureux, et il craignait par-dessus tout l’insomnie totalitaire qui vous enclot entre les barbelés de la conscience ».
La solution au problème de Julien devient alors évidente : il fournira des rêves à ceux qui n’en ont pas.
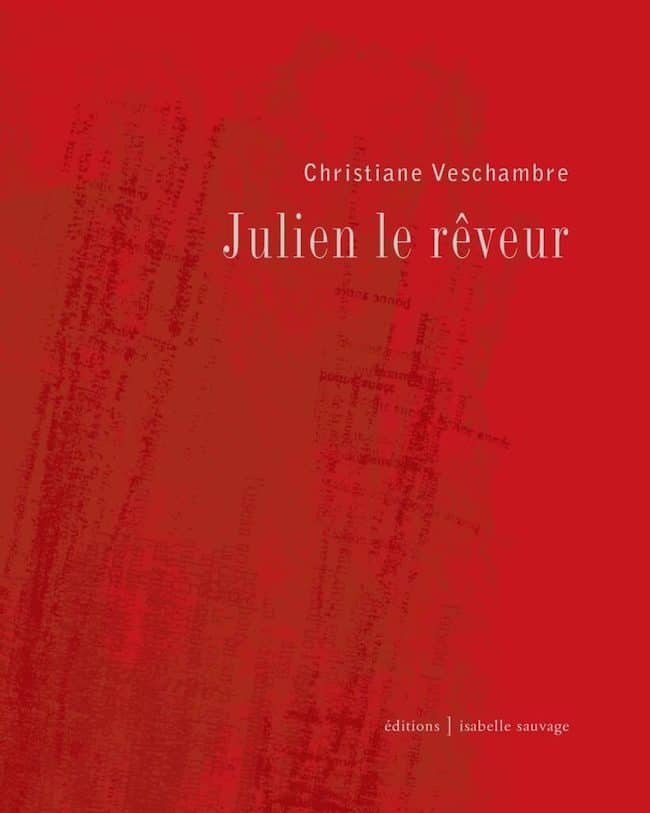
Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Rêver pour les autres n’est pas une sinécure, on s’y épuise, on y perd sa substance. De même que l’amie de Julien, devenue écrivaine publique, n’arrive plus à écrire pour son compte, « plus rien ne sort du silence qui me faisait écrire », de même Julien perd peu à peu son pouvoir onirique, il s’assèche : « De rêves, même amaigris, il n’en fait plus ».
L’autrice s’amuse, c’est évident. Aussi hésite-t-on à tirer de son texte une leçon, qui conclut, par exemple, de l’échec de Julien que l’art est une pratique secrète et solitaire. Elle s’amuse, elle s’efface, au point de raconter des rêves qui ne sont pas les siens, d’aller jusqu’à prétendre que l’histoire de Julien est racontée par une voisine (de son héros) et non par elle. La croira-t-on ? Pas sûr.
Christiane Veschambre a l’art des doubles, et des récits rêveurs à doubles-fonds. Elle fait parler des personnages, comme dans dit la femme dit l’enfant, paru chez le même éditeur en 2020 – un livre très prenant, très intrigant, dans lequel la parole se confond, circulant, l’identité aussi, le temps, le monde autour. « c’est un soir, j’aurais mis longtemps à arriver, et dès lors je ne ferai que me remettre en route, par tous les temps, sur une route que je dois susciter avec mes propres pieds de marcheuse, la route unique de ma disposition absente infiniment secrète qui s’est un soir cristallisée sans rien retenir de tes, dit la femme, de mes, dit l’enfant, tournoiements sur échasses, de mon attente de l’autre monde, dit l’enfant ».
Il faut guetter ses livres, les lire absolument, ce sont des objets rares, des minerais précieux comme extraits d’elle avec du temps et beaucoup de patience.


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire