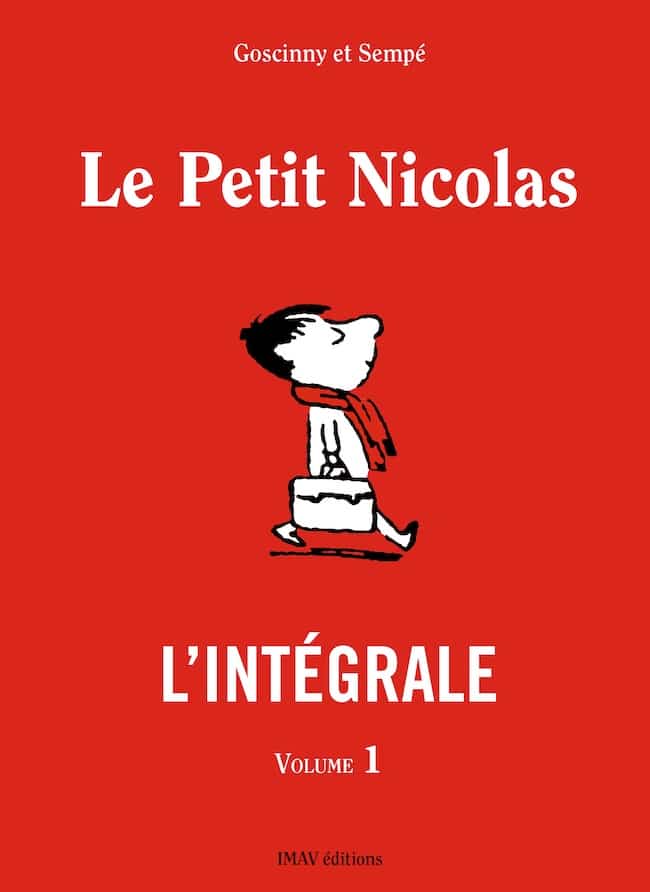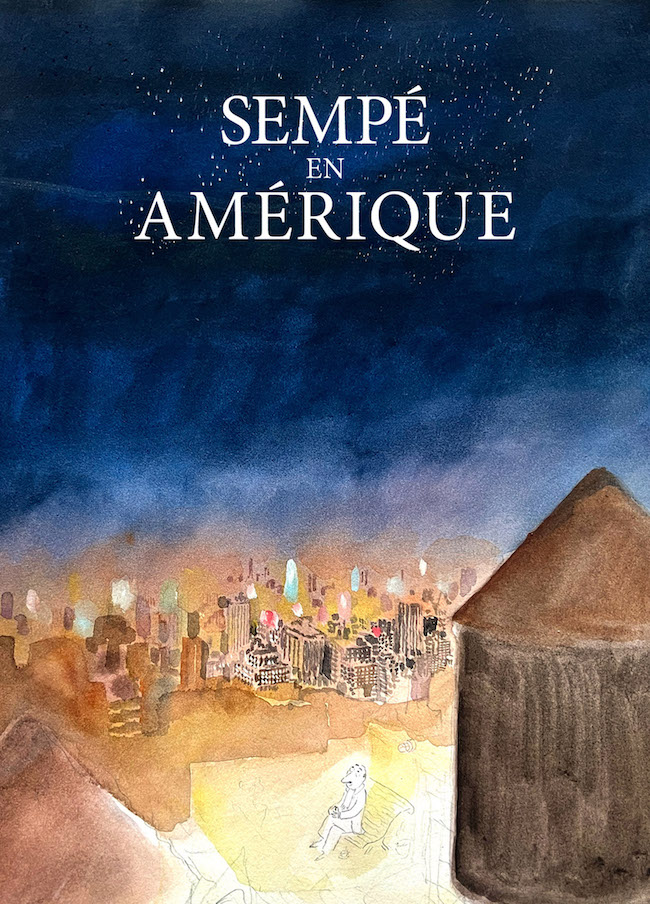|
| Svetlana Alexievitch |
Traduire Svetlana Alexievitch
par Santiago Artozqui11 janvier 2016
Traductrice de Boris Pasternak, Boris Pilniak, Nadejda Mandelstam et de bien d’autres auteurs en langue russe, Sophie Benech a vu son travail distingué à plusieurs reprises, notamment par le prix Laure Bataillon classique. Elle a également fondé les Éditions Interférences sur un coup de cœur littéraire, en 1992, mais c’est en tant que traductrice de deux des livres de Svetlana Alexievitch – Ensorcelés par la mort et La Fin de l’homme rouge – qu’elle nous rencontre aujourd’hui.
Svetlana Alexievitch a construit son œuvre sur des témoignages qu’elle a recueillis pendant des années. Quelles difficultés cette oralité pose-t-elle au traducteur ?
Les livres de Svetlana Alexievitch s’inscrivent dans une forme littéraire qui demande, au vu des sujets qu’elle aborde, une grande rigueur intellectuelle, de l’honnêteté et de l’intégrité, de sa part comme de celle du traducteur. À partir des paroles qu’elle a entendues, son problème, en tant qu’écrivain, c’est de rendre tout ce qui n’est pas écrit dans la transcription, mais qui est véhiculé par autre chose, par la voix, par l’attitude de la personne : tout cela, Alexievitch le restitue par le travail littéraire qu’elle fait sur son texte, les phrases qu’elle sélectionne, la manière dont elle les articule… C’est ainsi qu’elle transpose l’ambiance et l’intonation, et qu’elle construit sa narration. Comme dans toute traduction, notre rôle consiste à capter ce rythme, cette ambiance, et à les rendre en français. Cela passe par le style. Tout passe par le style.
Avez-vous rencontré des problèmes de registre de langue pour traduire ces témoignages ?
Le dernier livre de Svetlana Alexievitch que j’ai traduit, La Fin de l’homme rouge, contient des témoignages, mais aussi des propos qu’elle appelle : « bruits de la rue, conversations de cuisine ». Des rumeurs. Des gens qui parlent. Ce ne sont pas des dialogues, simplement la juxtaposition de beaucoup de répliques, et donc une oralité qui pose le problème de la transposition du langage parlé. Il faut rendre un texte qui soit naturel en français. Ce qui me frappe, quand j’écoute des émissions de radio ou de télé des années 1950 et 1960, c’est qu’à l’époque, les Français s’exprimaient bien plus correctement qu’aujourd’hui, ils avaient un vocabulaire plus riche. Je trouve que beaucoup de Russes ont un langage qui ressemble à celui que nous avions alors, probablement parce que l’instruction dispensée dans les écoles d’Union soviétique était d’un très bon niveau. Et la langue qu’ils parlent se prête bien à la forme littéraire.
Par ailleurs, Svletana affirme que lorsqu’on a une conversation profonde avec quelqu’un, lorsqu’on touche à des sujets vitaux, les gens trouvent des paroles beaucoup plus poétiques, des images plus vivantes et plus fortes. Je crois qu’elle a raison… Et je pense également aux contes populaires, des textes où l’on trouve des phrases très poétiques et qui circulent depuis longtemps sans qu’on en connaisse l’auteur. La qualité de la langue parlée en Russie résulte peut-être aussi de ce fonds commun.
En tant que russophone et traductrice, où situez-vous l’écriture d’Alexievitch dans le paysage littéraire russe ?
Avant elle, quelques précurseurs de cette littérature documentaire ont employé cette technique, par exemple des gens qui ont recueilli des témoignages pendant la guerre de 14-18. Moi, elle me fait penser à Chalamov, un des plus grands écrivains russes à avoir écrit sur le Goulag. Il a passé dix-sept ans à la Kolyma, dans les mines d’or, et a laissé les plus beaux récits de la littérature russe sur les camps. Dans cinq cents ans, Chalamov sera encore là. Il a beaucoup réfléchi sur le sens à donner au fait d’écrire à propos d’expériences extrêmes, ainsi que sur la question : « a-t-on le droit de faire de la littérature sur les camps ? » D’après lui, la littérature de l’avenir, c’est le document, le document va l’emporter sur le roman. Alexievitch dit à peu près la même chose lorsqu’elle affirme que le prix Nobel constitue la reconnaissance d’une sorte de littérature fondée sur le document, mais qui ne se réduit pas à cela et qui devient de plus en plus importante, sans pour autant tuer le roman, bien sûr.
Vous avez travaillé sur cet auteur pendant une période de vingt ans. Quelles différences avez-vous ressenties entre la Svetlana de 1994 et celle de 2013 ?
D’après Svetlana Alexievitch elle-même, le premier livre que j’ai traduit, Ensorcelés par la mort, est une sorte d’embryon du dernier, La Fin de l’homme rouge. Dans les années 1990, il y a eu une vague de suicides en Russie à la suite de la chute de l’Union soviétique ; Alexievitch a recueilli des témoignages de personnes qui avaient survécu à leur tentative de suicide, ou de proches de suicidés, et elle a fait ce premier livre. Puis, lorsqu’elle l’a terminé, elle s’est rendu compte qu’elle voulait prendre une autre direction. Elle l’a donc mis de côté et a écrit La Fin de l’homme rouge, qui en reprend quelques extraits, mais agencés différemment. Une différence qui ne relève pas tant du style que de la façon dont elle a utilisé ces témoignages pour mieux les recentrer sur ce qu’elle voulait dire. Évidemment, c’est subjectif. Le choix des phrases, des passages… Quand elle écrit, elle a une idée vers laquelle elle progresse et qui s’affine au fur et à mesure. Dans chaque livre, elle essaie de poser une question. D’après moi, ce qui a changé en vingt ans, ce n’est pas tant sa méthode de travail que la question qu’elle s’est posée.
Quand vous traduisez, vous interagissez beaucoup avec elle ?
Non, pas tant que ça. Avec le temps, je me suis rendu compte qu’il valait mieux poser des questions aux collègues. Très souvent, sauf quand il s’agit d’éclaircir un point purement factuel, nos questions sont mal comprises par les auteurs, qui ont tendance à ne pas voir quel est le problème, surtout s’ils ne connaissent pas la langue cible. Cela dit, j’aime beaucoup Svletana, nous avons des rapports amicaux, et c’est important dans le sens où on est sur le même plan. Quand on parle de certaines choses, on s’aperçoit qu’on les comprend de la même manière, et lorsqu’un traducteur se dit : « je comprends la personne, je sens ce qui l’intéresse chez les gens, le niveau de profondeur auquel elle se trouve », je pense que ça peut l’aider dans sa traduction. J’espère que je la traduis mieux que si je ne la comprenais pas, ou que si je n’avais aucun atome crochu avec elle. C’est plutôt ça… J’ai l’impression de ressentir les choses comme elle a pu les ressentir. Pour moi, quand on traduit, il est important d’aimer l’auteur qu’on traduit.
On sait que le choix des titres relève souvent de l’éditeur et non du traducteur. Les cercueils de zinc, en russe, c’est Les Garçons de zinc, et La Supplication, La prière de Tchernobyl. Que pensez-vous des traductions de ces titres ?
Le titre d’un livre, c’est très important, et Alexievitch dit qu’elle ne comprend vraiment la direction qu’elle veut donner aux siens que lorsqu’elle l’a trouvé. La Fin de l’homme rouge ne s’appelle pas comme ça. En russe, c’est L’Époque de seconde main. Pourtant, ce titre est essentiel pour Alexievitch. En français, on aurait pu dire “Le temps du recyclage” : le recyclage des idées, des idéologies, mais également de ce que les Russes vont récupérer en Occident. Pendant les années 1990, on recyclait sur les marchés russes tout ce qui venait de l’Ouest, les vêtements, les médicaments… mais aussi les idées. Cet aspect-là, fondamental, est absent du titre français. Cela dit, les éditeurs ont leurs raisons, et il est vrai qu’un mauvais titre peut également tuer un livre.
Svetlana Alexievitch affirme que La Supplication est son livre le plus important. Diriez-vous la même chose et pourquoi ?
Ce qu’elle dit, c’est que La Supplication est le livre qui l’a le plus marquée, car il traite d’un événement inédit. Quand elle essayait de faire parler les gens, elle s’apercevait que c’était la première fois dans l’histoire de l’humanité qu’une telle chose se produisait, et donc qu’il n’existait aucune littérature, aucun discours préalable sur ce sujet. C’est cela qui l’a marquée. Les guerres, l’écroulement d’un empire, il y a des précédents, même si tout n’est pas comparable. Tchernobyl, c’est autre chose. Une chose pour laquelle on n’avait pas de mots. Svetlana Alexievitch a donc essayé de mettre des mots sur cette chose-là.
Par ailleurs, elle dit aussi que le livre qui l’a fait changer, qui lui a fait prendre conscience du mensonge soviétique dans lequel elle avait grandi, c’est Les cercueils de zinc, quand elle est allée en Afghanistan et qu’elle s’est aperçue que tout ce dans quoi elle avait grandi était faux. Les Russes étaient haïs par les Afghans, alors qu’en URSS, tout le monde pensait qu’ils avaient été accueillis là-bas en libérateurs. Elle a compris le fossé qui existait entre ce qu’on leur répétait depuis leur enfance et la réalité. Cependant, elle considère que ces cinq livres, que ce cycle de chroniques sur l’Union soviétique est terminé. Vivre pendant tant d’années avec ces témoignages si déchirants a été dur, d’autant que pour les écrire elle les a fait passer à travers elle. Maintenant, elle a envie d’écrire sur l’amour, la vieillesse et la mort, mais au terme de vies qui ne sont pas nécessairement tragiques.
Pour conclure, quelle est votre actualité ?
Je viens de traduire pour Gallimard La Mouette au sang bleu, de Iouri Bouïda, un auteur contemporain avec un univers à la Faulkner, l’histoire d’une actrice folle de Tchekhov. Son premier livre, Le Train zéro, était un tout petit récit, mais très beau, une parabole sur un train qui passe toujours et qui ne s’arrête jamais. Rien à voir avec Alexievitch, donc, mais tout aussi passionnant. Par ailleurs, je commence les Notes sur Akhmatova, de Lydia Tchoukovskaïa, avec les éditions Le Bruit du temps, qui ont publié les Œuvres complètes d’Isaac Babel.
Propos recueillis par Santiago Artozqui
EN ATTENDANT NADEAU