 |
| Johnny Depp |
Johnny Depp, acteur aux mains d'or
Aurélien Ferenczi
Publié le 22/01/2008. Mis à jour le 23/01/2008 à 17h29.
Tim Burton a un peu grossi, il n’a pas vu un peigne depuis la sortie d’Edward aux mains d’argent (en 1990), et par une matinée pluvieuse d’hiver londonien, il porte d’épaisses et incongrues lunettes noires qui lui donnent un drôle d’air d’insecte repu. En revanche, le jeune homme qui l’accompagne – jean troué mais sortant de la machine, T-shirt immaculé sous une chemise à gros carreaux, façon apprenti bûcheron du Kentucky – respire la joie de vivre. Sa silhouette est fluette, sa moustache et sa courte barbiche bien taillées, il a les cheveux propres, l’œil qui pétille : un gendre idéal. On lui donnerait 24 ans, il en a vingt de plus. Il s’appelle John Christopher Depp, dit Johnny, et il rayonne à la conférence de presse donnée pour la sortie anglaise de la comédie musicale gothique Sweeney Todd.
Ce matin-là, l’apparence de la star – paisible, souriante, disposée à signer quelques dizaines d’autographes pendant les courtes minutes de son apparition publique – contraste avec sa récente prestation filmique. Dans la sanglante comédie musicale de Stephen Sondheim que Tim Burton a portée à l’écran, il a les traits las, et presque lourds, d’un homme accomplissant comme malgré lui la plus violente des vengeances : barbier londonien, il rase ses clients en profondeur, gorge et trachée comprises. Le sang gicle, mais son visage n’exprime ni dégoût, ni satiété. Presque un automate de l’horreur et de la destruction.
Tim Burton, qui a dirigé Johnny Depp à six reprises, se souvient avec délice d’un moment précis du tournage : la scène où Sweeney Todd, le barbier, retrouve après tant d’années ses instruments (de travail et bientôt de mort), ses « amis », comme il le chante dans My friends. « J’ai regardé Johnny en train de chanter ce qui est littéralement une déclaration d’amour à des rasoirs, et j’ai pensé qu’on n’était jamais allés aussi loin, lui et moi, dans la folie. » L’avenir proche dira quels types de récompenses inédites – l’oscar suivra-t-il le Golden Globe ? – le rôle de Sweeney Todd vaudra à Johnny Depp. Mais celui-ci est à ce jour l’apothéose d’une carrière singulière, celle d’un bad boy devenu acteur « le plus rentable de 2007 » (dixit les statisticiens de Hollywood), d’une superstar hyperdiscrète qui plaît aux ados, aux bobos et aux intellos, d’un sex-symbol formant avec Vanessa Paradis le plus vertueux des couples people.
Au crépuscule des années 80, personne n’aurait misé 1 dollar sur la longévité de la vedette proprette de 21 Jump Street, dispensable série pour teen-agers. Le jeune homme présente alors le pedigree classique de l’arrogante classe biberon hollywoodienne : il a déjà touché au sexe (à 13 ans), aux drogues (à 14 ans) et au rock’n’roll (il gratte la guitare du groupe The Kids, qui jouera quelquefois en première partie d’Iggy Pop). Il est venu au cinéma par hasard. Il est mignon, on lit sur son visage les traces de son ascendance cherokee ; il est aussi un peu fade et on redoute que sa séduction soit éphémère.
Tim Burton change son destin. Le cinéaste se rappelle – toujours avec précision – leur première rencontre, fin 1989, « dans un coffee shop d’un hôtel de Los Angeles ». Auréolé du succès de Batman, Burton a les mains libres : il s’apprête à tournerEdward aux mains d’argent et cherche son acteur principal. Il a rencontré Tom Cruise, par politesse. Depp se présente à lui sans illusions, sachant que son statut de vedette télé le handicape : il déteste la série, s’y sent prisonnier « comme un steak dans un hamburger ».
La rencontre est quasi silencieuse : deux grands timides à la tignasse en bataille qui se toisent. « Je l’avais à peine vu jouer, raconte Burton, je le connaissais surtout par les magazines pour ados ! Mais j’ai tout de suite su qu’il était parfait pour le rôle. Parce qu’il n’était pas du tout le personnage lisse qu’on décrivait partout. Exactement comme le héros d'Edward aux mains d’argent, victime des fausses idées qu’on se fait de lui. Il y avait un drôle d’effet miroir entre l’acteur et le personnage. » Sa prestation dans le film lui vaudra une nomination aux Golden Globes, et lance une carrière qu’il veut atypique.
Le grand jeu, au début des années 90, est de comptabiliser toutes les superproductions (de Speed à Entretien avec un vampire ) que Depp a refusées… C’est l’époque des quatre cents coups. Ses liaisons – avec l’actrice Winona Ryder ou la mannequin Kate Moss – sont la cible des paparazzi. Plus tard, son amitié virile avec l’écrivain-journaliste Hunter S. Thompson (qu’il interprète dans Las Vegas Parano ) comportera des jeux étranges, consistant par exemple à faire exploser des bonbonnes de nitroglycérine au fond du jardin. Et il traînera avec Marlon Brando, le réprouvé – le dirigeant dans son unique réalisation, désarmante de naïveté, The Brave, plongée dans le sous-prolétariat indien et risée du festival de Cannes 1997. Mais entre chaque frasque, il brille sous la direction de Tim Burton, qui l’aide à grandir, à se construire. Après avoir tiré les larmes dans Edward aux mains d’argent(1990), blessant sans le vouloir de ses doigts tranchants, il épate dans Ed Wood(1994) en jouant, avec le sourire, le « plus mauvais cinéaste du monde », qui dirigeait ses films fauchés en jupe et pulls angora. Puis s’amuse en détective rationaliste et froussard dans Sleepy Hollow (1999).
Chaque nouvelle rencontre avec Burton est pour Depp l’occasion de parfaire sa méthode, très personnelle, qui lui servira au gré des quelque quarante films tournés en moins de vingt ans, parfois avec des grands noms (Emir Kusturica, Roman Polanski, Jim Jarmusch, Terry Gilliam). Il s’agit toujours de construire patiemment un personnage à base d’ingrédients disparates, inattendus, de références improbables, puisées dans la culture populaire. Johnny Depp est un caméléon. Edward, l’homme qui a des ciseaux en guise de mains, est inspiré… d’un chien et des quelques animaux domestiques qu’il a eus pendant son enfance. Pour composer Ed Wood, l’acteur se souvient de« l’optimisme de Ronald Reagan, de l’Homme en fer-blanc du Magicien d’Oz et des poupées des ventriloques ».
Sur le tournage du premier Pirates des Caraïbes (2003), l’excentricité qu’il donne au personnage de Jack Sparrow (partiellement inspiré, on le sait, du Rolling Stone Keith Richards) inquiète Disney, qui finance le film : Depp les rassure en allégeant son Sparrow de quelques dents en or. Bingo, le film cartonne, devient série, propulse l’acteur au sommet du box-office. Il est désormais intouchable : quand le même studio s’inquiète de la dégaine de Willy Wonka, milliardaire dingo, dans Charlie et la chocolaterie (2005), de Burton, croyant voir à l’écran un clone de Michael Jackson (et les rumeurs de pédophilie qui vont avec), Johnny Depp répond juste qu’il a bâti le rôle d’après son ami Marilyn Manson… Un rockeur sataniste dans un film pour enfants ? Ça passe !
« Avec le visage qu’il a, Johnny pourrait se contenter d’aligner les rôles de jeune premier, souffle Timothy Spall, l’acteur fétiche de Mike Leigh, son partenaire dansSweeney Todd. Mais il aime trop jouer : c’est un immense acteur de composition. » Tim Burton confirme : « character actor », comme on dit en anglais. « Des tas de stars bâtissent leur carrière en jouant le même rôle. Si vous aimez Clint Eastwood, vous aimez le voir en Clint Eastwood. Il ne mettra jamais un faux nez et des habits extravagants. Johnny, lui, aime explorer sans cesse de nouveaux territoires. PourSweeney Todd, on a beaucoup parlé de Peter Lorre, de Boris Karloff, des stars horrifiques des années 30, qui savent exprimer la souffrance et la douleur d’un simple regard. Et aussi de Humphrey Bogart dans Le Retour du Dr X, son seul film d’horreur. »
Amis dans la vie, le cinéaste et l’acteur s’échangent des DVD, qu’ils commentent à chaque retrouvaille… Mais confier son éducation cinéphilique à Tim Burton, c’est évidemment se laisser emmener vers l’étrange. Au chapitre des influences récentes, l’acteur cite volontiers une rareté, The Penalty, film muet de Wallace Worsley, où le versatile acteur Lon Chaney joue un paralytique, s’obligeant à traîner ses jambes mortes comme si elles pesaient des tonnes. « La référence au cinéma muet n’est pas innocente, commente Burton. Vous devez imaginer ce qu’était le plateau de Sweeney Todd, où la musique résonnait en permanence : on se serait cru au temps du muet… Johnny était parfait. J’ai failli faire le film il y a dix ans, et je ne pense pas qu’à l’époque il aurait été assez mûr pour le rôle. Il faut avoir vécu pour pouvoir rendre toute la noirceur du personnage. » La noirceur passe aussi dans le drôle de chant murmuré qu’a choisi l’acteur : presque une voix d’outre-tombe, une voix sans souffle, écrasée par le fatum, très singulière dans une comédie musicale…
La question est de savoir où, au-delà de l’imitation des maîtres, Johnny Depp puise-t-il ce singulier et effrayant sens tragique ? A fortiori à l’heure où sa vie rangée – partagée entre sa villa du Plan-de-la-Tour, dans le Var, et sa maison de Los Angeles, qui appartint jadis à Bela Lugosi – relègue loin derrière les excès d’antan. Dans ses rares interviews, sa seule ambition semble se limiter à « être un bon père » pour les deux enfants qu’il a eus avec Vanessa Paradis, Lily Rose et Jack. Ce jour-là, à Londres, il est à deux pas, on pourrait, on voudrait en savoir plus, et lui parler aussi de son prochain film, Public Enemies, de Michael Mann, où il jouera le dangereux gangster Dillinger. Mais, pris par une promo minutée, le beau jeune homme est déjà ailleurs, enfui, volatilisé. Le propre d’un acteur de composition : les rôles extravagants qu’il s’amuse à inventer sont toujours plus intéressants que l’histrion qu’ils recouvrent. Seul le masque compte. Le reste n’est que mystère. Ou normalité.
TÉLÉRAMA






















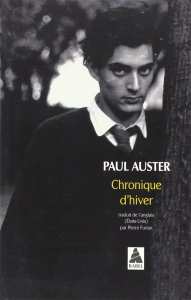 C’est pourtant bien de Paul Auster qu’il est question dans ce journal d’hiver, variation musicale sur des expériences physiques, des sensations : la découverte de la sexualité, les bras cassés, bosses et bleus, le plaisir et la douleur, le deuil impossible de la mère, ses vertiges, ses déchirures de la cornée. Il faut dire le corps pour se dire, parce que ce corps n’a de cesse de le trahir : c’est Auster adolescent qui ne parvient à assouvir sa soif sexuelle qu’en « battant le record nord-américain de masturbation », Auster et sa mère, Auster et sa femme (l’écrivain Siri Hustvedt), Auster, 64 ans au moment de la rédaction de cette Chronique d’hiver, qui veut « parler tout de suite avant qu’il ne soit pas trop tard » — « il ne reste plus beaucoup de temps finalement ».
C’est pourtant bien de Paul Auster qu’il est question dans ce journal d’hiver, variation musicale sur des expériences physiques, des sensations : la découverte de la sexualité, les bras cassés, bosses et bleus, le plaisir et la douleur, le deuil impossible de la mère, ses vertiges, ses déchirures de la cornée. Il faut dire le corps pour se dire, parce que ce corps n’a de cesse de le trahir : c’est Auster adolescent qui ne parvient à assouvir sa soif sexuelle qu’en « battant le record nord-américain de masturbation », Auster et sa mère, Auster et sa femme (l’écrivain Siri Hustvedt), Auster, 64 ans au moment de la rédaction de cette Chronique d’hiver, qui veut « parler tout de suite avant qu’il ne soit pas trop tard » — « il ne reste plus beaucoup de temps finalement ».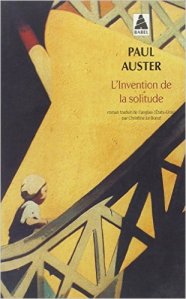 L’hiver, dans cette chronique, est saison mentale et, sans doute, crépuscule d’une vie. Mais il n’y a aucune volonté de saisir la logique d’une existence, chez Auster, de renoncer au fragment pour tenter de circonscrire et donner sens. Le moi est ici puzzle et mosaïque, avec quelques moments fondateurs, repris de livres en livres. Ainsi la mort du père, la blessure terrible du rapport au père, largement exposée dans L’Invention de la solitude et concentrée en une phrase dans la Chronique : « Il ne fait aucun doute que tu es un individu imparfait et blessé, un homme qui porte en lui une blessure depuis le tout début. » « Il ne fait aucun doute » en effet pour qui a lu Auster et entend l’intertexte, mais aucune explicitation n’est donnée aux autres lecteurs quant à cette douleur essentielle de n’avoir pu prouver au père, mort avant les premiers succès, que l’écriture était une voie possible, la douleur de toujours écrire face à ce mur de silence et de mystère.
L’hiver, dans cette chronique, est saison mentale et, sans doute, crépuscule d’une vie. Mais il n’y a aucune volonté de saisir la logique d’une existence, chez Auster, de renoncer au fragment pour tenter de circonscrire et donner sens. Le moi est ici puzzle et mosaïque, avec quelques moments fondateurs, repris de livres en livres. Ainsi la mort du père, la blessure terrible du rapport au père, largement exposée dans L’Invention de la solitude et concentrée en une phrase dans la Chronique : « Il ne fait aucun doute que tu es un individu imparfait et blessé, un homme qui porte en lui une blessure depuis le tout début. » « Il ne fait aucun doute » en effet pour qui a lu Auster et entend l’intertexte, mais aucune explicitation n’est donnée aux autres lecteurs quant à cette douleur essentielle de n’avoir pu prouver au père, mort avant les premiers succès, que l’écriture était une voie possible, la douleur de toujours écrire face à ce mur de silence et de mystère. Excursions dans la zone intérieure est le second volet de cette exploration, cette fois mentale. Même « tu » en adresse constante à soi comme à un je devenu autre ou à ce tu du lecteur, semblable et frère (« tu estimes être comme n’importe qui et comme tout le monde »). Même poétique du fragment qui compose certes la fresque d’une vie mais sans en réduire les lignes de faille, contradictions ou pertes de sens. Du corps à l’esprit, en quelque sorte, du temps à l’espace, se forme un itinéraire double et parallèle que le lecteur pourra reconstituer d’un volume à l’autre, mais sans certitudes, sans vérités assénées. Davantage un hologramme qu’une image fixe, des essais plus qu’une confession fermée.
Excursions dans la zone intérieure est le second volet de cette exploration, cette fois mentale. Même « tu » en adresse constante à soi comme à un je devenu autre ou à ce tu du lecteur, semblable et frère (« tu estimes être comme n’importe qui et comme tout le monde »). Même poétique du fragment qui compose certes la fresque d’une vie mais sans en réduire les lignes de faille, contradictions ou pertes de sens. Du corps à l’esprit, en quelque sorte, du temps à l’espace, se forme un itinéraire double et parallèle que le lecteur pourra reconstituer d’un volume à l’autre, mais sans certitudes, sans vérités assénées. Davantage un hologramme qu’une image fixe, des essais plus qu’une confession fermée.
