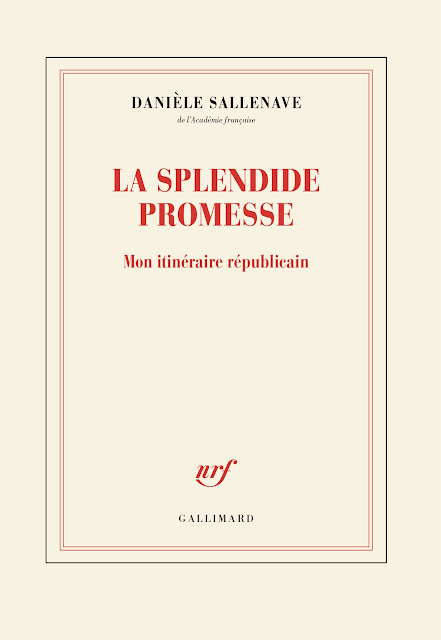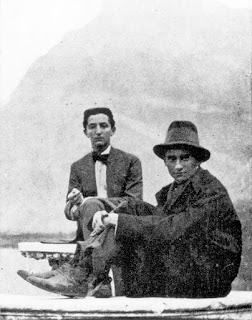La république et l’une de ses filles
par Claude Grimal30 avril 2025
Numéro 220
Danièle Sallenave poursuit dans La splendide promesse. Mon itinéraire républicain la réflexion sur la république qui lui est familière et qu’elle avait dernièrement entreprise de manière plus délibérée dans L’églantine et le muguet (2018) et Rue de la Justice (2020).
Danièle Sallenave | La splendide promesse. Mon itinéraire républicain. Gallimard, 528 p., 24 €
Reprise et prolongée ici, elle parcourt cette fois environ quatre-vingts années d’histoire française et internationale, soit celles qui coïncident avec l’existence de Sallenave, lui permettant d’évaluer la persistance, l’aménagement ou la trahison d’un idéal qui lui fut inculqué dans son enfance. Le récit est donc politique et personnel, les deux domaines coïncidant puisque l’auteure est une « enfant de la République » et un produit de sa méritocratie (fille d’instituteurs, professeur d’université, académicienne).
La splendide promesse ne parle cependant pas de la vie intime de l’auteure mais de sa vie intellectuelle, idéologique et morale telle qu’elle s’est déroulée au fil de grands événements : guerre d’Algérie, Mai 68, chute du mur de Berlin, accords d’Oslo, guerre de Gaza, etc. Telle aussi qu’elle s’est enrichie par les voyages puisque, jeune ou moins jeune, elle s’est beaucoup rendue à l’étranger (Maroc, Russie, Tchécoslovaquie, Inde, Chine…). En parallèle, elle décrit une vie littéraire remplie de lectures (Hugo, Apollinaire, Neruda, Aragon), de spectacles (le théâtre découvert grâce au TNP de Jean Vilar) ainsi que de rencontres avec d’importantes figures du monde artistique (Aragon, Lanzmann, Kundera).
Ainsi, dans son aspect politique, l’histoire de La splendide promesse est celle d’une conscience française, la nôtre ou celle de nos parents ou grands-parents (même si nos opinions politiques ou les leurs étaient autres). Grâce à son évocation d’expériences qui sont aussi les nôtres, ce livre nous touche et nous intéresse, même si son écriture convenue et son expression souvent plate des affects et de la pensée lassent parfois. Dommage que, pour revisiter l’idéal républicain, Danièle Sallenave n’ait pas souhaité se coiffer stylistiquement un instant du bonnet rouge de son auteur favori !
Quoi qu’il en soit, bien des lecteurs se reconnaitront dans l’enthousiasme de cette jeunesse républicaine dotée d’idéaux que décrit Sallenave, comme dans son désarroi adulte devant la confrontation de ceux-ci avec les réalités successives du XXe et du XXIe siècle. Ils partageront sûrement la préoccupation de Sallenave pour l’école, question souvent abordée par le livre. Ils se retrouveront aussi dans ses dernières culpabilités (en dehors ou non de tout sentiment républicain), le sort actuel de Gaza, car, nous dit-elle, « [i]l y a dans chaque siècle une catastrophe sociale politique, humaine qui le condamne. Pour notre siècle ce sera « Gaza 2024 » ». Et, hélas, nous pouvons l’ajouter, « Gaza 2025 ».
Au fil des pages, pourtant, il y a eu d’autres désastres, et beaucoup de désillusions. Oui, Sallenave a souvent pu se sentir trahie ; comme lors de la longue et difficile décolonisation pour laquelle une partie de la gauche traînait des pieds. Oui, elle-même s’est parfois trompée. Ainsi, à propos de sa collaboration avec un magazine conservateur, elle avoue : « Politiquement, idéologiquement, ce n’était pas ma meilleure période. Je me suis objectivement rapprochée de la pensée libérale, où l’idée des libertés l’emporte sur celle de liberté, et qui manifeste sa défiance envers la notion d’égalité… Pourtant… cette tradition n’est pas la mienne, ce n’est pas ma « famille » [laquelle est] la gauche ». Oui, sa propre vision de la liberté, de l’égalité et de la fraternité a eu ses angles morts, comme celle de tout un chacun, car il est compliqué de sentir et de penser des injustices qu’on ne nous a pas désignées et dont nous n’avons pas fait nous-mêmes l’expérience ; celles qui visent les minorités, les migrants…
Mais plus généralement, aujourd’hui, comme il est difficile d’être de gauche, rappelle Sallenave, par moments découragée ! « Alors tout ça pour ça. Nous avons changé le monde. Un monde nouveau est né où rien ou presque rien ne ressemble à celui où l’on vit s’installer en France l’idée républicaine, rien non plus à celui qu’on avait imaginé de construire selon ses valeurs ». Mais même le découragement est chez elle passager, et elle continue d’identifier les problèmes et les dangers à combattre : « J’erre. Je tâtonne. », avoue-t-elle. « L’extrême droite est à nos portes. Je puise à plusieurs sources. » Lire La splendide promesse, c’est justement, pour nous, puiser à une bonne source.