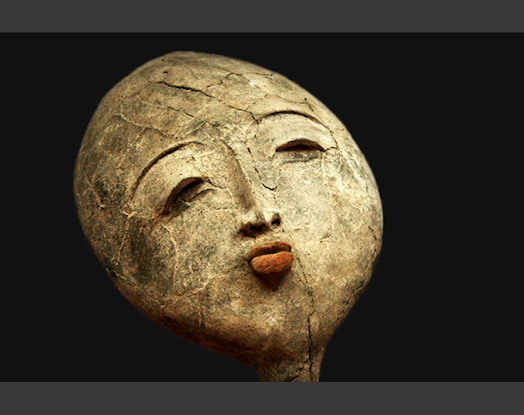|
| Michael Madsen |
Tous les témoignages de ceux qui l’ont connu dépeignent Michael Madsen en homme tendre et affectueux, fidèle en amitié, et généreux sans avoir besoin de le montrer. Ça c‘est pour la vie privée. Car à l’écran, c’était tout autre chose : un acteur brut, éruptif, qui s‘était spécialisé dans les rôles de durs. C’est en 1992, dans le premier long métrage d’un certain Quentin Tarantino, qu’il laisse un souvenir impérissable. Dans Reservoir Dogs, Madsen incarne Mr. Blonde, tueur sans foi ni loi, un méchant au sang-froid tellement malaisant qu’il hante encore les cauchemars des spectateurs.
Avant cela, il avait fait ses armes dans des seconds rôles : c’était notamment un ami alcoolique de Jim Morrison dans The Doors d’Oliver Stone. Il jouait un musicien amoureux de Susan Sarandon dans Thelma et Louise, sans oublier ses apparitions, toujours inquiétantes, dans des séries cultes de l’époque comme Miami Vice ou Code Quantum. Mais, sa carrière a basculé avec ce polar à petit budget, où un gang de braqueurs aux noms de couleurs se déchire après un coup qui tourne mal. Dans cet impossible chaos, la figure de Mr. Blonde se distingue parmi toutes.
Une scène culte ? Évidemment celle de l’oreille coupée. Mr. Blonde a ligoté un flic (incarné par Kirk Baltz) et le torture pendant qu’à la radio passe Stuck In The Middle With You, une chanson pop entêtante et gentillette qui contraste cruellement avec le déchaînement de violence à l’œuvre. Mais l’horreur se teinte d‘humour sadique. Mr. Blonde fait quelques pas de danse, rasoir à la main, avant de trancher l’oreille de sa victime. Puis, avec un sourire aux lèvres, il parle dans l’oreille comme dans un micro : « Allô, il y a quelqu’un ? »
À l’écran, c’est insoutenable. Même la caméra est obligée de tourner le regard. Quentin Tarantino, dans une interview donnée à l’époque, disait vouloir qu’on « ressente la douleur ». Mission accomplie. Mais, au-delà de la violence, ce qui glace le sang, c’est le plaisir sadique que Michael Madsen semble éprouver. Il confiera plus tard avoir improvisé cette danse, sur une simple indication du scénario : « Mr. Blonde danse de manière maniaque. » « Je me souviens m’être dit : “ Mais qu’est-ce que je vais pouvoir foutre de ça ?” Quentin m’a fait confiance pour trouver sur le moment. »
Michael Madsen a décidé d’y aller tout en douceur. Un petit pas de danse, un petit déhanchement, avant de sauter sur le policier ligoté.
Le personnage devient instantanément culte. Madsen, dès lors, portera toujours avec lui cette aura d’homme instable et violent. Tarantino l’invitera dans plusieurs de ses films : Kill Bill (1 et 2), Les huit salopards, Once Upon a Time… in Hollywood. À chaque fois, l’acteur injecte sa touche : une fragilité toujours à double sens, un charisme à l’ancienne, quelque part entre James Dean et Charles Bukowski.
Mais derrière la gueule de gâchette solitaire, il y avait un père – qui a eu six enfants – et un homme d’une grande sensibilité. Lors du tournage de Reservoir Dogs, son premier fils était encore bébé. Quand le flic supplie son bourreau de lui laisser la vie sauve en disant avoir un enfant en bas âge, la réplique l’émeut bien plus qu’il ne veut le montrer.
Des années plus tard, de festivals en projections, les fans ne lui parlent toujours que de Mr. Blonde. « Je m’imagine à 80 ans, avec quelqu’un qui me demande pour la millième fois de refaire la danse, souriait-il en 2017. Ce rôle me suit partout. »
Il restera, dans la mémoire du cinéma, cet ange noir à la voix rauque, qui a su mettre un peu de danse dans sa cruauté.
VANITY FAIR