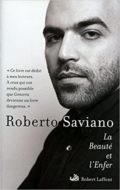Un pays dirigé par un âne et Kafka
Peu avant le second tour, sur Twitter, j’ai lu ceci : « Je voterais pour un âne si c’était le seul moyen de ne pas subir Macron cinq ans de plus. » Tiens, me suis-je dit, en voilà un qui se prend pour Sancho. Du moins, au début des aventures de Don Quichotte, quand l’expérience et l’amitié n’ont encore transformé ni l’un ni l’autre. Après l’épisode des moulins à vent, Sancho voterait pour son âne, si c’était le seul moyen d’éviter à Don Quichotte la suite de ses folies (lesquelles consistent, Le Pen n’aurait pas dit mieux, à trouver « les offenses à réparer, les torts à redresser, les injustices à corriger, les abus à réformer et les dettes à satisfaire »). Cependant, celui qui a écrit ce tweet n’est pas un brave laboureur « avec fort peu de plomb dans la cervelle », qui abandonne femme et enfants pour suivre le chevalier errant. C’est un professeur de philosophie. A-t-il de longues oreilles ? Je n’en sais rien. Mais cela me conduit à une question : que serait un pays dirigé par un âne ?

Cette question ne rejoint pas la dystopie de ce numéro de Charlie, mais j’avoue avoir très peu d’imagination quand il s’agit de prévoir le pire, peut-être parce que je l’ai vécu. Un pays dirigé par un âne plutôt que par Le Pen, à défaut de Macron, voilà qui convient, sinon à mon rêve, du moins à ma fantaisie. Les ânes sont injustement décriés. Don Quichotte commence par faire la grimace face à celui de Sancho, se demandant s’il « se souvenait que quelque chevalier errant eût emmené avec lui un écuyer monté sur un âne ; mais aucun ne lui revint en mémoire. Néanmoins, il décida qu’il le prendrait avec lui, avec l’intention de pourvoir son écuyer d’une plus honorable monture, dès que l’occasion se présenterait, en ôtant son cheval au premier chevalier discourtois qu’il rencontrerait ». Don Quichotte a promis à Sancho le gouvernement d’une île, les promesses inconsidérées sont choses fréquentes en politique. Sancho va donc « sur son âne, comme un patriarche, avec son bissac et sa gourde, et avec grand désir d’être déjà gouverneur de l’île que son maître lui avait promise ». Il l’obtiendra tel un gouverneur de comédie, mais, en politique, rien n’a presque jamais lieu comme on l’imaginait, et il arrive que l’habit finisse par faire le moine : Sancho se montrera excellent dans l’art de gouverner ; excellent, parce que juste. Sans doute est-il conseillé par son âne.
L’âne est fidèle, têtu et endurant, habitué à porter des fardeaux, à subir des coups. De ces humiliations, de toute cette vilenie humaine, il sait tirer avantage en résistance, noblesse et sympathie. Un pays dirigé par un âne serait du côté des humiliés. L’animal trouverait comment améliorer leur sort sans leur vendre sans cesse du ressentiment, de la colère et des lendemains qui chantent. Il les accompagnerait en silence, avec efficacité, comme un miroir qui a vécu, sur un chemin difficile. Quant à ceux qui le maltraitaient ou l’ignoraient, quant à tous ces maîtres, il en ferait des laboureurs et des écuyers, avec interdiction de frapper ou de surcharger leurs ânes. Bref, il leur apprendrait la patience et l’humilité.
Mon âne préféré, c’est Platero. Platero et moi a été écrit par l’Espagnol Juan Ramón Jiménez entre 1906 et 1914. C’est un classique de la littérature enfantine ; autrement dit, un classique de la littérature tout court. Vingt ans après la publication, l’auteur justifiait son goût pour l’animal qu’il avait créé :
« Je continue à te préférer, Platero, pour chaque jour qui passe, à n’importe quel autre ami. Je te préfère comme un enfant. Parce que toi, tel que tu es, comme un enfant, comme un chien aussi, et comme mon cheval Almirante, tu me tiens compagnie sans m’enlever la solitude, et, à l’inverse, me révèle ma solitude sans m’enlever la compagnie. Je peux tout te raconter, dans l’enthousiasme ou dans la peine, Platero, et tout cela te paraît bien. Et toi, en revanche, bon comme tu l’es, jamais tu ne m’interromps, tu n’en as pas besoin, tu sais te faire valoir par toi-même. Tu ne me dis même pas que je suis ridicule ou égoïste, même quand tu le penses ; tu me tais en te taisant, par sérieux ou par distraction. Comme tu es supérieur à moi et à tous, Platero ! C’est pourquoi nous pouvons être aussi bons amis. Je n’aimerais pas avoir des amis qui soient pires que moi. »
Juan Ramón Jiménez a quitté l’Espagne en 1936. Le franquisme ayant gagné, il n’y est jamais retourné. •