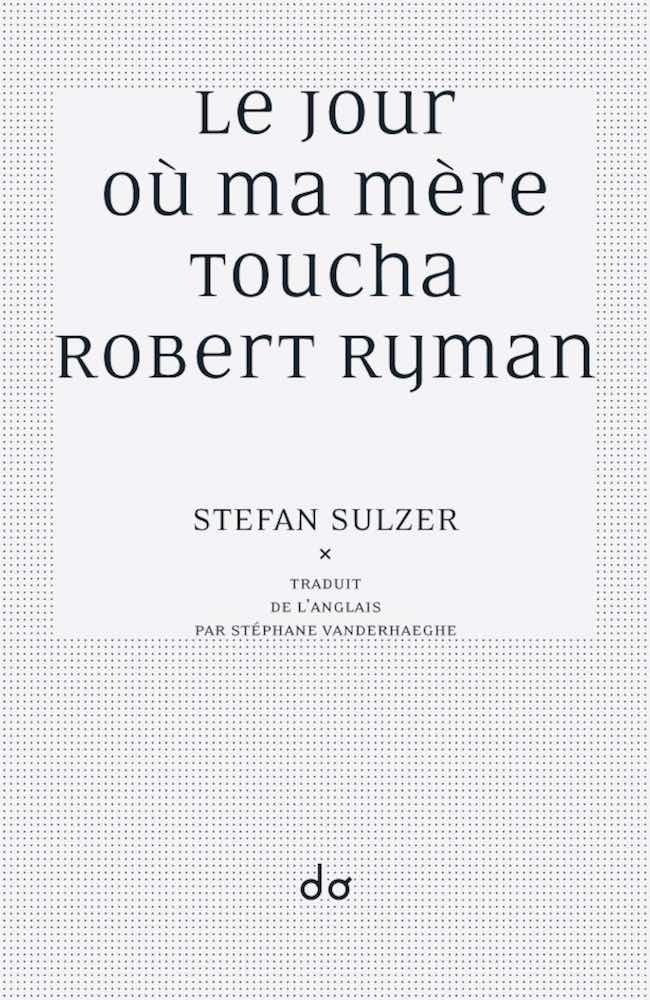
L’expérience
Ryman
par Steven Sampson28 juillet 2021
Comment appréhender les tableaux blancs de l’artiste américain Robert Ryman (1930-2019) ? Chaque mot écrit à leur propos empiète sur la blancheur. Les décrire, est-ce une démarche antinomique, voire un sacrilège ?
Avant de nous mettre à rédiger cet article, il nous a fallu passer une nuit blanche. Ryman intimide par son silence : réduisant tout à l’essentiel, il donne le ton, il établit une sonorité insupportable, comme ces voix qui font éclater du verre. C’est dans la vitrine de la librairie du Centre culturel suisse, rue des Francs-Bourgeois à Paris, qu’on a pu trouver un texte à la hauteur : Le jour où ma mère toucha Robert Ryman, de Stefan Sulzer, traduit de l’anglais par Stéphane Vanderhaeghe (éditions do, 2020). Quelle ironie que son auteur soit suisse, citoyen d’un pays réputé pour sa neutralité ! Et que la traduction française soit publiée par une maison d’édition dont le nom semble aussi ambitionner une sorte d’effacement, écrit en lettres minuscules : « do », deux petits signes, dont la signification en anglais est essentielle – « faire ».
Parce que Ryman aspire à une autre forme de neutralité, chromatique celle-ci. « Just do it », slogan de Nike, pourrait résumer sa démarche : il n’est pas dans la réflexion, il fait. En cela, il reflète son époque, tout en s’en démarquant par sa volonté de pousser ce credo à son paroxysme. Y a-t-il une véritable différence entre les initiés aptes à saisir son œuvre et ceux condamnés à passer à côté ? Un tableau de Ryman doit-il être touché ou vu ?

« Robert Ryman: Large-Small, Thick-Thin, Light Reflecting, Light Aborbing 23 » © CC/Paul Keller
Stefan Sulzer, lui, a pris parti : son livre tranchant postule une opposition entre les éclairés – dont le lecteur qu’il éduque – et les abrutis. Parmi ces derniers, la mère de l’auteur, candidate idéale pour porter le chapeau philistin. C’est elle qu’il envoie à la rencontre de Ryman, dès l’incipit : « Par une fraîche matinée d’automne, une femme pénétra dans la Dia Art Foundation de Beacon, une petite ville située sur les rives de l’Hudson, à environ une heure et demie au nord de New York. »
La pauvre ! Elle ne pigera rien dans ce musée, et, pire encore, son fils n’arrêtera pas de la narguer, l’exposant à une lumière aveuglante : la phrase citée ci-dessus est la seule à paraître sur la première page, le feuillet de droite, qu’on aurait désigné comme « impair » si les feuillets avaient été numérotés. Ceux de gauche, les « pairs », resteront purs. Ces binômes absence/présence seront souvent séparés les uns des autres par une paire de pages blanches. Et jamais plus d’une phrase par feuillet, pour illustrer le propos de Mallarmé selon lequel la blancheur de la page agit tel un vide, pour former un contraste apaisant avec « l’intensité signifiée par la noirceur des lettres imprimées ».
C’est dire la solitude maternelle, dans cet espace ouvert, dévoilée tel un tableau de Ryman. Elle rappelle l’exemple d’une autre femme : « Contrairement à cette Française qui lors de l’exposition Ryman au Guggenheim en 1972 avait emboîté le pas à John Canaday, critique d’art au New York Times, cette femme ne tourna pas les talons pour s’écrier : « Mais, c’est vide ! » »
Une mère peut-elle admettre ce néant ? Enfanter, n’est-ce pas attaquer la pureté ? Hélas, face à ces tableaux, on doit laisser de côté la psychanalyse : Sulzer, comme Ryman, résiste aux interprétations, il propose une baignade dans la blancheur, où l’on enterre la réflexion pour vivre l’instant. Comme c’est reposant !
Ou pas. La mère ne trouve pas ses repères : « Elle poursuivit sa visite de la galerie, confrontée à ce qu’elle pensa être des surfaces vierges. » L’impact de l’exposition la déstabilise : « Elle ressentait la violence déconcertante de la pureté. » La visiteuse considère ces tableaux comme dépourvus de caractère et de vie. Privée de la pédagogie de son fils, elle ne se rend pas compte que le blanc « fonctionne non comme signifiant, mais comme une des conditions mêmes de visibilité ».
On jouit d’une visibilité parfaite, d’une virginité remplie, d’une absence pleinement assumée, la blancheur constitue une image en soi. C’est-à-dire que, par la suppression du référentiel, le peintre s’échappe du réel illusoire de notre époque, de la tyrannie du virtuel, pour imposer la seule véritable réalité, instantanée : « Ce qui s’y passe, s’y passe réellement. » À bas l’Histoire, oublions l’avenir, tout est dans l’imminence ! C’est pour cela que l’œuvre de Ryman répond à une règle stricte : « Ce qui importe est ce qui est présent sur la toile, et ce qui vient avant ou après n’importe que dans la mesure où cela aussi réclame notre seule attention. »
Est-il possible d’être aussi attentif ? Faut-il d’abord se débarrasser du langage, ainsi que de la pensée, pour reconnaître « l’autonomie essentielle de la peinture face à ce qu’on peut en dire » ? À quoi bon alors ce livre et cet article ? L’écrivain devrait-il faire comme Ryman et inverser les conditions de la création, pour suivre le sillage de Henry Miller, qui déclara dans son premier roman : « Ce n’est pas un livre. C’est un libelle, c’est de la diffamation, de la calomnie […] C’est une insulte démesurée, un crachat à la face de l’Art ».
L’œuvre de Ryman représente-t-elle un « crachat » ou plutôt l’aboutissement d’une tradition ? Serait-elle insondable si on n’a pas accès à « la totalité des décisions ayant constitué, depuis qu’il existe, le métier de l’artiste » ? Au lieu de se cultiver, l’observateur avisé ferait mieux de travailler son aptitude au plaisir. C’est ce qui a manqué à la mère, à cause de son penchant pour des « filtres intellectuels ». Ryman abhorre la réflexion, c’est le meilleur moyen de ne rien voir. Dommage que cette dame n’ait pas su contempler paisiblement les toiles blanches, qu’elle ait ressenti le besoin de « spéculer », devenant ainsi son propre miroir. Si seulement elle avait pu accorder plus de confiance à ses sens !
Le toucher fonctionne-t-il mieux que la vue ? La dame tend sa main vers le mur : « Lentement et avec la plus grande concentration elle promena la main de haut en bas sur le tableau, de son bord supérieur à sa bordure inférieure. » Ses doigts ont-ils effleuré une vérité ? La surface poreuse de la peinture lui érafle l’intérieur de la main. Elle reste perturbée, refusant de « subir à nouveau l’affront, à la fois rude et direct, à l’origine du trouble qu’elle ressentait depuis son entrée dans le bâtiment ».
Comme on a du mal avec le plaisir ! On n’arrive même pas à l’écrire. À ce propos, Sulzer cite Roland Barthes : « À sa mort, Roland Barthes avait laissé sur sa machine à écrire un texte inachevé portant le titre « On échoue toujours à parler de ce qu’on aime » ».
Le blanc serait-il la quintessence d’un non-dit, celui de l’amour ?


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire