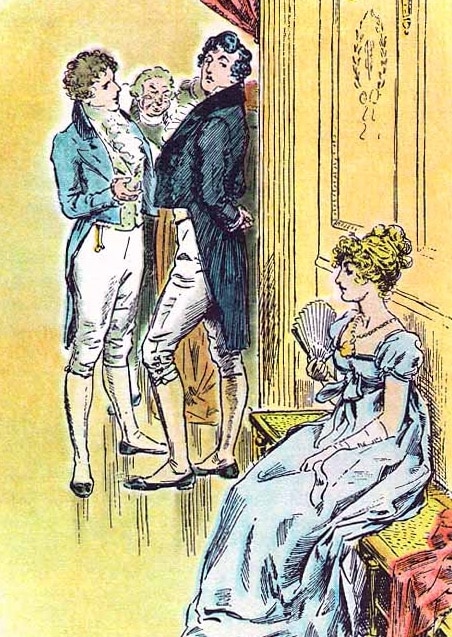
L’infini succès de Jane Austen : entretien avec François Laroque
Alors que le monde entier célèbre les 250 ans de Jane Austen en grande pompe, il semble utile de mieux connaître le parcours d’une romancière aussi adulée, de comprendre les raisons de son succès absolu et d’une popularité qui pourrait surprendre. Quelques éléments de réponses avec François Laroque qui traduit ses romans et qui, après un formidable Dictionnaire amoureux de Shakespeare, lui consacre un volume à paraître au printemps.
Jane Austen aurait, en ce mois de décembre 2025, 250 ans. Si le temps présent apprécie un peu démesurément les anniversaires, celui-ci prend une ampleur assez étonnante. C’est une sorte de folie éditoriale et commerciale.
Première femme après la reine à figurer sur un billet de banque – au dos des coupure de dix livres sterling –, Jane Austen a publié ses six grands romans dans l’anonymat en les signant de la simple mention de « by a lady ». Son identité ne sera révélée qu’après sa mort, en 1817, dans le texte que son frère Henry écrivit en guise de préface aux quatre volumes réunis dans un même coffret, ceux de son premier et de son dernier roman, L’abbaye de Northanger et Persuasion. Après une période de relatif oubli, plusieurs écrivains, et non des moindres, ont tenu à la qualifier de « Shakespeare de la prose ». Malgré tout, les malentendus n’ont pas manqué. Car les moins clairvoyants ont pu voir en elle une simple pourvoyeuse d’intrigues sentimentales et désuètes dans des romans où le mariage est le principal enjeu, où les invitations à dîner obéissent à une étiquette bien précise et à des règles de préséance et où, dans les bals, les jeunes filles qui font leurs débuts dans le monde se voient dûment chaperonnées et doivent cultiver l’art de la conversation et faire preuve de toutes sortes d’autres talents comme le point d’aiguille, le dessin, le chant et la musique. On ne pourrait être plus loin de la vérité.
Le battage commercial fait autour de son nom à l’occasion des 250 ans de sa naissance est enfin l’occasion de rendre justice en France à celle que Virginia Woolf porte aux nues dans Une chambre à soi. D’une grande liberté de ton par rapport aux codes littéraires de son temps, Jane Austen n’hésite pas, en effet, dans L’abbaye de Northanger, à se moquer des romans gothiques qui faisaient alors fureur. Toute classique qu’elle est, Jane Austen est en réalité une moderne, la seule qui sorte véritablement du lot parmi toutes ces « ladies of the pen », les Fanny Burney, Maria Edgeworth, Charlotte Lennox ou autres Ann Radcliffe, ces romancières à succès, à la fois concurrentes et inspirantes, qui gagnaient de l’argent là où la native de Steventon tirait désespérément le diable par la queue.
A-t-elle toujours connu cette fortune ?
Si vous le permettez, je prendrai ici le mot fortune dans son sens premier. Jane Austen a en effet toute sa vie lutté contre l’impécuniosité, au point que la question de l’argent revient de manière quasi obsessionnelle dans son œuvre. En ce sens, ses romans, que l’on présente parfois comme des contes de fées, sont aussi en partie des contes de fric.
Après une période de traversée du désert, ses romans ont peu à peu conquis le public anglophone, de sorte qu’on ne compte plus désormais les ouvrages qui lui sont consacrés, sans parler des adaptations à l’écran ou des nombreux produits dérivés de l’important tourisme culturel auquel elle a donné naissance.
Son succès en France ressemble-t-il à celui qu’elle connaît outre-Manche ?
Cette provinciale, anglaise jusqu’au bout des ongles, tout en parlant du français comme d’une langue qu’il était alors de bon ton de connaître – elle a probablement lu Les liaisons dangereuses dans l’original – et en recourant à nombre d’expressions françaises dans ses romans, ne peut s’empêcher de décocher quelques fléchettes empoisonnées contre une « Grande Nation » qui, en 1794, avait guillotiné le mari de sa cousine Eliza de Feuillide et que ses deux frères amiraux avaient combattue en mer. Elle se rangera d’ailleurs aux côtés des écrivains dits « anti-Jacobins » qui luttaient contre les idées propagées par la révolution de 1789.
Dans son Journal de 1929, Gide écrit d’elle que « l’on sent assez vite […] qu’elle ne se risquera pas sur des sommets exposés à des vents trop forts » ; Julien Green la déclare intraduisible en français : le pays de Proust et de Colette, sans totalement bouder son succès croissant à l’étranger, aura été plus lent à apprécier ses qualités et sa force. Elle n’entrera dans la sacro-sainte Pléiade qu’avec les deux volumes qui lui ont été consacrés en 2000 et 2013.
Car la réception de Jane Austen en France a toujours été et demeure un paradoxe. Certes, le français a été la première langue dans laquelle ses romans ont été traduits, et cela quelques années seulement après leur parution, et il aura tout de même fallu attendre la fin du XXe siècle pour que paraissent des traductions dans les principales langues européennes. Mais pour ceux qui, à la différence de Gide ou de Julien Green, ne lisaient pas Austen en anglais, ces premières traductions, souvent approximatives, tronquées ou augmentées, ont attiré à ces textes la réputation d’avoir une tonalité « fleur bleue » sur fond de « récits campagnards et féminins ».
Mais plus que l’histoire d’une œuvre et de sa réception, c’est son immense succès qui frappe aujourd’hui. Pourtant, le propos de l’œuvre, son timbre, son style, pourraient sembler bien éloignés du monde contemporain.
Le monde décrit par Jane Austen se situe à des années-lumière du nôtre puisque tout ce qui s’y passe est un peu une tempête dans une tasse de thé. Le monde de la petite gentry qu’elle décrit dans ses moindres détails reste en effet confiné à la vie de quelques familles dans des bourgades tranquilles. En outre, ce qui intéresse cette romancière qui se veut aussi réaliste, c’est l’intériorité des personnages, la petite comédie humaine qui les entoure et les menus détails de leur quotidien qu’elle relate patiemment sur son « morceau d’ivoire ». Elle est ainsi devenue l’une des pionnières du roman psychologique.
Et pourtant, on la lit avec énergie et une sorte d’enthousiasme fervent. Et le lectorat semble étonnamment divers – des hommes, des femmes, des jeunes aussi bien que des plus âgés –, tous semblent goûter des romans du sentiment et qui mettent le langage au centre.
La langue de Jane Austen, pourtant sinueuse et parfois obscure ou elliptique, mais toujours très travaillée, fascine ses fidèles lecteurs et lectrices de tous âges, avec ses pointes acérées et ses fins heureuses qui, au prix de quelques artifices, mais sans en émousser totalement le tranchant, viennent compenser une certaine âpreté de ton. Le style reste minimaliste, avec peu d’images et des descriptions réduites au strict nécessaire dans une esthétique restée fidèle au classicisme de son maître Samuel Johnson. Les dialogues, qui occupent une place de choix dans ses récits, théâtralisent les échanges (un critique va jusqu’à parler de « ventriloquisme dramatique ») et sont souvent d’une grande drôlerie. Le style indirect libre est l’une de ses techniques favorites et Henry James comme Virginia Woolf y puiseront les éléments de leur courant de conscience. L’ironie, la finesse, l’intelligence, le sens de la formule, souvent décapante, qui caractérisent cette délicieuse romancière en réjouissent plus d’un quand ils lisent entre les lignes ces récits à tiroirs pleins de surprises et de renversements.

Le féminisme, la place des écrivaines dans la manière dont on lit aujourd’hui, jouent-ils un rôle dans ce triomphe posthume ?
Le mot de « féminisme » n’existait pas du temps de Jane Austen (selon le dictionnaire, il n’apparaît qu’en 1851) et, dans Trois guinées, Virginia Woolf préconise sa suppression du vocabulaire. Jane Austen n’est pas en effet une écrivaine militante comme a pu l’être Mary Wollstonecraft, autrice d’une Défense des droits de la femme. Ses principaux personnages sont certes souvent des femmes mais, outre que certaines de ses héroïnes, telles Catherine Morland dans L’abbaye de Northanger ou la jeune Fanny dans Mansfield Park, ne sont pas des plus charismatiques, Austen se moque souvent des femmes. On ne compte pas les sottes, les ridicules, les avares ou les odieuses comme l’inénarrable et sidérante Mrs Norris de Mansfield Park. Toutefois, en règle générale, Jane Austen évite de disserter et elle se contente de poser des conditions, de sorte que, derrière l’humour ou la satire, elle montre de façon très efficace à quel point les femmes de son époque se trouvent empêchées.
Le grand nombre d’adaptations au cinéma ou à la télévision – depuis celle d’Ang Lee jusqu’à sa relecture avec des zombies ! – ancre aussi dans nos imaginaires cette œuvre où il ne se passe presque rien.
Le cinéma, la télévision et les séries ont bien évidemment contribué à populariser Jane Austen et, en ce sens, on pourrait presque dire que ses romans sont plus vus que réellement lus. Cela est essentiellement dû à Hollywood et Bollywood qui ont adapté ses romans à l’écran. Grâce à ces réalisations, le succès de Jane Austen est aujourd’hui planétaire.
L’adaptation de Raison et sentiments par Ang Lee, souvent citée en modèle, a été réalisée par un metteur en scène qui a avoué n’avoir jamais lu auparavant une seule ligne de la romancière qu’il jugeait réservée à un public d’adolescentes (girlie books). Esthétiquement parfait et riche de la présence d’acteurs de renom comme Emma Thompson et le regretté Alan Rickman, ce film accumule cependant les clichés avec ses gazons trop verts et un ensemble certes très léché mais sans doute un peu trop « glamour ». À mes yeux, la meilleure adaptation du monde de Jane Austen est celle de la scénariste Laura Piani dans Jane Austen a gâché ma vie, son premier film et son coup de maître.
François Laroque est angliciste, spécialiste de Shakespeare. Il a traduit plusieurs livres de Jane Austen parus au Livre de Poche. Il publiera au printemps un Dictionnaire amoureux de Jane Austen aux éditions Plon.

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire