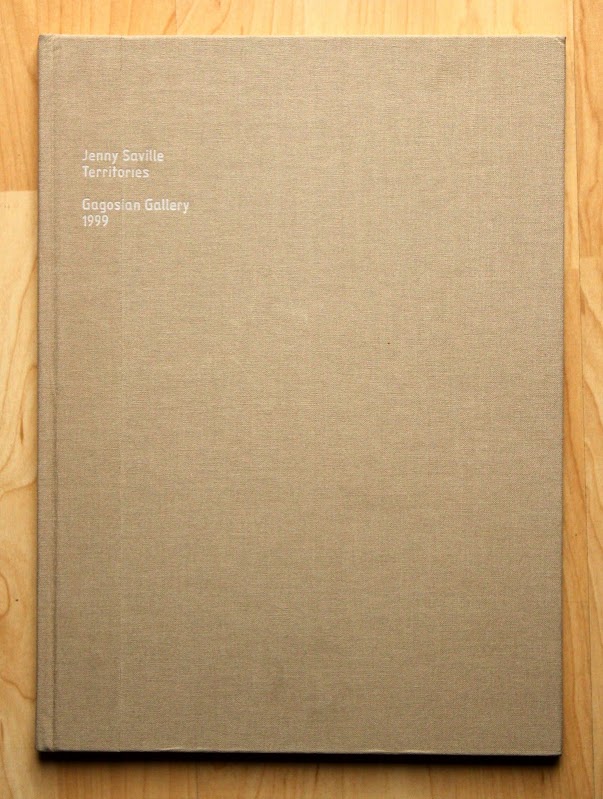Richard Flanagan : “Si je n'avais pas fait ce livre, j'étais mort comme écrivain”
Gilles Heuré
Publié le 16/01/2016. Mis à jour le 18/01/2016 à 10h49.
Dans son nouveau roman, “La Route étroite vers le nord lointain”, l'auteur australien s'inspire de l'expérience de son père dans un camp de prisonniers au Japon pendant la Seconde guerre mondiale.
Romancier réputé, auteur désormais de six romans, dont le dernier, La Route étroite vers le nord lointain, traduit dans quarante pays, a remporté le prestigieux Man Booker Prize en 2014, Richard Flanagan garde son franc parler et n’est pas disposé à se plier à toutes les sollicitations, notamment cinématographiques. Sa satisfaction, c’est que les lecteurs s’emparent de son livre et qu’ils aient des avis différents. Rencontre avec un grand romancier voyageur et définitivement Australien pure souche.
Combien de temps vous a pris l’écriture de ce livre ?
Douze ans. J’ai écrit cinq versions mais je les ai toutes rejetées alors j’ai supprimé les documents de mon ordinateur.
Pour quel motif ces versions ne vous convenaient-elles pas ?
C’était… mauvais. Point barre.
Votre père avait été prisonnier des Japonais, en 1943, et forcé de travailler sur la « Voie ferrée de la Mort », entre la Thaïlande et la Birmanie. Est-ce lui qui vous a raconté tous les détails qu’il y a dans ce livre ?
Il racontait parfois certains moments, mais j’ai inventé toute l’histoire. A chaque fois qu’il racontait une bribe d’histoire, il y avait toujours un côté comique. L’humour est parfois la dernière chose qui reste dans certaines situations, le rire est une arme quand on n’a plus rien, comme c’était son cas quand il était prisonnier dans cet enfer. Mais il ne m’a jamais raconté les détails de sa captivité. Ce qui m’a rendu curieux, et qui m’a aussi façonné en quelque sorte, c’est précisément tout ce qu’il ne m’a pas raconté. Il avait par exemple une obsession des serrures, rangeait les choses de manière maniaque, et il était absolument incapable de faire du mal à ses enfants de quelque façon que ce soit. Je me rends compte aujourd’hui qu’il a donné à ses enfants une liberté extraordinaire.
L'odeur du tibia qui pourrit
En grandissant, j’ai réalisé que j’étais un rejeton du chemin de fer de la mort. Ce qui est curieux c’est que je ne voulais absolument pas écrire ce livre, mais j’ai compris que si je ne le faisais pas, j’étais mort comme écrivain. Je lui posais des questions très simples, comme par exemple quel goût avait le riz rance, quelle odeur dégageait un tibia qui pourrissait et il répondait toujours à mes questions. Mais il ne m’a jamais interrogé sur l’histoire que j’écrivais et n’a jamais demandé à lire la moindre version. Il me faisait entièrement confiance. Quand j’ai rendu le manuscrit à mon éditeur, mon père m’a demandé comment ça s’était passé puis il est mort.
Vous avez tout de même travaillé sur de la documentation ?
(Rires) Ça, c’est une question que les Américains adorent poser. Il leur faut du tangible et ils ont du mal à concevoir que ce qu’on écrit vient d’abord de l’intérieur de nous-mêmes. Un jour, à Los Angeles, je participais à une présentation devant deux milles personnes avec un écrivain américain célèbre dont je tairai le nom et cette question lui a été posée. Il a répondu pendant au moins un quart d’heure que ses recherches avaient été sérieuses, qu’il avait été sur place, qu’il avait engagé des gens pour l’aider dans ses investigations, qu’il avait constitué une ribambelle de bases de données, etc. Et je voyais que le public était absolument fasciné par ses explications. Parce que pour beaucoup d’Américains, la littérature doit s’adosser à des faits réels et être le produit d’une recherche.
Au bout d’un long moment, la même question m’a évidemment été posée et j’ai simplement répondu que, comme Australien, j’étais un peu paresseux, que je me levais le matin, que j’inventais et que j’écrivais. Je trouvais que c’était pas mal comme blague. Mais elle a fait un flop magistral, personne n’a ri dans la salle. C’était le silence total. Il traduisait la méfiance, voire l’hostilité que les Américains éprouvent envers le roman et la création.
Ils estiment que la vérité d’un livre réside dans le réel dont il s’inspire mais ils ne conçoivent pas que les plus profondes vérités puissent provenir de l’imagination. Or, nous portons tous en nous un univers qui nous est propre. La difficulté est alors, dans quelque activité artistique que ce soit, d’extraire les différentes facettes de la personnalité qui est en chacun de nous.
Comme officier médecin, le personnage de Dorrigo Evans est toujours entre la vie, celle des autres qu’il doit sauver, et la mort qui est partout présente ; comme homme, il est entre Ella, la femme qui est sa fiancée et Amy, sa maîtresse. Puis, après-guerre, il est déchiré entre la popularité qui est la sienne en tant que héros de guerre et la profonde solitude qui le ronge. Il est encore entre les souvenirs de ce qu’il a vécu et l’oubli du nom des hommes qui furent ses compagnons de captivité. Dans tout le roman, il sembler rechercher une forme d’équilibre qu’il ne parvient pas à trouver.
Je n’y avais pas pensé, mais ça me semble juste. L’erreur d’un écrivain est de penser qu’il connaît son personnage. S’il le cerne de trop près, ce personnage est alors destiné à n’être qu’une caricature. Ce qui me touche le plus dans la réaction des lecteurs, c’est que certains détestent Dorrigo et que d’autres l’admirent. Dans le monde anglophone, il y a une grande pression sur le romancier : il doit rendre le personnage aimable. Dorrigo prend conscience des paradoxes de ce qu’il a vécu, il comprend qu’après être sorti vivant de cet enfer, il a un rôle social et familial à tenir qui est aussi la condition pour que ceux qui l’entourent puissent vivre avec son passé. Mais le courage qu’on veut lui attribuer est une notion abstraite, une illusion, un mensonge car il sait qu’il n’a jamais été héroïque, pas plus qu’il n’a été lâche.
Vos personnages féminins, Ella la fiancée qui deviendra sa femme, et Amy, sa maîtresse qu’il n’oubliera jamais, sont décrits différemment. La seconde, est très sensuelle, l’autre l’est moins.
Je voulais évoquer les différentes formes d’amour que peut ressentir un être humain. On n’obéit pas à un code moral. L’amour peut être très destructeur si l’on aime plusieurs personnes de manière différente. Il était très important pour moi dans ce roman qui parle des côtés sombres des hommes de montrer qu’ils n’y étaient pas enfermés. Je voulais montrer que la plus grande manifestation de l’espoir c’est l’amour, quelles que soient ses formes et son intensité.
La tyrannie du cinéma

Avez-vous vu Le Pont de la rivière Kwaï, le film de David Lean, auquel on songe en lisant votre livre qui en dit beaucoup plus que les images sur la condition des prisonniers ?
J’avais vu ce film quand j’étais juste adolescent, et je pensais que ce n’était qu’une histoire, palpitante mais inventée. Ce n’est qu’à l’âge de trente ans que j’ai réalisé que cette histoire était celle qu’avait vécue mon père. Mais lui, il a dû trouver ce film risible.
Vous avez été scénariste d’Australia (2008), le film de Baz Luhrmann, réalisé un film, présenté au festival de Berlin, The sound of one hand clapping (1998) à partir de votre livre éponyme. Envisageriez-vous de réaliser un film sur La Route étroite vers le nord lointain, ou d’en être le scénariste ?
Non. La réalisation est une activité artistique passionnante, mais le monde du cinéma est complètement réactionnaire : c’est une tyrannie dont le tyran est l’argent. Ce n’est pas surprenant qu’il y ait autant de mauvais films. Les livres, eux, appartiennent à la République des lettres et je préfère vivre dans une république, même si elle est un peu brinquebalante, que dans une tyrannie, parce que la subversion y est toujours possible et les puissants n’ont pas leur mot à dire sur l’histoire que l’on écrit.
Oliver Stone m’a contacté l’année dernière pour écrire un scénario avec lui, mais ça ne m’intéressait pas. Ce que j’ai appris sur le cinéma c’est qu’un film qui fonctionne est basé souvent sur une nouvelle, une histoire courte avec des passages poétiques. Faire un film sur tout un roman, c’est beaucoup plus compliqué. Maintenant, évidemment, un haïku de trois lignes peut être sublime mais faire un film dessus peut s’avérer délicat. La meilleure chose que puisse faire un réalisateur qui adapte un roman à l’écran, c’est de le trahir. Mais faire du cinéma, c’est rigolo, c’est comme partir avec une troupe de cirque.