 |
| Juliette Mézenc © Jean-Philippe Cazier |
Juliette Mézenc :Traverser les frontières (Entretien)
Jean-Philippe Cazier
20 décembre 2016
J
uliette Mézenc construit ses livres autour de thèmes et de questionnements récurrents que l’on retrouve, repris et déplacés, portés ailleurs, dans Laissez-passer, qui vient de paraître. Rencontre et entretien avec l’auteur autour des thèmes de la rencontre, de la frontière, de la migration, du temps, de l’identité et de la multiplicité, du genre, du politique, de la lecture – et bien sûr de l’écriture.
Est-ce que tu lisais lorsque tu étais enfant ?
Je ne voyais personne lire autour de moi. Mes parents lisaient des revues mais pas des livres. Quand je lisais, ma grand-mère me disait : « tu vas t’user les yeux ! ». C’est tard que j’ai rencontré des gens pour qui la littérature était une chose importante. Mais dès six ou sept ans je me suis mise à lire et à beaucoup lire. J’ai du mal à expliquer pourquoi. Je passais tout mon temps à lire. Je m’enfermais dans ma chambre et je lisais. Au début, c’était des trucs pour les enfants, toute la bibliothèque rose, la verte, la rouge et or. Il y avait une série intitulée Alice, que j’adorais. Lorsque mes parents ont vu que j’aimais lire, ils m’ont acheté tout ce qu’ils pensaient être bien pour une enfant. Je ne me souviens pas comment l’envie de lire est venue, mais je me rappelle qu’à partir du moment où j’ai su lire, j’ai beaucoup lu, tout de suite. Vers dix ans, j’ai réalisé que dans ma chambre, sur un rayon en hauteur, il y avait des livres que je n’avais jamais lus. C’était mystérieux pour moi car je ne voyais pas mes parents lire, ils ne lisaient pas, et je ne comprenais pas ce que ces livres faisaient là. J’ai commencé à les lire.
Il y avait L’idiot de Dostoïevski que j’ai dû lire au moins dix fois. C’est un livre qui m’a fascinée. La première fois que je l’ai lu, j’avais donc neuf ou dix ans et je n’y comprenais rien. J’ai lu aussi Aurélien, le roman d’Aragon. Je lisais ces livres sans les comprendre mais avec avidité, avec déjà un goût pour le rythme de la phrase. C’est peut-être, aussi, le fait que je ne les comprenais pas qui était fascinant pour moi. Cette langue me parlait quand même et me disait autre chose que ce que j’entendais tous les jours et qui m’ennuyait. Avec les livres, au contraire, je ne m’ennuyais pas.
Est-ce que l’école, le collège t’ont incitée à lire ?
Pas du tout. J’avais lu Le lion, de Kessel. On me l’avait offert et j’avais beaucoup aimé ce livre. Ensuite on l’a étudié en classe, et là ça me tombait des mains. Mais c’était plus que ça, c’est comme si on avait porté atteinte à quelque chose qui était à moi. Ça enlevait, pour moi, toute la force du texte, le fait que ce soit aussi aux autres, le fait qu’il soit partagé en classe. Au lycée, ça a été un peu différent, lorsque l’on s’est mis à étudier Baudelaire ou Rimbaud. Je recopiais des citations sur mon classeur. Mais il était hors de question que je parle avec les autres des livres que je lisais et de l’expérience que c’était pour moi.
Est-ce que tu écrivais à cette époque ?
J’ai commencé à écrire à la fin de l’adolescence. J’avais besoin d’écrire, par exemple, sur les films que je voyais. J’avais écrit sur des films de Visconti. Ce que j’écrivais ressemblait plus à une sorte de carnet de bord. Il y avait aussi des bribes d’histoires. C’était très hybride, des analyses de films qui me bouleversaient, des morceaux d’histoires, un récit de ce que j’avais vécu dans la journée. Je recopiais aussi des poèmes entiers. Bien sûr, je ne montrais ça à personne car, là encore, j’aurais eu l’impression que ça dévalorisait ce que je vivais. Ce qui était fort, pour moi, c’est que je le vivais seule. Aujourd’hui encore, j’ai du mal à parler de ce que j’écris, de ce qui me tient à cœur. Quand je lis un livre qui me touche, j’ai du mal à en parler et je pense que je ne pourrais pas écrire dessus. Je crois que je tiens, dans ce cas, à préserver quelque chose. Ceci dit, je peux aussi faire partager un livre qui me plait, par exemple dans les ateliers d’écriture, mais même là je préfère le lire plutôt que d’en parler.
Lorsque tu participes à des ateliers d’écriture, tu travailles à partir des textes des autres plutôt qu’à partir de tes propres textes ?
Oui, toujours. Pour moi, un atelier ça consiste à mettre en partage des questions et des textes, ou parfois des tableaux, des extraits de films. Les poser devant les autres, sur la table commune. Je précise toujours aux gens qui participent à ces ateliers avec moi qu’ils ne sont pas obligés de lire devant tout le monde ce qu’ils écrivent, et qu’ils ne sont pas non plus obligés d’écrire. Si rien n’advient, c’est aussi un droit, et de même s’ils ne veulent pas partager. Ça me semble important, parce que l’expérience de l’écriture demeure assez secrète. Et on a aussi besoin d’un temps, que s’installe une distance avec ce que l’on a écrit avant de le donner aux autres.
Comment s’est fait le passage à l’écriture pour toi ?
Ça a été très long. Les cahiers que je noircissais, je les avais fait lire à des amis qui m’avaient dit : « pourquoi tu n’écris pas un roman ? ». Je n’avais pas envie d’écrire un roman. Mais je tournais effectivement autour de l’idée d’écrire autre chose que ces notes dans mes cahiers. Un jour, une amie m’a invitée à l’accompagner dans un atelier d’écriture. J’avais presque trente ans. J’y suis allée sans être très convaincue. Ça a duré trois jours et ça m’a émerveillé. C’était comme une libération. L’impression était très physique. Je me suis dit que ce que je ressentais, ce qui arrivait était trop important et que je devais faire une place à ça.

Tu penses que ça a été le déclencheur de l’écriture ?
Oui, je crois. J’avais beaucoup lu et j’étais tétanisée par ce que j’avais lu. Dostoïevski, Steinbeck, Balzac, Maupassant – ça impressionne. Cependant, après l’épisode de l’atelier d’écriture, je me suis lancée, j’ai écrit quelques pages. Ça a été une telle expérience pour moi que j’ai réalisé que je ne pouvais pas ne pas aller dans cette direction. Mais le processus a continué à être long. A cette époque, je travaillais comme enseignante, j’avais deux enfants qui étaient encore petits. Je faisais des insomnies et j’écrivais durant ces insomnies, la nuit. J’ai pris conscience de manière très forte, et même violente, que je ne pouvais plus ignorer ce besoin de lire et d’écrire. Ça ne pouvait pas être qu’un divertissement ni être réservé aux week-ends.
Pourquoi cette prise de conscience a-t-elle été longue et violente ?
Personne ne s’attend à ce que tu écrives et personne ne te le demande. Ce serait tellement plus simple de ne pas avoir à écrire ni à lire. Tu fais un boulot normal, rémunérateur, tu élèves tes gosses et tout le monde est content, et toi aussi. Je pense que pendant un temps assez long, j’ai voulu vivre comme ça, « normalement ».
Est-ce que tu penses que cette impression est liée au fait que tu es une femme ? Est-ce que ce serait pareil pour un homme ?
Je me suis rendue compte que lorsque je suis devenue mère, j’ai été rattrapée par des attentes sociales. On a l’impression qu’aujourd’hui tout ça est terminé, mais ce n’est pas vrai. Je me suis retrouvée, sans l’avoir voulu, à jouer le rôle social que l’on attendait de moi : être une bonne mère, gagner ma vie en travaillant, etc. J’ai été rattrapée par un rôle, par des schémas dont je pensais m’être émancipée. Ça a été long et difficile, pour moi, d’analyser et de repenser tout ça. J’avais l’impression d’étouffer et ce qui me surprenait, c’est que je pensais vraiment être libérée de ces schémas. J’ai fait des études, etc. : comment pouvais-je reproduire tout ça malgré moi ? Et quand tu observes les choses autour de toi, tu te rends compte que tu es loin d’être la seule… J’ai des amies artistes qui ont choisi de ne pas avoir d’enfants pour pouvoir mener comme elles l’entendent leur existence d’artistes, alors que pour un homme, ça ne se passerait pas ainsi. Un homme ne se dira pas : « je ne vais pas avoir d’enfant pour pouvoir créer ». De ce point de vue, dans mon cas, le fait d’être une femme a donc joué un rôle. Le fait aussi de ne pas avoir grandi dans un milieu favorable à la littérature et aux arts : la création, la littérature ne devaient exister que de manière marginale par rapport au reste.
Quand tu as commencé à écrire les textes dont tu parlais, il s’agissait de quel type de textes ?
De textes qui ne se restreignaient pas à un genre mais existaient entre les genres, un récit qui allait vers le poétique…
En t’écoutant, j’ai l’impression que l’écriture t’es tombée dessus, non seulement le fait d’écrire mais un certain type d’écriture marginale, comme un cadre dans lequel tu te serais trouvée et dans lequel tu as appris à évoluer.
Effectivement, je n’ai pas choisi…
Quand tu étais enseignante, quel rapport avais-tu avec la littérature et l’écriture ? Il y a des consignes, des directives du ministère, etc. Comment est-ce que tu te débrouillais avec ça ?
Je prenais des libertés. Au collège, le programme le permet plus qu’au lycée. D’ailleurs, je ne regardais pas forcément le programme avant de choisir les auteurs avec lesquels j’allais travailler. En première, tu es prisonnier moins du programme, qui est celui du bac, que du type d’approche des textes qui est très normé. Mais au collège tu restes très libre et je ne me suis jamais vraiment souciée du programme. Je leur faisais étudier de la poésie contemporaine et surtout je leur lisais des textes. J’essayais aussi de sortir du cadre des exercices scolaires, sans sanctionner ce qu’ils faisaient par une note. Je leur prêtais des livres également.
Quand tu as commencé à écrire vraiment, est-ce que tu avais l’idée de publier à l’intérieur du circuit institutionnalisé de la littérature ?
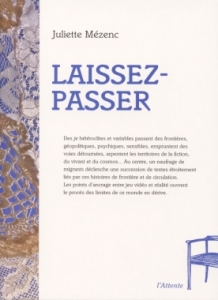
J’ai écrit trois ou quatre manuscrits que j’ai envoyés à des éditeurs qui les ont refusés. Je me suis demandé si je devais continuer à écrire ou s’il valait mieux que j’arrête. J’ai réalisé que je ne pouvais pas m’arrêter : même si rien de ce que j’écrivais n’était publié, je devais continuer.
A cette époque, un ami m’a conseillé de créer un blog, ce que j’ai fait. C’est là que j’ai mis en ligne Sujets sensibles, plus tard publié chez Publie.net. François Bon avait lu certains textes de Sujets sensibles en ligne et il m’a envoyé un message en me proposant de publier ce texte chez Publie.net qu’il avait fondé… En créant ce blog, je pensais que seuls mes amis allaient me lire mais, de fait, j’ai rencontré d’autres lecteurs et des lecteurs qui s’avéraient être des écrivains. Pour Laissez-passer, qui vient de sortir chez l’Attente, certains extraits ont d’abord étaient mis en ligne sur le site.
Quelle importance le fait d’avoir ce blog et d’y mettre des extraits de tes textes a-t-il dans ton processus d’écriture ?

Ce que j’y publie, ce sont des moments du processus, ce n’est pas le texte définitif. Ce sont des états du texte, à un moment donné… Pour Sujets sensibles, je me souviens qu’un lecteur m’avait écrit pour me dire que ce texte lui faisait penser à L’Opoponax de Monique Wittig, que je ne connaissais pas et que j’ai commencé à lire. C’est comme ça que Monique Wittig s’est retrouvée dans Elles en chambre. Donc, avoir un blog et y publier permet aussi de faire des rencontres et, dans ce cas précis, de trouver quelque chose qui m’a intéressé pour mon travail. Aujourd’hui, je publie beaucoup moins sur ce blog, ce qui ne veut pas dire que je n’y reviendrai pas.
J’ai l’impression que tu as plusieurs portes d’entrée dans l’écriture : un « manuscrit » que tu écris, l’écriture avec les autres dans les ateliers d’écriture, le blog et internet…
Ce qui est aussi intéressant, c’est de lire les autres auteurs qui publient sur leurs blogs, ce que je fais souvent. C’est un biais pour lire de la littérature immédiatement contemporaine. Pendant longtemps, je n’ai lu que de la littérature dite classique, d’Eschyle à Dostoïevski, au maximum Marguerite Duras.
Pourquoi ?
J’ai commencé à lire ces auteurs et, comme je te l’ai dit, ça s’est fait par hasard, d’abord avec ces livres que j’ai trouvés. Il y avait Steinbeck, Malraux, Giono. Il y avait Pearl Buck aussi. Dans ces livres, peu de femmes, peu d’auteurs contemporains – et pendant un temps j’ai continué sur cette lancée. Ceci dit, ce n’est pas tout à fait vrai puisque j’ai lu pas mal d’auteurs contemporains mais américains. Pendant deux ans j’ai travaillé dans une agence littéraire qui s’occupait des droits d’auteurs américains. J’ai lu Bukowski, Paul Auster, Burroughs, etc. Dans le cadre de mes études, j’ai aussi subi les auteurs qui sont ceux que l’on t’impose et là encore ça n’allait pas plus loin que Duras, Bonnefoy ou Saint-John Perse… Par l’intermédiaire d’internet et des blogs que je lisais, j’ai pu découvrir des auteurs qui m’ont intéressée comme Cécile Portier, avec son blog « Petite Racine », ou Christophe Grossi, Anne Savelli, Guillaume Vissac, etc. Ce qui était stimulant, c’est que l’on pouvait échanger entre nous, se lire les uns les autres, échanger des textes. On ne se connaissait pas mais on se lisait. Tout ça m’a fait sortir de l’isolement dans lequel j’étais.
Si l’on parle des thèmes qui traversent ce que tu écris, qui sont récurrents, est-ce que ce sont des thèmes que tu travailles de manière voulue, très consciente ? Je pense par exemple à une notion centrale dans tes textes qui est la celle de « porosité ». « Poreux », « porosité », ça revient tout le temps…
C’est très souvent a posteriori, après-coup, qu’en lisant ce que j’ai écrit je m’aperçois de la permanence ou de l’insistance de tel thème, de telle figure. C’est le cas pour la question de la porosité, ou celle du sous-terrain, ou de l’histoire des migrations. Leur présence n’est jamais, au départ, volontaire. Je suis surprise de la façon dont, par exemple, reviennent sans cesse la notion de sous-terrain, l’image de cavités souterraines. Pour les migrations, c’est la même chose. Dans Sujets sensibles, qu’il y ait le thème de la migration semble aller de soi puisque, pour l’écrire, j’ai mené des entretiens avec des jeunes issus de l’immigration ou qui venaient d’arriver en France. Dans Poreuse, je ne m’attendais pas à les voir surgir dans ce texte et c’est pourtant ce qu’il s’est passé…
Comment procèdes-tu pour écrire ? Tu conçois le livre à l’avance, tu fais une sorte de plan ? Tu as des notes ?
Je n’ai pas vraiment de plan. Pour celui que je suis en train d’écrire, pour la première fois j’ai commencé en ayant déjà non un plan mais plusieurs moments du livre, des sortes de mouvements – un peu comme dans une symphonie il y a plusieurs mouvements. Pour ce texte, j’ai plusieurs mouvements qui étaient là quasiment dès le départ. Ceci dit, ce texte est pour moi très particulier. Je travaillais sur une espèce d’almanach et ce texte est apparu tout à coup, l’idée de ce texte. Et il a tout bouleversé. J’ai laissé des choses en cours pour m’y consacrer. J’avais l’impression que si j’attendais, il risquait de m’échapper. Ce qui est également singulier, dans le cas de ce texte, c’est que j’avais la fin pratiquement dès le commencement, alors que pour les autres pas du tout. Pour Poreuse, j’avais uniquement une image et tout s’est construit à partir de cette image.
Donc, habituellement, tes textes s’élaborent au fur et à mesure, selon une dynamique immanente au texte ?
Les choses se mettent en place peu à peu. En un sens, le livre se construit lui-même. A un certain moment, je peux faire un rêve que j’ai envie d’introduire dans le texte en cours, de le placer à tel endroit, et le reste va en être transformé. Le livre s’écrit en s’articulant dans le temps. Est-ce que ce n’est pas tout travail de création qui fonctionne ainsi ? Il y a sans cesse des va-et-vient à l’intérieur du texte, pendant qu’on l’écrit. Des trajets aussi entre ce qui est conscient et l’inconscient. Pour Elles en chambre, je suis partie seulement de questions, je n’avais rien d’autre, seulement des questions et le temps de poser réellement ces questions. J’avais un désir d’entrer dans ces questions, dans leur complexité, sans chercher absolument des réponses.

Pour en revenir à la porosité, ce qui caractérise tes textes, c’est qu’ils sont, dans leur construction, de manière interne, poreux, ouverts à plusieurs genres. Elles en chambre, par exemple, c’est à la fois du récit, de la poésie, de l’essai. Tu as aussi demandé à d’autres auteurs, comme Liliane Giraudon par exemple, d’écrire des textes que tu as intégrés à ton livre.
Qu’est-ce qui t’intéresse dans le fait d’écrire des textes qui sont en eux-mêmes pluriels, multiples ?
Là aussi, je n’ai pas vraiment choisi. J’avais envie d’écrire des récits plus homogènes. J’ai essayé mais ça ne fonctionnait pas. Il a fallu que j’accepte d’aller dans d’autres directions. Lorsque j’ai accepté cela, j’ai vraiment éprouvé de la joie. J’avais le sentiment d’être plus libre. Quel auteur parle de « sauts et gambades » ? C’est Montaigne, non ? Oui, c’est Montaigne, dans les Essais. C’est ce qui m’a plu, de pouvoir procéder par sauts et gambades.
Ta façon d’écrire, en procédant ainsi, sans, à l’intérieur d’un même livre, sur une même page, t’en tenir à un genre, cette façon est singulière. Tes textes traversent les genres, passent à travers les genres sans se solidifier dans un seul. Je ne vois pas tellement de choses équivalentes dans la littérature actuelle en France. La notion de genre devient relativement caduque ou est, en tout cas, fortement remise en question…
Je crois que c’est aussi une des raisons pour lesquelles j’ai mis du temps à commencer à écrire. Ce que j’avais lu, depuis toujours, était davantage genré, conforme à tel ou tel genre : l’essai, la poésie, le roman, etc. Je n’avais pas véritablement de repères ou de modèles autres. C’est en écrivant que j’ai trouvé cette forme hybride. Ceci dit, depuis que j’écris ainsi, je rencontre des textes d’autres auteurs dont je me rends compte qu’ils vont un peu dans le même sens.
Il y a par exemple un livre qui m’aide à écrire aujourd’hui et qui est le livre d’Olivia Rosenthal, Mécanismes de survie en milieu hostile. Il y a dans ce livre des passages qui m’ont beaucoup intéressée justement par leur dimension hybride. Il y a aussi Antoine Volodine qui travaille sur plusieurs genres mais pas à l’intérieur d’un même livre. Pour mon compte, je me rends compte que je ne peux pas écrire en m’en tenant à un genre ni même à une voix.

Ceci rejoindrait un autre thème de ton travail qui est celui de la frontière, de la traversée des frontières. Dans tes textes, les frontières sont constatées, expérimentées mais aussi traversées, rendues floues, inopérantes. Et ce qu’elles séparent ou relient se trouble.
Ce thème est central. Dans Laissez-passer j’ai décidé, de manière volontaire, consciente, d’explorer ce thème qui revenait de manière récurrente dans mes autres textes. Au départ, j’avais l’idée des frontières géopolitiques et j’avais commencé à prendre des notes là-dessus. En 2012, il y a eu un naufrage à Lampedusa et j’ai écrit un texte basé sur un article que j’avais lu concernant ce drame. La fin de cet article évoquait le cas d’une femme retrouvée vivante dans un sac de la morgue : les personnes qui s’occupaient des corps des naufragés l’avaient trouvée et avaient pensé qu’elle était morte alors qu’elle était toujours vivante, à peine mais vivante. Donc, j’ai écrit un texte à partir de ça, et Laissez-passer s’est construit à partir et autour de ça. Au fur et à mesure, j’ai intégré d’autres types de frontières : celle de la peau, la soi-disant frontière entre la vie et la mort, etc. Dans la durée de l’écriture, des choses sont venues s’agréger, se cristalliser, en fonction aussi ce que je vivais.
Est-ce qu’il y a également une dimension politique dans le privilège que tu accordes aujourd’hui à cette question de la frontière ou des frontières ?
Ces questions me troublent, me tourmentent. Je suis allée, par exemple, dans un centre de rétention pour rencontrer des clandestins, comme on dit, et parler avec eux. J’ai travaillé avec des jeunes sans-papiers dans des ateliers d’écriture. J’ai aidé des sans-papiers à faire leurs dossiers pour la préfecture… Ce sont des situations qui me mettent en colère. Ça renvoie à un certain sens de la justice. Je trouve inique que les gens ne puissent pas franchir les frontières, d’autant plus lorsque ce sont des gens qui fuient l’extrême pauvreté ou la guerre.
En même temps, on voit bien comment on peut traverser les frontières très facilement : l’argent, la possession des bons papiers permet cela. Nous, nous pouvons traverser toutes les frontières comme nous le voulons, en un clin d’œil, alors que d’autres doivent risquer leur vie, meurent en Méditerranée. Je ne pense pas que l’on puisse écrire aujourd’hui sur ce thème de la frontière sans être… j’allais dire « révolté », mais ce n’est pas le mot. Virginia Woolf disait que l’on ne peut rien écrire de valable sous le coup de la colère, sans distance et durée, et je crois que c’est vrai. Donc, je ne dirai pas « révolté », mais ces questions m’affectent fortement. Je pense que je fais de la politique dans l’écriture, lorsque je décide de consacrer du temps à des questions qui sont pour moi essentielles, sans que ça ne me rapporte rien, mais j’entre dans ces questions, dans leur complexité. Ce qui me fait bondir, ce sont les discours simplistes, simplificateurs, ces discours que l’on nous déverse en permanence et partout. Je ne peux plus entendre les informations, ce n’est plus possible. Ni les politiques.
J’ai lu, mais je ne sais plus où, une phrase que tu as écrite et dans laquelle tu définis l’écriture par le fait d’écrire avec et pas d’écrire sur. Ça me rappelle la façon dont Deleuze définit la philosophie comme une pensée avec et non une pensée sur. Quel sens et quelle importance donnes-tu à cette idée ?
Pour Elles en chambre, j’ai essayé d’écrire avec d’autres femmes écrivains et avec la lecture que je faisais de leurs textes. C’était un peu comme un dialogue. Pour ce livre, en fait, j’ai passé plus de temps à lire qu’à écrire. Mon écriture est venue entre les lignes de leurs livres, sans idée préconçue concernant ce que ça allait donner. Je voulais être contaminée par l’écriture de ces auteurs femmes. C’est sans doute ce que signifie pour moi « écrire avec ».
Un autre thème récurrent de ton travail, qui rejoint ceux que l’on a déjà évoqués, est celui de l’identité. Par exemple, dans Laissez-passer, le narrateur n’a pas d’identité fixe – ou mieux, il y a plusieurs narrateurs hétérogènes ou au contraire qui pourraient se confondre. Et grâce à leur nature hybride, tes livres n’ont pas d’identité facilement définissable.
C’est, là encore, quelque chose qui s’est imposé à moi, que j’ai constaté dans mes textes et que j’ai voulu explorer, mener plus loin. En rester à un seul Je, n’être soi-même qu’un Je est sans doute une sorte d’emprisonnement. Chaque fois que j’ai voulu écrire avec un seul Je, une seule voix, ça n’a pas marché, et au fond ça ne m’intéresse pas. Donc j’articule plusieurs Je, plusieurs strates, plusieurs niveaux, comme dans les jeux vidéo, plusieurs niveaux de réalité. Je crois que ça traduit mon rapport au monde. En rester à un seul Je aplatît ce qui est multiple, ce que je perçois comme un foisonnement.
Là encore, est-ce qu’il y aurait une dimension politique dans ce refus de l’identité, dans l’affirmation de la multiplicité ? A l’heure actuelle, le discours politique et les consciences sont remplis à ras bord de l’obsession de l’identité, de la volonté d’assigner à des identités, de la volonté d’éradiquer le multiple. Chez toi, c’est exactement l’inverse.
Je ne me sens pas faite d’un seul bloc, comme un bloc identitaire justement. L’idée me paraît tellement fausse, un mensonge…
On va se mettre toute l’extrême-droite à dos…
J’espère bien ! J’aime la littérature car elle admet les contradictions, des frictions, des propositions inconciliables entre elles. Tout ça, c’est la vie qui nous dépasse. J’aimerais que dans mes textes il y ait ce qui nous dépasse. J’aimerais que mes textes laissent entendre que nous sommes dépassés tout le temps, débordés. En même temps, c’est très angoissant de vivre en étant débordé, de vivre avec ça. C’est à la fois angoissant et tranquillisant. Je pense aux multivers que l’on trouve chez Aurélien Barrau. Il y aurait une pluralité, une infinité d’univers. En ce sens, c’est angoissant, mais en même temps on est forcé de relativiser, de lâcher. Henry Miller, dans un entretien, dit que le doute est insupportable pour l’Homme, mais que ce que l’on peut apprendre de mieux est de vivre avec le doute, les incertitudes, ce qui nous échappe. Il me semble qu’écrire, c’est cet apprentissage – vivre avec la mort, le doute…
La mort et le rapport à la mort sont aussi un thème présent dans tes livres, de manière plus discrète sans doute que celui de la migration par exemple, mais récurrent. Dans Laissez-passer, c’est quelque chose qui est omniprésent. Il y a un passage qui est très beau où il s’agit d’un migrant embarqué sur un bateau, une barque, qui imagine sa vie en France et dont on ne sait s’il coule et se noie en mer, s’il délire, s’il survit ou s’il est toujours vivant au moment où il déroule son espèce de monologue…
C’est quelque chose avec quoi je travaille, et de plus en plus, l’idée de la mort dans la vie, tresser la mort et la vie. J’essaie de ne pas éluder, de ne pas faire comme si ça n’existait pas. Le texte que j’écris actuellement tourne autour de cet axe central. Il s’agit d’une sorte de récit, un texte qui tend vers le récit mais qui emprunte au schéma des jeux vidéo, avec plusieurs niveaux de récit, avec des disparitions dans le paysage. Il est question d’un homme qui est parti pour se fondre dans le paysage. Il y a des disparitions provisoires, des réapparitions. Lorsque j’étais petite, on m’avait expliqué que les sources s’enfouissaient dans le sol et réapparaissaient plus loin. Ça m’avait fasciné.
C’est ce schéma que je retrouve dans ce texte, le fait de disparaitre, de réapparaitre différemment. Tu es passé sous terre et tu réapparais chargé de ce passage. Ce sont les mouvements de départ dont je te parlais tout à l’heure. C’est en l’écrivant que je réalise comment et à quel point le thème de la mort est présent là-dedans. Mais la mort, ici, est tressée à la vie, la mort dans la vie et la vie dans la mort, sans cesse…
Écrire, pour moi, c’est continuer à se poser les questions que l’on se pose lorsque l’on est enfant, les poser inlassablement, les grandes questions que se posent les petits enfants. Écrire, c’est continuer ce travail. Lorsque, à une certaine période de mon existence, je n’ai plus pu poser ces questions, les poser aussi à travers la lecture des livres des autres, parce que je devais beaucoup travailler, que j’avais mes enfants et que je n’avais pas le temps pour autre chose, j’en ai été littéralement malade. J’avais l’impression que je n’étais plus vivante. J’ai donc été contrainte de me forcer à trouver des moyens pour continuer à travailler sur ces questions, à lire et à écrire en vue de et avec ces questions. La mort fait partie de ces questions.
Ce qui m’intéresse, c’est que tu dis que ces questions sont celles que se posent les enfants et que continuer à les poser, pour toi, implique de les poser comme les posent les enfants, avec toute l’incompréhension et l’absence de culture savante ou instituée que l’on trouve chez les enfants, donc sans réponse immédiate, avec le seul événement de la question en quelque sorte pure.
Est-ce que pour toi ce serait une définition de la littérature et de l’écriture : poser des questions en contournant les réponses, poser des questions qui persistent en tant que telles, comme si écrire était essentiellement questionner en demeurant dans l’ouverture de la question ?
Oui, une suite de questions ouvertes, qui demeurent ouvertes. Je m’intéresse aussi à l’astrophysique parce que précisément je ne comprends pas tout. Et je repense au fait que, lorsque j’étais enfant, je lisais Dostoïevski sans comprendre, et ça me fascinait… L’écriture me reconnecte avec la réalité. Si je n’écris pas, je me sens séparée de ce que l’on appelle la réalité, comme si elle demeurait derrière une vitre. La littérature, l’écriture me permettent de faire partie de cette réalité, d’en faire partie. Et cette réalité a à voir avec ce que l’on ne comprend pas, ce qui nous déborde, et avec ce rapport ouvert à la réalité qui ne se referme jamais, avec « l’ouvert » de la réalité qui ne se referme jamais.
Juliette Mézenc a récemment publié Laissez-passer, éditions de l’Attente, octobre 2016, 152 p., 16 €.


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire