Kevin Barry : John Lennon, une île, un œuf
Christine Marcandier
13 janvier 2017

Nul besoin d’être un beatlemaniaque ou un féru de cette vague de fond des vies imaginaires qui s’est (ré)emparé de la littérature pour plonger dans L’Œuf de Lennon, second roman de l’écrivain irlandais Kevin Barry, tout juste traduit aux éditions Buchet Chastel par Carine Chichereau. Si John Lennon est bien la figure centrale du livre, c’est moins en tant que célèbre membre du groupe qu’homme en pleine crise, voulant échapper au monde et à ses propres démons. 3 days in a live : « Il va passer trois jours sur son île. Voilà tout ce qu’il demande. Pouvoir hurler de tout ses poumons, bordel, hurler les jours en nuits, hurler aux étoiles la nuit — s’il y a des étoiles, qu’elles se manifestent ».
En 1978, John Lennon désire donc se rendre, incognito, sur une île qu’il a achetée au large des côtes irlandaises dix ans plus tôt, « à vingt sept ans, comme dans un rêve », Dorinish. Il va mal, « un peu bizarre, un peu dingue à nouveau — les portes de l’autre monde s’ouvrent » ; « et puis il est hanté par son propre moi depuis trop longtemps, incessamment fasciné par ce moi sombre — il est dans la douleur, il est la divinité, il est un foutu monstre », monstre par ses démons intérieurs, ses origines étranges (« petit Blanc du nord de l’Angleterre avec du sang de patate irlandais dans les veines » ; « un gosse des années 1940, si bien que ses inquiétudes tentaculaires remontent beaucoup plus loin en arrière »), un monstre parce qu’il est sans cesse montré du doigt, scruté, par le public, par la presse.

Cette île, c’est aussi une identité perdue, comme le suggère la citation de John McGahern en exergue du roman, « la plus insaisissable de toutes les îles, la première personne du singulier ». Qui est encore John Lennon sous ce nom qui fait de lui une célébrité traquée par les paparazzi ? Alors Lennon part, « il se met en route vers cette destination comme le ferait un animal, suivant une sorte de migration fatale. Il n’y a là rien de rationnel, et ce n’est pas non plus très normal, mais c’est là justement tout l’intérêt ». C’est sur cette trame ténue, énoncée dès les premières lignes du récit, que brode Kevin Barry, au sens premier du terme, son récit ayant tout à voir avec l’étymon même du mot texte, un tissu ; certaines pages rappellent le grand aîné irlandais et son Ulysse, entre flux intérieur et focalisation externe, comme un tissu effrangé d’ailleurs, puisque le texte n’est pas justifié à droite, entre vers et prose, dans un abandon à ce qui échappe.
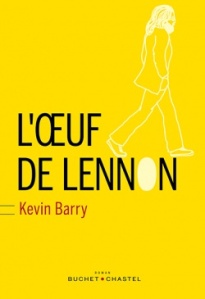
Partir, donc, pour se retrouver, peut-être, avec pour seul compagnon son chauffeur, Cornelius O’Grady, avec lequel Lennon dialogue comme s’il était à la fois un interlocuteur et une part de lui-même, un daïmon, une voix par laquelle extérioriser la sienne et tenter de l’apprivoiser, pousser ce cri primal comme le lui a conseillé son gourou californien, Arthur Janov, « une technique pour atteindre les douleurs enfouies et les traumatismes de l’enfance ». Le récit est majoritairement ce dialogue, lors du voyage longtemps entravé vers l’île, vers ce centre impossible de l’être, un double itinéraire spirituel et géographique qui est à la fois balade et ballade, avec ses refrains et rengaines — « les histoires d’amours mortes, voilà de quoi nous sommes faits » — ses embardées et accalmies, ses fulgurances et pertes. Tout peut se dire, dans l’épaisseur de la nuit, l’opacité des embruns et des échanges avec un autre soi-même : la peur de ne plus pouvoir écrire et composer de chansons, la hantise de la mort (deux ans plus tard…), la perte de soi sous ce costume mal ajusté de pop star internationalement adulée (donc méconnue).
 Dans La Part inventée (Seuil, 2017), Rodrigo Fresán voit dans la couverture de l’album Sergent Pepper l’un des germes de sa vocation d’écrivain : enfant, fasciné, il aurait voulu connaître la vie de chacun des personnages représentés. Pourquoi ne pas commencer par le lonely heart de John Lennon ?
Dans La Part inventée (Seuil, 2017), Rodrigo Fresán voit dans la couverture de l’album Sergent Pepper l’un des germes de sa vocation d’écrivain : enfant, fasciné, il aurait voulu connaître la vie de chacun des personnages représentés. Pourquoi ne pas commencer par le lonely heart de John Lennon ?
Comme le note Kevin Barry dans les dernières pages du livre — réflexion sur la création, l’auteur en miroir de son personnage —, il s’agit d’écrire « à partir des lieux », au creux de cette géographie mentale ; aucune hagiographie ici, aucune volonté de retrouver une « vérité » qui s’est de toute façon « fondue dans l’apocryphe ».
L’Œuf de Lennon ressort, lui, du vrai de la fiction, celui des sensations, des lieux et moments, d’une identité perdue, retrouvée dans ces pages somptueuses et magistralement rendues par la traduction de Carine Chichereau.
L’Œuf de Lennon ressort, lui, du vrai de la fiction, celui des sensations, des lieux et moments, d’une identité perdue, retrouvée dans ces pages somptueuses et magistralement rendues par la traduction de Carine Chichereau.
Kevin Barry, L’Œuf de Lennon (Beatlebone, 2015), traduit de l’anglais (Irlande) par Carine Chichereau, Buchet Chastel, 2017, 342 p., 22 €



Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire