Salman Rushdie alias Joseph Anton
Christine Marcandier
« Le monde explosait autour de lui » : on est en 1989, l’année de la chute du mur de Berlin, de la libération de Nelson Mandela, des émeutes de la place Tien’anmen, et, le 14 février, de la fatwa que l’ayatollah Khomeini lança contre un écrivain, Salman Rushdie, et un livre, Les Versets sataniques. « Le fond de sa pensée était : je suis un homme mort. » Toute la vie de Salman Rushdie se recompose à partir de cette date qui ouvre Joseph Anton, lui imposant une relecture de sa propre vie.
Joseph Anton tient des Mémoires d’outre-tombe comme des Confessions : parler depuis la mort dont on l’a menacé, avec un paradoxe qu’il souligne lui-même : on passe normalement sa vie à attendre que quelque chose advienne ; lui espérait que quelque chose ne se produise pas. Parler pour dire la vérité, toute sa vérité sur ces années de combat mais aussi de honte. Dire comment tout a commencé pour lui mais aussi pour le monde, en 1989, « comment le petit nuage de cette attaque sur un livre précis a grossi au point de devenir, peut-être, le récit central de notre époque, cette montée de l’islamisme radical ».
Près de 25 ans plus tard, avec le souvenir pour « seule arme », Salman Rushdie publiait Joseph Anton, mémoires d’une vie de clandestinité, souvenirs d’une existence soumise à la dictature du présent. Son ami l’écrivain Martin Amis en souligna le paradoxe d’une formule saisissante, « disant qu’il « avait disparu à la une » ». Une vie qui lui a échappé, tant elle fut prise entre des prisons multiples : celle, évidente, que faisait planer la fatwa, cette mise à mort à laquelle Rushdie refuse la qualification de « condamnation », puisqu’il n’y eut jamais de procès, aucune justice. Mais aussi celle de la presse, puisque soudain sa moindre parole publique fut scrutée, décortiquée. Les tabloïds le condamnent à leur tour : sa protection policière coûterait si cher aux contribuables anglais, la menace est-elle même réelle ou le délire d’un écrivain mythomane ? Salman Rushdie insiste sur ce « double combat » pour recouvrer sa liberté et « l’un ne fut pas plus facile que l’autre »…
Peu à peu tout lui échappe : Les Versets sataniques, brûlé et interdit par les uns, édité et diffusé par les autres au péril de leur vie, n’est plus un roman mais, au mieux, un symbole, et un texte commenté, condamné sans savoir été lu, au pire. Lui-même voit son identité se fracturer. Rushdie, « petit garçon de Bombay qui a beaucoup voyagé » comme il aime à se définir, au nom déjà forgé de toutes pièces par son père comme il le raconte dans le livre, a quitté l’Inde pour l’Angleterre quand il avait 13 ans. Il a su se construire une carapace, devenir un écrivain célèbre, bien avant la fatwa qui jette son nom en pâture au monde. Il comprend soudain que quelque chose lui a échappé, qu’il est un « immigré » souffrant d’un « excès d’enracinement », que « l’identité était à la fois son origine et son voyage ».
Joseph Anton, dans sa forme-même, fait état de ces fractures. Le livre, pourtant sous-titré « une autobiographie », est écrit à la troisième personne, manière de dépasser l’événement, d’en revenir à la toute-puissance de la fiction — comme dans ces Mille et Une Nuits que lui racontait son père, « des histoires racontées pour contrer la mort, pour démontrer le pouvoir des histoires de civiliser et de vaincre même les plus meurtriers des tyrans — pour unifier cette identité brisée.
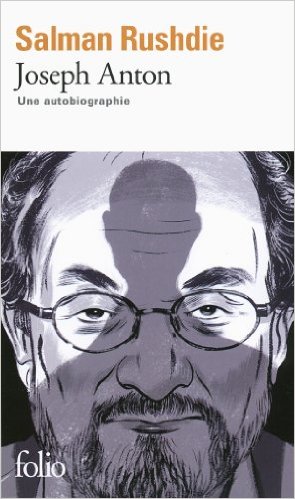 Salman Rushdie est contraint de prendre une identité d’emprunt : il sera Joseph Anton, alias créé à partir du prénom de deux écrivains admirés (Conrad et Tchekhov), un homme qui note avec ironie combien sa vie clandestine recoupe nombre de thèmes de ses romans antérieurs à la fatwa.
Salman Rushdie est contraint de prendre une identité d’emprunt : il sera Joseph Anton, alias créé à partir du prénom de deux écrivains admirés (Conrad et Tchekhov), un homme qui note avec ironie combien sa vie clandestine recoupe nombre de thèmes de ses romans antérieurs à la fatwa.
Et Rushdie raconte, « de l’extérieur », avec sérénité, ce que fut le quotidien de Joseph Anton : une vie bouleversée de fond en comble, d’adresse secrète en planque, la difficulté à voir sa famille, son fils, ses amis. Le quotidien n’existe plus, soumis à la « menace » permanente d’une exécution froide, d’un tireur isolé, d’un attentat.
L’écrivain ne peut plus signer ses livres, croiser ses lecteurs, faire des conférences, prendre un avion ou tout transport collectif. Son mariage s’étiole, il hésite à se séparer de sa femme, pourra-t-il supporter seul cet enfer ?
Aucune complaisance dans ce livre : Rushdie dit ses moments de dépression, ses bassesses aussi, il est un homme, pas une icône. Mais il raconte aussi la comédie grinçante que devient sa vie. Quand il explique combien il est compliqué de s’extraire d’une voiture blindée (les portes sont si lourdes qu’elles coupent facilement une jambe ou un bras), quand il raconte son arrivée à New York supposée discrète : « une longue limousine blanche blindée au milieu de l’escorte des neuf voitures encadrées par des motards, toutes sirènes hurlantes et gyrophares à fond » dévalant « la 125e rue en direction du campus de Columbia à cent à l’heure avec tout Harlem sur les trottoirs qui regardait cette anodine caravane passer discrètement ». L’humour est une manière de survivre dans cette « comédie noire ». Son mariage qui part à vau-l’eau, « le contenu habituel des disputes conjugales porté à un degré de mélodrame grotesque par l’existence de cape et d’épée qu’ils menaient ». Salman Rushdie élit « meilleure blague de la semaine » la protestation de l’ambassade d’Iran à Ottawa « parce qu’elle n’avait pas été prévenue de sa visite », rit jaune quand Bill Clinton n’a finalement pas le temps de le rencontrer, « ce serait la veille de Thanksgiving et le Président aurait beaucoup à faire. Il devait absoudre une dinde. Cela ne lui laisserait peut-être pas le temps d’aider en plus un romancier ».
Mais il y a aussi les miracles de certaines rencontres – amicales, amoureuses –, la naissance du second fils, Milan. Joseph Anton est la chronique d’une vie « malheureusement extrêmement excitante » qui mêle tous les genres romanesques, de la franche comédie de boulevard aux drames les plus noirs. Il concentre l’histoire du monde et histoire personnelle, jusqu’au plus intime. Joseph Anton est d’abord le journal d’un écrivain au travail, qui lutte pour retrouver l’inspiration malgré ce quotidien qui l’étouffe. Il est le récit d’une vérité à rétablir alors que « le langage de la littérature » est « submergé par la cacophonie d’autres discours, politiques, religieux, sociologiques, postcoloniaux ». Pour ne plus être l’auteur invisible des Versets sataniques auquel on finit par réduire son œuvre, « ce roman imaginaire qui concentrait sur lui toute la rage de l’Islam ». Pour cela il doit lutter contre les campagnes haineuses des tabloïds anglais – qui lui reprochent son caractère, son orgueil, le coût de sa protection et même d’avoir épousé un mannequin indien –, contre la peur que les fanatiques imposent à l’Occident, contre les forces de police qui le protègent. Il recommence à sortir, à parler. Il recompose, lit, écrit, monte sur scène à Wembley avec son ami et soutien de toujours, Bono, leader du groupe U2. Salman Rushdie entreprend une véritable croisade pour reconquérir sa liberté. Ni lui ni Les Versets sataniques ne doivent plus être « un alibi dans un jeu politique où ils n’avaient rien ou si peu à voir ». Il rencontre des hommes politiques pour faire grandir une campagne internationale de soutien. Et surtout il reprend une vie « ordinaire » d’écrivain, faisant des conférences, rencontrant ses lecteurs.

Il n’y a pas de doute, Salman Rushdie, avec Joseph Anton, est redevenu ce qu’il a toujours été, un écrivain, réaffirmant la leçon qu’il avait apprise dans les Mille et Une Nuits : « L’homme était l’animal fabulateur, la seule créature sur Terre qui se raconte des histoires afin de comprendre quelle sorte de créature il est. L’histoire était un bien qui lui appartenait de naissance et personne ne pouvait le lui retirer. »
Salman Rushdie, Joseph Anton, une autobiographie, trad. de l’anglais par Gérard Meudal, Folio, 928 p., 11 €



Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire