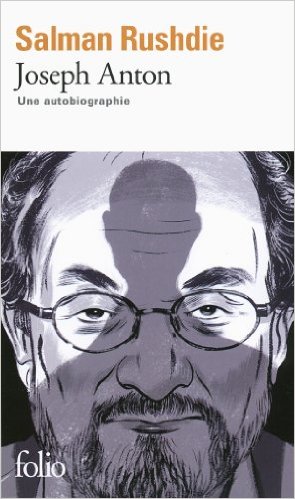Ian McEwan est le romancier de l’ambiguïté, maître de la mise en récit de la confusion des sentiments. L’Intérêt de l’enfant ne déroge pas à la règle : à travers un remarquable portrait de femme tiraillée entre sa déontologie et ses aspirations, il rend compte de la société tout entière, de nos vies contemporaines confrontées aux notions de religion, de justice, de libre-arbitre et de droit.
« D’abord les faits »
 Dans un précédent roman de Ian McEwan, le remarquable Sur la plage de Chesil, l’un des personnages, Edward, était aux prises avec cette réflexion désabusée, « voilà comment on peut changer radicalement le cours d’une vie : en ne faisant rien ». D’ailleurs, « le résumé de son existence prendrait moins d’une minute, tiendrait en moins d’une demi-page ». Ce pourrait être le cas de la vie de Fiona Maye, 59 ans, juge aux affaires familiales. Elle consacre ses journées à l’étude des dossiers qui lui sont confiés et se voit unanimement reconnue pour « la concision de sa prose mi-ironique mi-compatissante, et pour l’économie de moyens » avec laquelle elle rend ses jugements impartiaux. Son existence semble tout ce qu’il y a de plus rangé : elle demeure dans un quartier chic et tranquille de Londres, n’a pas d’enfant, et vit depuis trois décennies avec son mari, universitaire.
Dans un précédent roman de Ian McEwan, le remarquable Sur la plage de Chesil, l’un des personnages, Edward, était aux prises avec cette réflexion désabusée, « voilà comment on peut changer radicalement le cours d’une vie : en ne faisant rien ». D’ailleurs, « le résumé de son existence prendrait moins d’une minute, tiendrait en moins d’une demi-page ». Ce pourrait être le cas de la vie de Fiona Maye, 59 ans, juge aux affaires familiales. Elle consacre ses journées à l’étude des dossiers qui lui sont confiés et se voit unanimement reconnue pour « la concision de sa prose mi-ironique mi-compatissante, et pour l’économie de moyens » avec laquelle elle rend ses jugements impartiaux. Son existence semble tout ce qu’il y a de plus rangé : elle demeure dans un quartier chic et tranquille de Londres, n’a pas d’enfant, et vit depuis trois décennies avec son mari, universitaire.
Mais les vies les plus banales basculent toujours autour d’un petit « rien ». Jake annonce à Fiona, un dimanche soir de juin qu’il songe à la tromper. Il veut « vivre une grande aventure passionnée », s’offrir « une dose d’extase suffisante pour tenir jusqu’à la tombe ». Et voilà Fiona soudain plongée dans l’univers de la « chambre des affaires familiales », dans ces « demi-vérités intimes » qu’elle regardait jusqu’alors d’œil froid et professionnel. Le travail lui a fait négliger son couple, ce travail pour lequel elle ne trouve plus le détachement nécessaire, obsédée par cette Mélanie que convoite son mari, Mélanie au prénom « pas si loin de celui d’un cancer de la peau incurable ».
« S’il restait, l’humiliation ; s’il partait, l’abîme »
Fiona perd pied, elle n’est plus qu’un vaste de champ de sentiments contradictoires, elle est déchirée entre la jalousie et le soulagement de voir son mari quitter les lieux, désespoir et incompréhension, colère et indifférence. Le droit sera sa planche de salut. On lui demande justement de statuer sur une affaire complexe : un hôpital réclame le droit de transfuser un adolescent atteint de leucémie, en danger de mort sans cette intervention, qu’il refuse, tout comme ses parents, au nom de leurs convictions religieuses ; ils sont témoins de Jéhovah, les transfusions sanguines leur sont interdites. Le jugement est difficile : faut-il privilégier le droit de l’enfant ou le libre arbitre de la famille ? Fiona se rend au chevet d’Adam pour tenter de juger sereinement et évaluer dans quelle mesure l’adolescent est influencé par la foi de ses parents.
La rencontre d’Adam bouleverse Fiona. Pas seulement en tant que juge mais en tant que femme qui prend soudain conscience que ce qu’elle pensait être un choix (ne pas avoir d’enfant) fut « une fuite pour échapper à son destin normal. L’échec à devenir une femme, au sens où sa mère entendait ce terme. Comment en était-elle arrivée là ? ». C’est donc bien l’ensemble de l’existence de Fiona qui est bouleversée par l’affaire Adam Henry. Quel jugement rendre ? Comment penser la faille que cet adolescent vient de révéler en elle ? Comment, une fois la décision de justice entérinée, supporter le poids moral de sa décision, les conséquences sur le destin d’Adam ?
L’auteur d’Expiation excelle à rendre la violence de drames intimes et intérieurs sous une surface feutrée, dans des existences qu’un détail dérègle soudain. Tout est couple dans le roman : celui de Fiona et Jake qui part à vau-l’eau, celui que Fiona, femme et épouse, forme avec Fiona en tant que juge, celui qui la lie désormais à l’existence d’Adam, l’adolescent suspendu à sa décision. Auxquels s’ajoutent tous les couples au centre des affaires sur lesquelles Fiona statue, des divorces, l’un des jumeaux siamois qu’il faudra sacrifier pour que l’autre survive ou les deux sœurs dont les parents se disputent la garde. Mais rien n’est jamais fait divers chez Ian McEwan, quand bien même ces affaires, authentiques, lui ont été confiées par Alan Ward, ami et juge, remercié à la fin du roman. Nul sensationnalisme chez le romancier anglais mais la volonté de traiter de ces « cas » dans leur dimension humaine et intime, d’en faire des moments, l’espace même du dilemme, entre la loi laïque et la foi religieuse, la conviction subjective et le droit. La raison peut-elle demeurer froide, abstraite et objective ? Comment, pour Fiona, vivre avec le poids de décisions qu’elle prend et qui engagent des vies ? Comment se protéger de la culpabilité, de décisions qui, parfois, se révèlent tragiques ?
« Toute l’horreur et la désolation, et le dilemme en lui-même, étaient présents sur la photo »
Plus largement le dilemme est au cœur du récit dans sa structure et son avancée : tous les personnages sont confrontés à la question du choix (ou de l’illusion du choix) et Ian McEwan fait de ces entraves les moteurs d’un roman qui a des accents de tragédie. Les personnages ont conscience de jouer des rôles, d’être les marionnettes de leur destin. S’il n’y a pas à proprement parler d’unité de lieu dans L’intérêt de l’enfant, tous les espaces qui le structurent sont clos et oppressants, ce sont des chambres, la chambre d’hôpital, la cour de justice, la chambre dans laquelle Fiona tente de trouver le sommeil à coups de somnifères, la chambre de Mélanie. Tous les lieux semblent se resserrer autour des personnages, jusqu’au quartier huppé dans lequel les Maye résident, Gray’s Inn, « une sorte de quartier fermé historique, de forteresse » qui ne se révélera pas longtemps protecteur. Le temps du récit est extrêmement resserré, toutes les actions tournent autour de la notion de choix. Et le dilemme, nœud tragique, devient l’essence du roman comme la question centrale qui traverse des personnages qu’un événement rend soudain étrangers à eux-mêmes, à ce qu’ils pensaient être le sens de leur vie. « Le virus du soupçon infectait le passé », tel « un trou noir en expansion » qui menace d’anéantir toute certitude et de fermer tout avenir.
« C’est pathétique, c’est banal »
L’Intérêt de l’enfant est de ces romans, rares, qui jouent d’une apparente simplicité pour mieux soulever et analyser des questions complexes. Le démon de midi qui s’empare du mari de Fiona est sans doute d’une banalité affligeante, à la limite du pathétique. Mais il est l’événement qui fait basculer le quotidien dans le drame, les certitudes dans l’ambiguïté. La crise que traverse Fiona est tout autant celle d’une femme en plein conflit conjugal que d’une magistrate confrontée aux enjeux éthiques et déontologique de son métier, soudain incapable d’élever une barrière entre une affaire et les conséquences de sa décision de justice sur sa propre existence.
Exposées par le versant de l’intime, des zones d’ombre et du vertige intérieur, ces crises sont celles de nos sociétés contemporaines, placées face à des choix impossibles et menacées, comme Fiona face à Adam, « d’avoir la tête vide, de ne plus trouver de sens à rien », ou comme Jack face à Fiona, d’être placées face à « une question impossible ».
Ian McEwan, L’Intérêt de l’enfant (The Children Act), traduit de l’anglais par France Camus-Pichon, Gallimard, « Du monde entier », 2015, 232 p., 18 € — Lire un extrait