
« Ulysse et Pénélope » de Francesco Primaticcio (vers 1545). Musée d’art de Tolède (domaine public)
Le monde
changeant de
Louise Glück
Après la parution de deux beaux recueils (Nuit de foi et de vertu, L’iris sauvage), Gallimard poursuit la publication en français de l’œuvre du Prix Nobel de littérature 2020, Louise Glück, avec Meadowlands (1996) et Averno (2006).
La poétesse américaine Louise Glück reçoit le Prix Nobel de littérature
Après la parution de deux beaux recueils (Nuit de foi et de vertu, L’iris sauvage), Gallimard poursuit la publication en français de l’œuvre du Prix Nobel de littérature 2020, Louise Glück, avec Meadowlands (1996) et Averno (2006).
Louise Glück, Meadowlands. Édition bilingue. Trad. de l’anglais (États-Unis) par Marie Olivier. Gallimard, 144 p., 16 €
Louise Glück, Averno. Édition bilingue. Trad. de l’anglais (États-Unis) par Marie Olivier. Gallimard, 176 p., 19 €
Meadowlands (neuvième recueil de Glück) présente quarante-six poèmes où alternent l’évocation de la désintégration d’un mariage contemporain et des épisodes de l’Odyssée. Ce sont la plupart du temps le couple moderne et les héros mythiques qui s’expriment, avec souvent des mots et pensées d’aujourd’hui. Les thèmes habituels de Glück sont présents (la perte, la douleur…) sous forme parfois elliptique et avec les ruptures de ton qu’elle affectionne. Mais ici, l’ambition de faire entrer en résonance ou dissonance des mondes et des atmosphères différents, des interrogations complexes, n’est pas toujours réalisée, et certains poèmes restent assez plats, leurs formulations et leurs aphorismes un peu triviaux.
Certes, le recueil est agréable à lire. Il est aisé de se sentir en sympathie avec la tristesse de Pénélope ou de tout cœur avec les vérités de Circé, surtout lorsqu’elles sont présentées un peu à l’emporte-pièce. Ainsi, quand la magicienne déclare : « Je n’ai jamais transformé qui que ce soit en cochon. / Certaines personnes sont des cochons : je leur donne juste / L’apparence de cochons », on veut bien acquiescer. Quand Télémaque, avec sa sensibilité adolescente, dit l’agacement que ses parents lui inspirent, on écoute. Quand les plaintes contre les défauts masculins sont énoncées, on hoche la tête même si la poète signale que ce que nous lisons « n’est pas / une petite histoire sur la corruption innée / du mâle », et même si Ulysse n’apparait jamais pour parler en son propre nom, laissant la place trop souvent à des récriminations et des chagrins qui ne semblent pas considérés avec l’ambivalence ou la puissance souhaitables.
Bien sûr, on peut s’amuser de la petite comédie moderne des disputes conjugales (« Je t’ai dit que tu pouvais faire un câlin. Cela ne veut pas dire que tu peux me mettre / tes pieds froids sur la bite »). Mais le compte poétique n’y est pas toujours. Certains poèmes, toutefois, échappent à la schématisation ou à l’enfermement narcissique et parviennent alors à un parfait degré de clarté et de vigueur, comme les neuf poèmes intitulés « paraboles » ou « Nostos » sur l’immuable et l’instable qui se terminent sur deux vers déjà célèbres : « Nous regardons le monde une fois, dans l’enfance / Le reste est souvenir. » Ils permettent de retrouver la tension vraiment féconde que Glück sait instituer avec les textes canoniques et son propre lyrisme perspicace et finement discordant.
Averno, paru douze ans après Meadowlands (et deux autres recueils de poèmes, non traduits en français), a également recours à la mythologie antique. Le titre d’abord (celui d’un des poèmes du livre) renvoie bien sûr au lac où les Anciens voyaient l’entrée des enfers, tandis qu’une des histoires centrales du recueil, celle de Perséphone, porte les thèmes de l’arrachement, de la mort, de la renaissance, de la culpabilité et de la violence. Les « Je » poétiques qui s’expriment dans les douze poèmes sont diverses versions d’un même psychisme, incarné tantôt en Perséphone, en Déméter… Ils reviennent au fil du livre et laissent « filtrer » de manière plus ou moins perceptible des évènements extérieurs récents (le 11 septembre 2001 dans « Octobre ») et des souvenirs personnels transformés par le mythe ou retravaillés dans des séances d’analyse.

L’enlèvement de Perséphone par Van der Borcht, Peeter, Bibliothèque municipale de Lyon (N16BOR000868) (licence ouverte)
La méditation d’Averno aborde les questions du corps et de l’âme, de l’amour, de la vie et de la perte tant pour les humains que pour la Terre. Les poèmes donnent l’impression d’être écrits après un désastre et tenus à la fois par la nécessité de se souvenir de celui-ci et par la répugnance à le faire. Ils se déroulent dans une atmosphère souvent automnale qui permet de belles évocations de la saison et de ses paysages. « Un jour comme un jour en été. / Exceptionnellement fixe. Les longues ombres des érables / presque mauves sur les sentiers de gravier. / Et dans la soirée, la chaleur. La nuit comme une nuit en été. »
Averno pose aussi de multiples questions sur la mémoire, surtout celle du traumatisme. À quoi sert de se souvenir ? De quelle manière cela se produit-il ? Quels en sont les effets ? Les réponses sont multiples comme dans « Rotonde bleue » : « Il n’est pas intéressant de se souvenir. / Le dégât n’est pas intéressant » ou au contraire : « Je dois imaginer. / Tout / ce qu’elle a dit. // Je dois agir / comme s’il y avait une réalité / une carte qui mène à cet endroit ». Les réponses du recueil sont également multiples en ce qui concerne les questions, très obsédantes chez Glück, des rapports entre victime et agresseur, et celles des relations entre l’humain, la mort, et la création.
Si tout cela n’est donc pas nouveau dans l’œuvre de Louise Glück, la forme l’est : le recueil est en effet rempli d’échos, de fragments, de fugues, de « prismes » (qui sont d’ailleurs les titres de poèmes du livre), signalant un désir de révision, combinaison, reprise. À telle enseigne que deux poèmes dans Averno s’intitulent « Meadowlands », et deux autres « Perséphone, l’errante ». Ces derniers, qui encadrent le recueil, se déclarent, d’ailleurs, dans leurs vers, des versions différentes de la même histoire, soulignant le rôle moteur de la modulation et de la variation dans l’opus.
Pourtant, dans ce travail poétique souvent très beau, la concentration sur soi-même, la colère, la plainte, prennent par moments un caractère prévisible et étouffant (certaines strophes de « Prisme », par exemple). La préoccupation narcissique et la vision décourageante des rapports humains n’échappent pas au banal dans leur ressassement, dans une perspective un peu triviale et dépassée des problèmes parentaux, maritaux, filiaux et des restrictions sociétales imposées à l’individu. Il y a dans Averno une conception vieillotte et plaintive des relations homme/femme et de la condition féminine. Les poèmes n’ont de force et de densité tragique que lorsqu’ils s’en détachent et utilisent la sphère personnelle pour se projeter vers les questions métaphysiques et esthétiques.

Louise Glück © Katherine Wolkoff
On retrouve alors l’univers de Glück, fragile, beau, redoutable dans son pouvoir de menace et de dépossession, où la plainte se déploie lyriquement, avec tout son pouvoir d’enveloppement saisissant, et ses infinis retournements. Ainsi « Octobre », assez long poème, remarque-t-il :
Les chants ont changé ; mais vraiment, ils sont encore très beaux.
Ils sont concentrés dans un plus petit espace, l’espace de l’esprit.
Ils sont sombres à présent, sombres de désolation et d’angoisse.
Et pourtant les notes reviennent. Elles planent curieusement
Dans l’anticipation du silence.
L’oreille s’y habitue.
L’œil s’habitue aux disparitions.
Tu ne seras pas épargné, ni ce que tu aimes ne le sera.
Le poème se clôt trois pages plus loin sur un couplet ambigu, faussement naïf : « Mon amie la lune se lève ; / Elle est belle ce soir, mais quand ne l’est-elle pas ? »
Ces moments d’Averno font retrouver les identités aléatoires et émouvantes d’un « Je » lyrique qui, éloigné de la banalité, exprime le monde d’une manière passionnée, changeante et complexe.




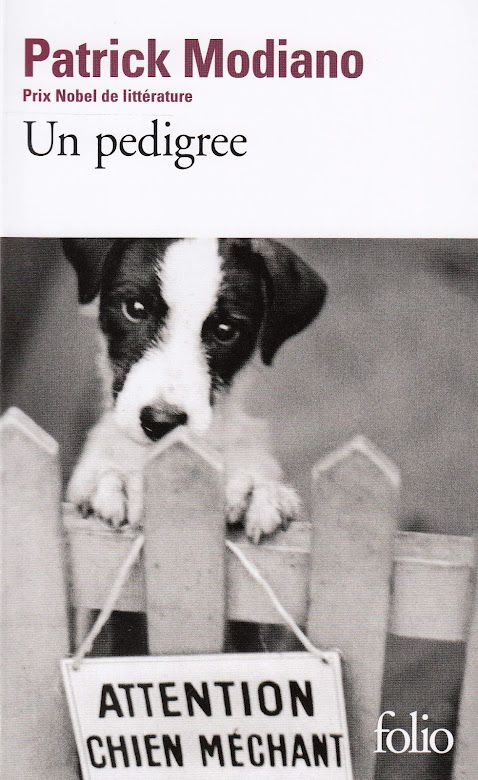
%2B(1).jpg)





